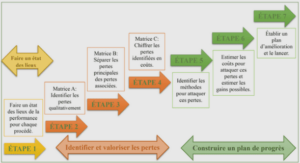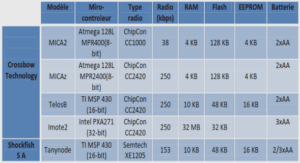Passages d’une métaphore à l’autre
Un nouvel exemple, sous la plume de François Bégaudeau cette fois, nous permet de revenir plus précisément à la question des métaphores potentielles, projetées ou réalisées. Dans un article très riche, à propos de Million Dollar Baby, le professeur repenti évoque ainsi le « noble art » : « Dramaturgie livrée clé en main, métaphore sur la destinée humaine up and down, exposition en miniature de la corruption générale : on sait le paquet de bénéfices que le cinéma a tiré de la boxe. »179 Ici, l’idée de la boxe comme métaphore de « la destinée humaine », avec ses hauts et ses bas, sa roue du destin, est présentée comme extérieure au film de Clint Eastwood, comme appelée par le sport lui-même. Elle apparaît avant tout comme une métaphore décelée par Bégaudeau mais pas nécessairement dans Million Dollar Baby, et d’ailleurs cette image des fortunes et infortunes de la vie n’est pas vraiment ce que l’article développera. C’est donc une métaphore qui serait potentiellement dans le film d’Eastwood mais réalisée quand on considère l’ensemble des films sur la boxe, qui présentent pour la plupart l’histoire d’une ascension et d’une chute. L’expression « exposition en miniature » vise à décrire le même phénomène, la dimension « métaphorique » de la boxe pour représenter la corruption de la société, tout en évitant la répétition. Peut-être pourrait-on discuter – préciser – l’idée : dans la plupart des films en question, la boxe n’apparaît pas seulement comme un concentré de corruption ou une image de la corruption générale, mais aussi comme le lieu paradoxal où l’on peut y échapper, notamment sur sous son versant « noble art », dans Million Dollar Baby comme dans Raging Bull par exemple, qui sont les deux seuls films cités par Bégaudeau. Reste bien sûr que l’on peut tempérer cette réserve, en replaçant cette dimension aussi sous le versant « spectacle », aliénation du sportif qui sacrifie son corps, parfois sa vie, à une gloire éphémère un peu vaine. Enfin, l’idée d’une « dramaturgie livrée clé en main » avec la boxe suggère d’autres comparaisons, dont celle de la boxe comme petit théâtre de l’existence, avec ses différents actes, sa gloire possible, mais la mort aussi : métaphore qui n’est pas loin de la précédente. Mais ce qui intéresse le plus Bégaudeau est une autre comparaison, que l’article développera sans l’expliciter : le cinéma, comme la boxe, est un art centré sur le corps – le cinéma d’Eastwood particulièrement, « toujours plus au ras des choses et des organes ». Et tout le drame que la boxe nous propose trouve son origine dans cette matière qu’elle exhibe, elle aussi : la chair. L’article fait remarquer que « la boxe, filmée à fleur de short, n’est jamais sublimée en chorégraphie » : nouveau refus d’une métaphore, de la part d’Eastwood, après celle de la destinée humaine. Bégaudeau développe alors, toujours implicitement, une comparaison entre l’entraîneur du film et le réalisateur. Le long-métrage procède en effet à une « mise à nu sans épure aristocratique » : Jusque dans son montage-séquence d’entraînement, habituelle machine de guerre ici ralentie par les fondus enchaînés, le son direct et une guitare de feu de camp, Million Dollar Baby refuse la puissance, diffère indéfiniment le moment de lâcher les lions. Avec Frankie, le titre est toujours pour dans deux ou trois combats, et à vrai dire on ne le dispute jamais. Comme si seul importait, non la beauté du geste, mais le geste lui-même comme dépli et repli du corps, combat contre soi, rapport du poing au poing via le sac suspendu. Et l’article d’expliquer ensuite « ce refus de déclencher les grandes manœuvres », pour Frankie : 179 François Bégaudeau, « Ceci n’est que mon corps », Cahiers du cinéma n°599, mars 2005, p. 22-23. 153 Passages d’une métaphore à l’autre En off du zoom [in]augural sur la pommette s’élève une voix caverneuse qu’on croit celle, intérieure, du boxeur à l’image. Or il s’agit de celle de Scrap. Deux façons d’interpréter ce malentendu volontaire. D’abord la plaie tourne métaphore, ainsi que la blessure, qui de purement physique désigne désormais une faute d’antan que Frankie ne se pardonne pas – avoir laissé dépérir l’œil de Scrap, son poulain d’alors. Surtout, le procédé entend souligner par ce pont transtemporel la permanence des lois organiques, la répétition à l’identique du broiement des corps par le métier. À ce moment, la déchéance du vieux borgne s’affiche crûment comme le destin de l’impétrant. Le tragique selon Eastwood a trait à la malédiction d’avoir un corps, à la conviction qu’à ce jeu on est toujours perdant. Vainqueur triomphal d’un combat de boxe, on est quand même sûr de le finir en moins bon état qu’on l’a commencé. Laissons de côté la belle hypothèse d’une comparaison entre la pommette blessée de Scrap et la blessure intérieure de Frankie. Laissons aussi le symbole d’un péché originel, d’une faute inaugurale qui n’augure rien de bon, ce symbole d’une plaie quasi christique, exhibée par le réalisateur comme pour mieux dire que les corps ne ressuscitent pas : la métaphore est bien présente dans l’article, justement intitulé « Ceci n’est que mon corps ». Bégaudeau conclut alors en soulignant que Frankie aurait « mieux fait de ne pas offrir à Maggie le destin de gloire qu’elle lui réclamait. Voilà alors le cinéaste Eastwood tenté de virer médecin, immobile au chevet de ses personnages », n’ayant plus « que les yeux pour pleurer ». Plus que la métaphore du médecin, c’est l’analogie avec le Christ qui est saisissante ici : une fois la puissance de Maggie révélée, son itinéraire ne pouvait être que de la gloire au trépas, et Frankie ne pouvait esquiver son destin, de se pencher une nouvelle fois sur un malade, comme dans une déploration du Christ. Étonnante analogie que celle-là, qui parcourt tout l’article, qui convainc, mais qui n’est nullement attestée dans l’œuvre – de même qu’elle reste constamment implicite dans le texte, élégamment, comme pour ne pas écraser le film sous cette interprétation. On peut relever alors que le refus de la métaphore, dans Million Dollar Baby, participe de ce refus d’Eastwood de « déclencher les grandes manœuvres ». Bégaudeau le suggère, en ouverture de son article, suggérant que ce « zoom sur la pommette ouverte du boxeur à sa chaise », pénétrant dans la plaie, comme pour y « remuer le couteau », « c’est bien la manière d’Eastwood depuis quelques films, mais pas de le signifier d’une figure aussi maniérée » : Si cela n’avait pas rien à voir, on croirait le plan tourné par Scorsese dans Raging Bull, focus sur les stigmates christiques de La Motta, chaque pain reçu un clou enfoncé dans la paume. Rien à voir ici, une plaie est une plaie, bout de chair traité comme tel par le coton-tige expert de l’entraîneur Frankie. Le film n’est pas allégorique, en effet. Et si l’itinéraire d’un boxeur peut faire penser à une Passion, c’est que la boxe est une « dramaturgie livrée clé en main, métaphore sur la destinée humaine, exposition en miniature de la corruption générale ». Étonnante subtilité de François Bégaudeau, qui déploie volontiers les grandes manœuvres, lui, mais qui cerne admirablement la spécificité du film d’Eastwood en filant une métaphore qui ne s’y trouve pas réalisée. Comment un tel tour de force est-il possible ? C’est précisément parce que la métaphore, ici, n’est ni projetée ni réalisée : Bégaudeau s’intéresse à une métaphore qui concerne potentiellement la boxe, potentiellement tout film qui traite de ce sport. La boxe comme image de la condition humaine, incarnée, modelisée, narrativisée par l’histoire du Christ, sans la résurrection. Peut-être aussi suggère-t-il la présence d’une culture chrétienne chez Eastwood, mais tenue à distance. On voit alors que la métaphore potentielle est un cas limite : c’est une métaphore bâtie à partir d’éléments extérieurs au texte ou au film (par le lecteur ou le spectateur, mais aussi par l’auteur 154 parfois ; elle reste ainsi virtuelle, non réalisée), c’est néanmoins une métaphore dont on peut penser qu’elle est appelée indirectement par le texte ou par le film, ou du moins qu’elle est autorisée, permise, qu’une place lui est réservée en creux, ne lui est pas interdite. On notera que, pour cette raison, la frontière entre métaphores réalisées et potentielles n’est pas toujours très nette (de même qu’entre métaphores potentielles et projetées, par ailleurs) : pour telle personne, tel film développe clairement une métaphore, qui semblera une simple hypothèse à tel autre – comme ici, pour Bégaudeau, entre la blessure physique de Scrap et la blessure intérieure de Frankie, qui ne me paraît pas attestée, mais semble en même temps très vraisemblable. C’est souvent un faisceau de présomptions qui permet ces lectures métaphoriques, voire allégoriques, d’où le caractère plus ou moins « potentiel » selon les individus. On retrouve d’ailleurs là le problème de l’implicite : on peut attirer l’attention sur sa présence mais, par définition, on ne peut pas en imposer la perception et la bonne compréhension. Le zoom et le très gros plan sur la pommette blessée invitent le spectateur à s’interroger, mais ne garantissent rien, surtout qu’à une première interprétation, métaphorique par exemple, peut s’en ajouter une autre, symbolique en l’occurrence : rien n’indique s’il faut arrêter ou poursuivre l’interprétation, si l’on est arrivé au bout des significations possibles.
Métaphores in fabula
C’est pourquoi nous questionnerons maintenant différents films où apparaissent des métaphores implicites ou potentielles. Il s’agira de cerner, au sein d’œuvres entières cette fois, à quelles conditions on peut dire qu’il existe, en tel point, une métaphore, entièrement réalisée ou non, et pourquoi elle n’est pas projetée. Il s’agira aussi de vérifier sur une nouvelle échelle la pertinence des notions élaborées. Nous en profiterons pour nous demander, à l’occasion, pourquoi certains longsmétrages préfèrent cette énonciation très discrète, qui présente le risque évident de passer inaperçue. Vertigo d’Alfred Hitchcock Revenons pour commencer sur Sueurs froides. Ce n’est pas le genre de film où le sentiment d’une métaphore s’impose, disons comme chez S. M. Eisenstein : jamais le spectateur n’est « arrêté » par une marque d’énonciation ostensible, par un plan extérieur à la diégèse par exemple, qui lui imposerait une lecture métaphorique. Le film, néanmoins, a fait l’objet de nombreuses interprétations, et son succès vient probablement de cette ouverture, de cette variété des interprétations qu’il permet. Le motif du vertige, notamment, présent dans le titre, qui occupe les deux premières séquences, passe rapidement au second plan de l’histoire, pour devenir un simple handicap du personnage principal, qui fera de lui le témoin idéal du crime. Même s’il joue, sur le plan narratif, un rôle crucial, le vertige ne fait l’objet d’aucun développement explicite : aucune clef n’est vraiment proposée pour le comprendre, malgré la fin elle-même, où le détective amoureux réussit à le surmonter, en même temps qu’à découvrir la vérité sur Judy et Madeleine. L’absence d’explication véritable à ce malaise, de la part d’un auteur ne pratiquant pas la dénégation à l’égard de la psychanalyse, ne peut manquer de solliciter l’imagination, de lancer toute une série d’hypothèses. C’est ainsi qu’on a pu interpréter le trouble du policier en voie de reconversion comme le signe d’un problème avec les femmes : une lecture de Vertigo, généralement inspirée par 161 l’ouvrage de Jean Douchet, fait de Scottie un personnage en proie notamment à l’impuissance.184 Plus largement, il est certain qu’il existe une analogie entre son vertige et son trouble face à Madeleine : le vertige permet une interprétation métaphorique, peut être considéré comme « symbolique ». Il y a clairement un vertige amoureux dans le film. Nous en avons donné un premier indice déjà avec le dialogue étonnant sur le soutien-gorge, dans la deuxième séquence, qui permet d’ailleurs à Midge de présenter Scottie comme un petit garçon, qui ne connaîtrait pas les femmes. Mais, plus largement encore, il y a toute une thématique de la chute dans Vertigo qui possède une dimension elle aussi métaphorique. À la fin de cette même deuxième séquence, on pouvait déjà noter un enchaînement de plans intéressant : après avoir essayé de vaincre son mal en montant progressivement sur une échelle, il tombe, subitement sujet au vertige, et Midge le retient, d’une façon équivoque. Il se retrouve dans ses bras comme on le serait lors d’une effusion amoureuse. Le spectateur ne peut manquer de percevoir cela. Ce n’est pourtant pas l’idée d’une métaphore qui s’impose à lui : nous pensons plutôt que la jeune femme profite de l’occasion pour suggérer ses sentiments. Le choix du cadre cependant, qui nous les montre seulement la tête de l’un sur l’épaule de l’autre, ne souffre pas d’ambiguïté : il y a même quelque invraisemblance à tomber et à être rattrapé ainsi. Il y a donc clairement métaphore ici, mais dissimulée, perçue comme simple geste équivoque. Un autre plan semble faire écho à celui-ci, quand Scottie a emmené Madeleine chez lui, après sa tentative de suicide : en voulant lui servir son café, la main de John rencontre celle de Madeleine. Ce hasard est troublant : comme dans la séquence précédente, les corps se rapprochent lors d’un mauvais geste, comme par erreur, et l’acte raté donne lieu à un geste révélateur. Ce double mouvement, cette coïncidence donnée comme signifiante, est d’abord pour le réalisateur une façon d’établir la circulation du sentiment amoureux dans le film : Midge aime Scottie, qui ne l’aime pas, et Scottie aime Madeleine, qui est mariée et obsédée par quelqu’un d’autre. Une analogie cependant entre les deux situations frappe aussitôt : c’est à chaque fois un geste d’amour, protecteur, involontaire, adressé à quelqu’un qui est tombé. Madeleine vient en effet de sauter dans le fleuve et Scottie de la « rattraper ». L’idée de l’amour qui sauve de l’accident apparaît donc en filigrane : même si l’accident est passé, dans le second cas, le geste prévenant est là pour souligner la permanence du sentiment face à quelqu’un qui reste faible. Puis vient la chute de Madeleine, du haut de l’église, Scottie n’ayant pu la suivre, en proie à son vertige. Il y a l’idée d’une faute, comme si l’ancien policier n’avait pas été à la hauteur de son amour : le procès notamment la formulera, la présentera comme une faute morale. Ce rapprochement entre le thème de l’amour et celui du vertige est repris autrement par Judy, quelques séquences plus tard : ce n’est plus la peur de la chute qui est un défaut d’amour, mais l’amour luimême qui est une chute. Quand elle écrit sa lettre pour Scottie, avant de la jeter à la poubelle, elle évoque le plan parfait d’Elster : « Il n’a commis aucune erreur. Moi si : je suis tombée amoureuse. » Le ton de tragédie de l’héroïne, l’expression « I fell in love », la proximité immédiate avec la référence au crime, nous fait percevoir une analogie entre cette femme tombée du clocher et cette autre qui tombe dans l’amour : l’idée de faute est directement liée à l’amour, cette fois. L’amour apparaît presque comme conséquence du crime, comme une punition – et comme quelque chose qui lui est, en outre, interdit. Quoi qu’il en soit, à travers l’expression « I falled in love », l’amour nous est clairement dépeint comme une chute. Cette métaphore morte semble bel et bien réveillée dans le film d’Hitchcock. Elle semble délibérément structurante, non seulement dans ce monologue, mais 184 J. Douchet, Alfred Hitchcock, Cahiers du cinéma, Paris, 2002, coll. Petite Bibliothèque. 162 dans tout Vertigo : elle indique le destin de Judy. Son calvaire ne cessera pas, tant qu’elle ne tombera pas du clocher à son tour : le fait d’être tombée amoureuse l’a empêchée de jouir du crime, le crime l’empêche maintenant de jouir de l’amour. Elle ne peut être aimée que dans la mort. La chute est totale : morale, sentimentale, liée au sentiment d’échec, avant d’être littérale. L’ironie de l’histoire veut que Scottie, lui, effectue un trajet inverse : sujet au vertige, peut-être trop prudent, il ne risque pas de tomber. Ce n’est qu’à la fin qu’il réussit à surmonter son appréhension, à regarder la femme qu’il aime en face. Mais c’est pour la voir tomber : en découvrant tout sur Madeleine, il ignore encore beaucoup de Judy, notamment sa souffrance. Aveuglé trop longtemps, il ne peut comprendre le vertige propre à Judy, qui meurt en quelque sorte de n’avoir pas été plus prudente – de n’avoir pas connu plus tôt, elle, la peur de tomber. Le thème du vertige, de la chute, offre donc prise aux métaphores, et celles-ci permettent ici une interprétation, non seulement de quelques passages clefs, mais aussi du film tout entier. Faut-il considérer pour autant ces métaphores de la chute comme entièrement réalisées ? Le doute est possible, dans la mesure où elles présentent une grande cohérence avec le film, certes, mais où elles s’appuient surtout sur des métaphores structurantes, déjà présentes dans le langage en l’occurrence. L’abondance de scènes où la chute apparaît, de la première séquence à la dernière, suggère néanmoins une assez grande présence de la métaphore, une inscription assez délibérée. La métaphore serait donc plutôt implicite, mais peut-être seulement potentielle pour certains développements. Que faut-il penser, maintenant, de la métaphore « cinématographique » déjà évoquée ? Dans Fenêtre sur cour, Hitchcock affiche clairement son intention en ouverture, avec ce volet qui s’ouvre sur toute la largeur de l’écran : le spectacle qui s’offre au personnage cloué à son fauteuil, à travers le dispositif technique des jumelles, est nettement comparé à celui d’une salle de cinéma. Les tranches de vie aperçues dans les appartements d’en face constituent d’ailleurs des embryons de films. Évidemment, avec ses jumelles qu’il dirige dans une direction ou une autre, qui font vivre une histoire, qui s’attardent ou non sur des personnages, Jeff fait également penser au réalisateur. Dans Vertigo, rien n’assimile aussi nettement le film (ou l’un de ses personnages) au cinéma. L’idée que Madeleine incarnerait la figure même du rêve de cinéma est séduisante, par exemple, mais sur quoi s’appuie-t-elle dans le film ?