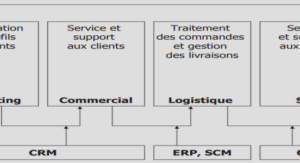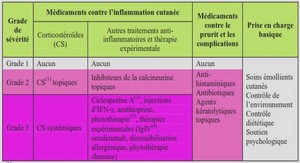Partager entre plaisir intime et activité collective
Partager l’expérience de visionnage « Ces dernières années, j’ai regardé – mais sans m’y intéresser – le truc de France 3 là… Plus Belle la Vie. Je vivais à l’époque avec quelqu’un qui adorait cette série. Donc moi, je regardais de fait aussi mais je trouvais ça vraiment chiant comme la mort. Tu as commencé avec cette personne, et tu as continué ensuite ? Ah non pas du tout. C’était lié à mon copain. Mais vraiment voilà, pendant quelques temps quoi. Ce que j’ai regardé aussi lié à ce copain, c’était le truc sur les médecins, Grey’s Anatomy. » (Lucile, 27 ans, avocate) Cet extrait d’entretien en témoigne, la consommation audiovisuelle peut être l’occasion d’un moment de partage où le fait d’être avec l’autre l’emporte quelques fois même sur le contenu visionné. Les rendez-vous avec des séries sont autrement dit parfois des rendez-vous avec des personnes : un conjoint, un parent, un ami, un colocataire. Je l’évoquais au chapitre 3, le visionnage de séries est généralement synonyme d’intimité et, partant, s’effectue, sinon seul, au plus en comité restreint. Le cas échéant, on est accompagné de personnes familières, avec qui l’on cohabite ou, du moins, bénéficiant d’un accès privilégié à notre intérieur. La dimension intimiste de la spectature sérielle est d’abord corrélative du cadre domestique de la pratique télévisuelle à laquelle elle se rattache originellement. Et si, comme nous l’avons vu, elle tend depuis quelques années à s’autonomiser vis-à-vis de la télévision – les équipements mobiles permettant même des consommations hors domicile, par exemple en situation de déplacement –, elle n’en demeure pas moins ancrée pour l’essentiel dans l’univers domiciliaire. Regarder une série est l’occasion d’un moment, non seulement de détente (une sortie cinéma l’est aussi), mais aussi de retour à soi et de coupure avec le monde extérieur. La sphère intimiste créée autour de la série peut inclure celles et ceux qui nous sont proches – les conjoints notamment : « Il faut que ça plaise à tous les deux. Donc on a… Après c’est compliqué, tu vas pas monopoliser la télé… Ou alors l’un regarde sur la télé d’en bas et l’autre sur la télé d’en haut. Mais on n’y arrive pas. On ne sait pas faire ce genre de choses l’un sans l’autre. Bon, hormis le foot – et encore, des fois elle regarde des matchs de foot avec moi ! (Rires) » (Éric, 40 ans, photographe freelance) Certains sériphiles privilégient essentiellement des pratiques spectatorielles solitaires, en raison de l’important investissement dont ils font preuve qui ne peut pas être suivi par leurs proches. Parmi les personnes enquêtées, les pratiques les plus extrêmes comme les séances marathon sont d’ailleurs le fait d’un public majoritairement composé de jeunes adultes célibataires et étudiants, de sorte que la vie de couple comme l’entrée dans la vie active viennent en atténuer la teneur, dès lors plus affaire de compromis et de retenue. Un autre élément explicatif de la dimension individualisée de la pratique a trait à la spécificité du genre et de ses deux formes typiques, séries feuilletonnantes et séries itératives, précédemment décrites. On observe davantage de visionnages collectifs liés à des séries itératives telles que l’ordre des épisodes n’est (presque) pas chronologique et qui, donc, n’appellent pas un suivi continu et assidu. À l’inverse, en forte recrudescence depuis plus d’une décennie, les séries feuilletonnantes requièrent une plus grande régularité de la part des spectateurs, laquelle peut s’avérer fastidieuse dès lors qu’il s’agit d’instaurer un rythme commun à plusieurs personnes. À la longue, d’aucuns trouveront plus commode d’avancer seuls selon leur propre rythme. C’est ce que rapporte Gabriel, évoquant sa colocataire avec qui il suit certaines séries… non sans peine : « Heroes et Desperate Housewives, c’est toujours avec elle. On n’a pas le droit de regarder d’épisode seul. Ce sont deux séries où je suis toujours en retard. Comme je suis obligé de l’attendre, ça handicape ma progression. Du coup je préfère regarder seul. Disons qu’il y a le pour et le contre… Ça dépend de la série en fait. Il y en a que je préfère regarder tout seul comme Grey’s anatomy. Si je trouve ça très émouvant par exemple, je préfère être seul. Une série comique par contre, comme How I met, c’est plus sympa à plusieurs. » (24 ans, étudiant)
Partager son attachement : échanges et conversations
Nous venons de voir que l’expérience de visionnage sériel, en vertu de son caractère intimiste, est une pratique solitaire ou partagée avec des personnes qui nous sont (très) familières. Pour nombre d’amateurs, elle se conjugue régulièrement au singulier et, comme l’a montré Hervé Glevarec 16, certains ne témoignent pas non plus d’une volonté de partager outre mesure cet intérêt, aussi profond soit-il. Une telle tendance a pu notamment s’expliquer par le défaut de légitimité qui a longtemps caractérisé le genre, comme le rappelle Charlotte : « C’est vrai que moi je me souviens que c’était un peu la honte de dire « je regarde des séries » » 17. Mais ce procès en illégitimité était avant tout le fait de catégories au capital socioculturel élevé. Or, ces mêmes catégories n’hésitent pas aujourd’hui à tresser des lauriers à certaines téléfictions dites « de qualité » comme les Soprano, Sex & the City, The Wire ou encore Mad Men. J’abonderai d’ailleurs dans le sens de Glevarec lorsqu’il voit dans l’inclinaison grandissante des catégories supérieures vers les séries un aspect majeur de l’évolution des pratiques sérielles contemporaines. Ce regain d’intérêt dont les médias culturels ou dits « sérieux » se font de plus en plus les porte-voix confère au genre une reconnaissance jusque-là inédite en France. Une partie des téléfictions reste toutefois stigmatisée par ces catégories socio-culturellement pourvues, comme l’illustre l’embarras de Lucile, jeune avocate de 27 ans, concernant son penchant pour certaines séries « à l’eau de rose » : « Je crois pas que j’ai besoin d’en discuter, je veux pas le partager. J’ai aucun besoin de… c’est un truc hyper personnel. Si, une série que j’ai partagée, c’est Sex & the City, mais parce que les conversations que ces nanas ont sur les hommes et sur leur vie, c’est typiquement celles qu’on a. Ça sortait pas de ma vie en fait. Sinon, les séries, j’en parle pas parce que mes choix sont pas très… comment dire, c’est pas facile de dire qu’on adore les Frères Scott et Dawson, parce que les gens vont se foutre de toi. » Célibataire et vivant seule, Lucile ne manifeste nullement le désir de partager son goût pour la demi-douzaine de séries qu’elle regarde ou a regardé. Sorte de péché mignon, elle s’adonne au plaisir sériel seule et se garde bien de l’afficher en public. Quelques rares proches sont par exemple au courant de son attrait pour les séries Les Frères Scott et Dawson, qui, si elles l’ont passionnée, lui procurent simultanément un léger sentiment de honte. Mais outre ces deux séries frappées du sceau de l’indignité dans son entourage – du moins le suppose-t-elle –, la jeune femme suit avec plus ou moins d’assiduité d’autres téléfictions plus « convenables » socialement telles que Sex & the City, Medium ou encore How I Met Your Mother. Reste que, Sex & the City exceptée (voir l’extrait d’entretien ci-avant), Lucile discute peu avec d’autres de ses séries, pourtant très populaires parmi ses proches. De son propre aveu, elle n’en ressent pas le besoin. Ce n’est pas le cas d’autres sériphiles. La sociologie, avec le « two-step-flow » de Lazarsfeld, les « communautés d’interprétation » de son disciple Katz ou encore, en France, les « conversations télé » chères à Boullier, nous a appris toutefois que la télévision et ses programmes, et a fortiori les séries, font ordinairement l’objet d’échanges quotidiens, au sein du foyer familial, à l’école ou au bureau, entre intimes ou avec de parfaits inconnus… Il s’agit d’échanges souvent anecdotiques comme le confesse un enquêté, mais qui ne sont pas dénués d’importance puisqu’ils participent du sentiment d’appartenance à une ou plusieurs communautés d’expérience, quand ce n’est pas à la communauté nationale. Pour Stéphane Calbo, derrière l’investissement individuel des programmes télévisuels pointe un investissement collectif. L’auteur définit cet investissement collectif à la fois comme : « …un phénomène de « co-action » par lequel une collectivité plus ou moins importante investit un même objet et un phénomène de valorisation sociale de nature discursive qui met en scène cette « co-action » et construit ce qui a été investi comme un objet acquérant une existence et une valeur sociales. (…) Cela permet d’acquérir des « référents partagés » qui sont autant de ressources CHAPITRE 6 — 340 — conversationnelles et permettent à l’individu une majeure inscription dans des collectifs, des communautés d’expériences, des « communautés émotionnelles » » .