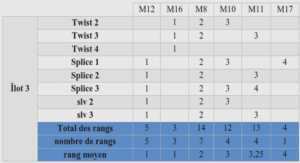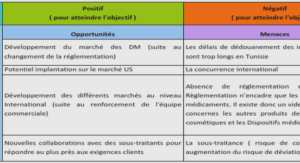POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE
Après avoir délimité la problématique et précisé les différents questionnements qu’il semble intéressant de traiter, il convient d’adopter un positionnement épistémologique et déterminer la démarche de recherche adéquate. Ce chapitre présentera successivement ces deux aspects. Bien que cette thèse ne porte pas spécifiquement sur les questions épistémologiques, il semble indispensable de situer ce travail au regard des paradigmes épistémologiques qui existent puisque le positionnement adopté a entraîné certaines décisions concernant les directions suivies pour mener à bien cette recherche. Cette section sera divisée en deux sous- parties : la première éclairera le positionnement épistémologique et la seconde catégorisera cette recherche. Etymologiquement, « épistémologie » se décompose en deux mots grecs : « épistémè » qui signifie connaissance, science, savoir et « logos » qui signifie discours, langage, jugement. L’épistémologie se définit donc soit comme l’étude portant sur la science soit comme l’étude de la connaissance. Comme l’indique Soler (2000, p14), à la différence des anglophones pour qui l’épistémologie est synonyme de « théorie de la connaissance », les francophones font une utilisation plus étroite de ce terme en qualifiant ainsi la « réflexion sur la connaissance spécifiquement scientifique ». La réflexion épistémologique porte ainsi sur la nature et la valeur des principes, des concepts, des méthodes et des résultats des sciences. « Tout travail de recherche repose sur une certaine vision du monde ». Les présupposés épistémologiques permettent un contrôle de la démarche de recherche, un accroissement de la validité de la connaissance issue de ce travail et lui accordent un caractère cumulable (Girod- Séville et Perret, 1999, p13). En effet, dans le quotidien du chercheur, ce positionnement épistémologique sert simplement à légitimer sa question de recherche. Le chercheur justifie ainsi son action et la communication des résultats issus de ces travaux. « L’épistémologie est une autorisation de parler et de se faire entendre » (Wacheux, 1996, p38).
Les paradigmes représentent des systèmes de croyance qui lient l’utilisateur à une vision du monde particulière (Denzin et Lincoln, 1994). Deux grands paradigmes s’opposent en sciences de gestion : le positivisme et le constructivisme (Le Moigne, 1990). Le paradigme positiviste est souvent considéré comme le paradigme dominant dans les sciences de gestion (Girod-Séville et Perret, 1999), même si le constructivisme attire de plus en plus de chercheurs (Charreire et Huault (2001) notent le succès du paradigme constructiviste en France depuis une dizaine d’années). Comme le soulignent Girod-Séville et Perret (1999), un troisième paradigme peut être considéré qui est l’interprétativisme. D’autres auteurs préfèrent identifier deux types de constructivisme : une approche radicale et une approche modérée (interprétativisme) et deux types de réalisme : le réalisme dogmatique (positivisme pur) et le réalisme critique (Kwan et Nous pensons, comme Bernstein (1983), qu’une opposition tranchée entre le positivisme et le constructivisme n’est pas nécessaire et que les travaux de recherche peuvent ne pas se reconnaître totalement dans un de ces paradigmes et emprunter des éléments aux différents paradigmes (Girod-Séville et Perret, 1999) (par exemple, dans la dernière partie de ce chapitre, le positionnement de Glaser et Strauss sera discuté). Les épistémologies positiviste et constructiviste ont tendance à se rapprocher et adoptent des positionnements modérés (Thiétart, 1999). Ainsi, nous rallions l’idée développée par Charreire et Huault (2001) selon laquelle il existerait plutôt un véritable continuum entre constructivisme radical et constructivisme modéré, voire même entre constructivisme modéré et positivisme aménagé. Miles et Huberman (1991) indiquent que les limites entre les paradigmes sont devenues floues. Ils ajoutent que d’autres perspectives telles que le pragmatisme ou l’interactionnisme symbolique relèvent autant du courant interprétativiste que du post-positivisme.
Le positivisme a vu le jour au XIXe siècle et a pour initiateur le philosophe des sciences Auguste Comte qui a précisé que le mot positif désigne, dans sa signification la plus ancienne, le réel (Le Moigne, 1995a). En 1970, l’ouvrage de Jean Piaget présente un exposé épistémologique d’un nouveau genre, en réaction au béhaviorisme qui, prétend-il, limite l’apprentissage à l’association stimulus-réponse. Inhelder et Vonèche (cités par Le Moigne, 1990, p102) attestent que « le constructivisme demeure sans doute la seule épistémologie valable de l’innovation créatrice, car lui seul explique comment le savoir peut créer lui-même les conditions et les instruments du savoir ». Le positivisme admet que la réalité a ses propres lois immuables et quasi invariables. Le Moigne (1990, p92) parle d’univers câblé et la science se doit de découvrir le plan de câblage, c’est-à-dire de découvrir la vérité derrière ce qui est observé (David, 1999). Ce plan de câblage est constitué par des chaînes de causalités simples (Le Moigne, 1990 ; David, 1999) reliant les effets observés aux causes explicatives. Girod-Séville et Perret (1999) ajoutent qu’il existe un ordre universel qui s’impose à tous et que l’homme « ne peut agir, il est agi ».