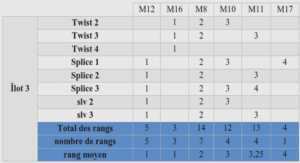Nouvelles technologies et renouveau des idéologies techniques
Des constats problématiques
Publiés en 2001 dans l’ouvrage intitulé Les nouvelles technologies à l’épreuve des bibliothèques, les résultats de l’enquête menée ont notamment ceci d’intéressant qu’ils ont débouché sur des constats qui restent largement d’actualité. Loin de révolutionner les bibliothèques, les technologies numériques commençaient à s’y intégrer lentement en respectant, dans la plupart des cas, les grands modes d’organisation et d’usages des offres documentaires déjà existantes. Attestant du dynamisme de ces institutions culturelles, ces transformations sans heurts traduisaient à la fois la capacité des bibliothécaires à intégrer le changement et la volonté des publics de ne pas se laisser séduire sans mettre à l’épreuve les nouveaux dispositifs.
Si révolution il y avait, cette dernière était donc sous observation, faisant l’objet d’expérimentations. La plupart des usagers prenant acte du rapport différent à l’information comme à la distraction que semblaient offrir le numérique, ils étaient loin d’abandonner un dispositif pour un autre, les logiques de cumul restant de règle. Nos résultats conduisaient à observer une curiosité tempérée à l’égard des nouveaux supports, tels que le cédérom. L’utilisation de ce dernier restait marginale par rapport à celle des autres fonds présents dans la bibliothèque (livres bien sûr, mais aussi et surtout, cassettes vidéo et compact disc audio), que ce soit sur place ou à domicile. Ainsi, le protocole d’observation des usages du cédérom Michel-Ange52 montrait que, au-delà de recherches de détails, le recours à un livre semblait préféré par la majorité des usagers à ce support au statut incertain. Au demeurant, alors que près de 50 % des usages du cédérom déclarés au domicile étaient relatifs au jeu, il était rare de trouver trace de ce dernier dans le catalogue des établissements.
En matière de numérique comme dans d’autres domaines (l’introduction de l’audiovisuel et des films de fiction dans les années soixante-dix, puis de la bande dessinée), les bibliothèques avaient réagi par une « légitimation culturelle » préalable et pour ainsi dire instinctive de leurs fonds.
Quoi qu’il en soit, les bibliothèques publiques remplissaient pleinement leur rôle de diffusion de technologies numériques, puisque les nouveaux supports y avaient été introduits très tôt. À partir des années cinquante, en effet, les premiers ordinateurs interviennent dans les procédures de prêts, et les premiers formats d’informatique documentaire Marc se diffusent à partir de 1965.
Progressivement, les bibliothécaires, soutenus voire poussés par les élus de leurs villes, se sont lancés dans des politiques d’équipements et d’acquisitions informatiques. Dans les bibliothèques étudiées (les médiathèques de Cavaillon, de Miramas et de Grenoble Grand Place, la Bibliothèque de l’Abbaye à Grenoble, et les hauts de jardin de la BnF) le nombre de titres de cédéroms en prêt ou en consultation sur place était souvent conséquent, et la diversité des fonds parfois remarquable.
Les connexions à Internet tendaient à se généraliser et l’on ne constatait pas le prétendu « retard français » abondamment commenté à l’époque dans les milieux politiques et journalistiques. Si l’usage d’Internet était loin d’atteindre son développement actuel, il en épousait déjà les contours en s’insérant dans les autres pratiques de la bibliothèque, sans pour autant susciter un engouement démesuré. Certains clivages notés à l’issue de cette enquête sont relevés dans d’autres études, dont les Pratiques culturelles des français à l’ère du numérique56 : la familiarité des populations jeunes avec l’outil informatique, la pratique courante chez les étudiants (aussi bien ludique que « professionnelle »), ou bien encore la relative méfiance de certaines fractions des populations plus âgées.
Bien accueillie par les bibliothécaires, cette enquête a cependant eu bien du mal à aller jusqu’à son terme, tant les commanditaires rechignaient à en accepter les principaux constats. Le constat d’un accueil tempéré des technologies de l’information et de la communication par les usagers des bibliothèques, ou le fait que leur introduction dans les salles de lecture ne constitue pas la « révolution » attendue (pas plus sous la forme d’une concurrence aux formes traditionnelles de la culture que sous celle d’une conversion massive des lecteurs à la manipulation de ces technologies) posait visiblement problème.
Il est vrai que durant les mois qui suivirent la publication de l’appel d’offres, et alors même que la construction des données sur le terrain était en cours, la publicité faite par les commanditaires autour de cette étude prenait progressivement une voie singulière. Elle s’écartait, à n’en pas douter, de la distante critique qui était adoptée dans l’enquête par rapport aux discours prophétiques accompagnant alors tout ce qui avait trait au numérique. Ainsi, l’appel d’offres changeait de titre, passant de « Usages et représentations des nouvelles technologies en bibliothèques » à celui, plus engagé, de « Étude des enjeux de l’informatisation des bibliothèques françaises pour la démocratisation des accès au livre ». Les analyses conduites dans cette étude amenaient alors plutôt à conclure que les technologies numériques étaient évaluées, mises sous observation et domestiquées avec pragmatisme par la plupart des usagers des bibliothèques. Mais il devenait progressivement évident que les usages potentiels ou attendus de ces technologies intéressaient sans doute plus les commanditaires que leurs appropriations effectives.
Le contexte de l’époque était certes particulier puisque l’informatisation progressive (ou, selon les cas, la ré-informatisation vers le multimédia) des bibliothèques publiques soulevait nombre de débats au sein de la communauté des bibliothécaires. En témoignent les titres des numéros de l’une de leur principale revue, le Bulletin des Bibliothèques de France : « L’écrit entre l’imprimé et l’électronique » (1996), « La bibliothèque électronique » (1997), « Droit et ressources électroniques » (1998) ou encore « Informatique et bibliothèques, réseaux et catalogues » (1998). « L’irruption » d’Internet, son effet sur les missions des bibliothèques et sur la circulation des savoirs y étaient souvent commentés par les contributeurs de cette revue professionnelle de référence. Parfois en des termes prophétiques, il en sera question un peu plus loin, mais également en des termes plus mesurés et pragmatiques, autour des problématiques de choix de progiciels, de constitution de fonds de documents électroniques ou de définition de standards.
Quoi qu’il en soit, les données produites par le Direction du Livre et de la Lecture en 1996 dans L’équipement des bibliothèques municipales et départementales montraient que les bibliothèques municipales de villes de moins de 20 000 habitants, jusqu’alors peu dotées en équipements informatiques à destination des usagers, tendaient à s’équiper à un rythme accéléré. Les plus grands équipements, implantés dans les villes de plus de 100 000 habitants, quant à eux, étaient tous informatisés et réfléchissaient aux moyens de renouveler la gestion de leurs collections et leur diffusion grâce aux deniers progrès des télécommunications. Ainsi, la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) conduisait un grand nombre d’études sur ces questions, dont celle dont il est question ici.
La fondation de la Bibliothèque Nationale de France (BnF) constitue à bien des égards une illustration frappante des enjeux idéologiques cristallisés autour de l’introduction du numérique dans le monde des bibliothèques. Au moment de l’étude décrite ici, la bibliothèque de recherche du site François Mitterand (Tolbiac), qui venait d’ouvrir au public, connaissait des conflits sociaux et des difficultés techniques de fonctionnement. Une grave défaillance du système informatique, survenue à peine quelques jours après l’ouverture aux chercheurs, allait durablement entraver le fonctionnement de cette « Très Grande Bibliothèque » pourtant conçue pour intégrer au cœur de ses services les avancées les plus récentes du numérique.
Paradoxalement, alors que la numérisation progressive des fonds et leur archivage électronique autorisaient la consultation potentielle de notices et documents aux lecteurs du monde entier, la bibliothèque de recherche du site François Mitterrand tourna au ralenti pendant des mois, l’informatique peinant à gérer le système qui permet d’acheminer les ouvrages depuis les immenses réserves jusqu’aux demandeurs.
A priori trivial et passager, ce paradoxe a cristallisé durant plusieurs mois toutes les critiques qui se concentraient autour du projet BnF. On reprochait à ce projet son gigantisme (dans son discours du 14 juillet 1988, François Mitterrand disait vouloir pour la France « la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde »), son implantation, ses coûts, mais aussi et surtout ses hésitations. Les débats entre professionnels de la lecture publique, les chercheurs concernés et les décideurs politiques sur la pertinence de la césure entre les collections antérieures et postérieures aux dates de 1945 ou 1960 étaient vifs.
Fallait-il donner accès aux fonds anciens de la Bibliothèque Nationale jusqu’alors conservés sur le site Richelieu ? Si non, pourquoi en ce cas ouvrir de si grands espaces de consultation au public ? Par delà les traditionnelles tensions entre les missions de conservation et de diffusion des fonds, inhérentes à toute bibliothèque, la question était de savoir quel type de démocratisation culturelle on souhaitait privilégier : renforcer les pratiques savantes et lettrées des publics « traditionnels » de Richelieu en leur offrant des espaces et services modernisés, ou plutôt tenter d’élargir l’assise des publics de l’institution BnF en les décloisonnant socialement et en les rajeunissant. Dans le doute, le choix a été de voir grand, comme le résumait François Stasse en 2002 :
« Mais alors, s’il ne s’agit pas d’accéder aux fonds anciens de la BN, pourquoi construire ces espaces grands publics dans la BN ? Il n’y a jamais eu de réponse satisfaisante à cette question élémentaire. En revanche, elle révèle un monumental non-dit : en France, et en France exclusivement, on croit toujours que c’est par des opérations prestigieuses de l’Etat, de préférence situées à Paris, que l’on réalise la promotion du peuple. ».
Les chercheurs accrédités ont donc eu accès soit à la Bibliothèque de recherche en rez-de-jardin du site Tolbiac (conservant la production française imprimée depuis les débuts de l’édition, et, depuis le début du XXe siècle, les documents sonores puis audiovisuels et multimédia), soit à l’ancien site Richelieu (conservant les livres manuscrits, le fonds arts du spectacle, les cartes et plans, les estampes et photographies, les monnaies, médailles et antiques). Une bibliothèque d’étude est venue compléter ce dispositif en proposant au public, dans les hauts de jardin, dix salles de lectures.
En triplant la surface occupée par la Bibliothèque Nationale, et par conséquent le budget de fonctionnement qui lui était précédemment alloué, il s’agissait d’élargir le cercle des publics traditionnels de cette institution et de faire une place au « grand public ». Un « grand public » que l’on assimile alors bien souvent à un « public de masse » aux pratiques supposément ancrées dans la culture jeune, du divertissement ou de l’image. Les responsables de bon nombre de bibliothèques publiques, et singulièrement ceux de la plus prestigieuse d’entre elles, envisagent leurs actions comme tendant à résorber cette supposée opposition, décrite par Adorno et Horkheimer dans La dialectique de la raison, entre une culture « gardienne des valeurs de la société »58 et une culture de masse, conformée par des industries culturelles.
Ainsi, le fait d’implanter, dans les hauts de jardins du site Tolbiac, une bibliothèque d’étude plutôt qu’une médiathèque ouverte à des publics plus variés (familiaux, par exemple) traduit les limites que l’État fixe à la BnF. Il s’agit de permettre aux lecteurs les plus légitimes de s’extraire de l’uniformisation liée à la « montée des masses », et plus précisément aux effets contrastés de la massification de la lecture, pour conserver les moyens de diffuser une culture écrite échappant aux industries culturelles. De fait, l’augmentation du niveau d’études moyen, l’industrialisation de l’édition, l’accroissement constant du volume des publications et des ventes de livres sont allés de pair avec une baisse tendancielle des intensités de lecture et une diversification des pratiques de lecture faisant craindre aux milieux de la culture et de l’éducation une « crise de la lecture ».
Dans un tel climat d’incertitudes sur le statut de la lecture en tant que pratique culturelle et de tensions institutionnelles et médiatiques, on comprend mieux pourquoi l’enquête dont il est question ici comportait des enjeux dépassant de très loin le cadre d’une étude des publics et de leurs pratiques en matières documentaire et technologique. Il s’agissait, pour les commanditaires, de démontrer les effets de démocratisation culturelle de politiques publiques usant de la force intrinsèque du numérique pour convertir un grand nombre d’usagers aux pratiques savantes de la lecture, ou tout au moins aux plus légitimes d’entre elles : recherches bibliographiques, consultation d’ouvrages scientifiques ou littéraires, de catalogues et de bibliothèques numériques, etc.
Le fait que la plupart des études sur les publics des bibliothèques usaient alors de méthodes qualitatives centrées sur les usagers des « nouvelles » technologies tendaient à renforcer l’idée qu’il existait des groupes d’usagers « experts en numérique ». Ces derniers auraient la particularité de développer des usages savants de l’informatique en bibliothèques, et constitueraient, tout au moins, de « bons usagers », réputés curieux et respectueux des dispositifs mis à leur disposition par l’institution.
En centrant les analyses sur les questions d’innovation et de diffusion, les auteurs de ce genre d’études centraient les observations sur les usages constatés des premiers dispositifs numériques mis à la disposition des publics des bibliothèques, en oubliant bien souvent de les caractériser en continuité ou en rupture par rapport aux autres offres documentaires. Tout usager des technologies numériques était alors perçu comme un pionnier, témoin de pratiques vouées à se généraliser.