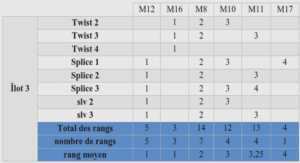Notions de Base de la composante interculturelle
Pour mieux axer et mieux comprendre l’étude sur la CI, il est nécessaire d’expliciter les trois notions : langue, culture et interculturalité.
La langue
Selon Saussure , la langue est « un trésor social », inculquée à l’individu par la société qui l’entoure (famille, école, etc). La langue n’est pas une création personnelle, c’est un « héritage « . Pour pouvoir s’exprimer, l’individu doit respecter certaines règles (ordre des mots dans la phrase, par exemple) qu’il ne peut modifier de son propre chef, sous peine de brouiller la communication avec autrui. Une langue maternelle (LM) s’acquiert implicitement dans la vie courante car «aucun trait de civilisation n’existe indépendamment d’elle » . Cela s’explique par le fait que l’enfant qui commence à parler a tout un fond de réserve surprenant de termes sans qu’il ait appris l’alphabet, du fait que ses cinq sens lui donnent la faculté d’assimiler la langue, cela grâce à des habitudes environnementales et à l’observation. Quant à la langue étrangère, il faut l’apprendre à travers différentes approches : bains linguistiques, entretiens, lectures, contacts culturels, … Tous les hommes, natifs ou étrangers, ont besoin de la langue pour communiquer. C’est pourquoi il faut l’acquérir suivant les normes sociales ou culturelles car elle se caractérise aussi par le fait d’être, non pas un savoir-faire, non une connaissance, mais une pratique. La langue, par conséquent, que ce soit maternelle ou étrangère est une forme de culture et renferme toute une culture.
La culture
L’ethnologue Edward Tylor désigne par culture: « ce tout complexe qui comprend la connaissance, la croyance, l’art, les mœurs , les coutumes et tous les autres talents et habitudes acquis par l’homme en tant que membre d’une société. » André de Peretti confirme cette définition en disant que : « La culture, c’est l’ensemble de systèmes de compréhension, d’interprétation que les individus peuvent avoir et qui leur permet de rester en contact entre eux ainsi qu’avec le monde extérieur que leur activité motrice et physique contribue à modifier ». C’est ce qui nous conduit à élaborer de nouvelles connaissances et à chercher à les impliquer dans notre mode de vie. En effet, derrière les interactions sociales, derrière la routine du quotidien circule une expérience muette de la société. A travers le désordre apparent du quotidien se manifeste l’adhésion de chacun à la communauté à laquelle il appartient, c’est-à-dire qu’il existe tout un système culturel qui fait vivre la société et l’individu.
Les livres, que ce soit des manuels scolaires ou des livres d’images pour enfant, sont véhiculaires de diverses cultures dans la mesure où leurs auteurs ne peuvent s’éloigner d’une quelconque société pour s’inspirer. Ainsi, l’environnement social contribue toujours à faire de l’individu un homme complet dans la mesure où tout son être, physique et mental, est éduqué suivant la culture de cette société. La lecture de la BD qui reflète la vie d’une société est un moyen de s’approprier cette culture car elle n’est autre que sa copie (c’est le « remake » en image de la vie quotidienne).
Par ailleurs, parler de la culture suppose la connaissance d’une langue. Que ce soit LM ou LE, il faut savoir l’utiliser pour comprendre la civilisation qui en découle. Ainsi, ces deux notions (Langue – culture) sont indissociables dans la mesure où la langue est un outil véhiculaire de la culture. Elles sont interdépendantes dans un système où chacune d’elles constitue un élément faisant le tout social qui reflète les phénomènes d’interculturalité. Cette interdépendance langue – culture va amener à définir ce qu’est l’intercuturalité.
L’interculturalité
a. Définition :
Patrick Charaudeau conçoit que « L’interculturel est la perception qu’une communauté se construit sur une autre communauté ». A partir d’observations, de contacts directs ou indirects (les médias, le cinéma, etc.) entre deux groupes, chacun se donne une représentation de l’autre qui ne coïncide pas nécessairement avec celle que chaque groupe se donne de lui-même. Donc, étant une valeur communément admise dans l’état actuel de la mondialisation, l’interculturalité peut se définir comme la mise en contact de deux ou plusieurs cultures. Le terme contact peut suggérer un investissement de part et d’autre des deux groupes culturels; c’est-à-dire que chacun cherche à connaître et à comprendre la culture de l’autre pour finalement arriver à faire valoriser sa propre culture. L’enjeu serait sur ce point l’identification et/ou l’autonomie personnelle. Identification dans la mesure où le contact des deux cultures provoque un besoin tel que l’appartenance ou la référence ; autonomie car ce contact entraîne l’harmonie entre les deux groupes.
« L’interculturalité n’est pas le développement séparé de groupes qui cultivent dans leur coin une identité culturelle dont ils surestiment toujours l’originalité. C’est au contraire une notion qui implique la rencontre, le partage, et inévitablement la transformation des identités culturelles en présence. Il est possible que cela fasse craindre à certains de perdre de ce qu’ils croient être le caractère original et unique de leur culture. Mais les sciences humaines ont montré depuis longtemps que toute culture se construit à partir d’emprunts à d’autres cultures et que son dynamisme créateur est toujours lié au syncrétisme dont elle se nourrit. Les cultures qui refusent l’échange et le mélange se sclérosent et finissent par ne plus reposer que sur la dangereuse volonté de maintenir leur pureté originelle » .
La mondialisation favorise cette interculturalité, car tout Etat cherche à se placer sur l’échelle planétaire et à valoriser sa propre culture. Chacun vit donc, sans savoir et cela malgré lui, les concepts de base de ce phénomène . Deux phénomènes interculturels existant dans la société sont à comprendre: l’enculturation et l’acculturation.
b. Les phénomènes interculturels :
➤ L’enculturation :
D’après Carmel Camilleri, l’enculturation (ou « endoculturation ») est « l’ensemble des processus conduisant à l’appropriation par l’individu de la culture de son groupe. L’enculturation n’est qu’un aspect et ne livre qu’une partie d’un processus plus général, celui de la « socialisation », par lequel l’individu est mis en relation avec l’ensemble des significations collectives dudit groupe, […], dans la mesure où elles lui ont été « présentées » (par l’intermédiaire de la famille, l’école, et autres voies et moyens formels et informels existant dans le groupe). » .
La socialisation est une sorte de curriculum amenant l’individu à s’adapter au mode de vie d’un groupe culturel. Les représentations et les significations de ce groupe sont devenues siennes, c’est-à-dire qu’il a les mêmes points de vue, les mêmes jugements que lui. Cela se traduit par l’ancrage ou l’attachement à sa propre culture. Une forte enculturation peut provoquer un repli sur soi car l’individu ne peut ou ne veut s’ouvrir sur d’autres cultures. Il s’ensuit qu’il portera toujours des jugements de valeur (parfois négatifs) sur ce qui ne lui appartient pas. En effet, comme dit Hugues de Varine, « La coexistence de modèles contradictoires crée des conflits, multiplie les sources d’incompréhension et accentue les sentiments d’instabilité et d’incohérence. » . C’est une sorte d’insécurité culturelle qu’on peut définir comme une sorte de malaise par rapport au comportement d’un individu face à d’autres cultures (par exemple, la non-maîtrise d’une langue dite seconde.) .
➤ L’acculturation :
« C’est l’ensemble des phénomènes résultant du contact direct et continu entre des groupes d’individus de cultures différentes, avec des changements subséquents dans les types de culture originaux de l’un ou des deux groupes. » Parler d’acculturation suppose de ce fait un changement de mentalités, de points de vue et de jugements voulu par l’individu.
c. Faire face à l’interculturalité :
L’emploi du Français comme langue d’enseignement à Madagascar met, obligatoirement, l’élève en contexte interculturel. Pour réduire les effets d’interférences culturelles (superposition de cultures pouvant provoquer des situations embarrassantes), l’école a pour rôle d’offrir une éducation à l’interculturalité. Cela est relaté dans l’objectif du programme scolaire .
L’école doit aussi considérer les stratégies en éducation culturelle. C’est-à-dire viser à l’intercompréhension entre les cultures car l’objectif est d’ « offrir la culture à tous les hommes pour leur faire aimer la vie » . Cela sous-entend la démocratisation de la culture étrangère pour que tout le monde soit en mesure de l’acquérir. Faire créer des BD à chaque niveau scolaire, en plusieurs langues, par exemple, se révèle une approche d’ouverture culturelle. Il ne saurait y avoir de véritable ouverture sans un partage et un échange de valeurs (langue, culture) entre deux groupes différents.
Pour atteindre l’objectif des quatre compétences, le savoir, le savoir-faire, le savoir être et le savoir devenir, une étude scientifique de l’interculturalité est nécessaire. En effet, les connaissances interculturelles s’acquièrent à travers une démarche intellectuelle logique dans la mesure où « la pédagogie interculturelle peut devenir un instrument de lutte contre l’échec scolaire » . Dans ce sens, la taxonomie de Louis d’Hainaut sur l’enseignement / apprentissage de la langue met en exergue la compréhension, la communication et la production : comment déchiffrer les signes? S’articulent-ils de la même façon ? Par quel moyen les communiquer aux autres?
Le savoir-faire est une pratique de compétence qui consiste à adopter des objectifs pour connaître d’autres cultures. Par exemple, lire la BD dans l’objectif de récolter des informations ou tout simplement se détendre. Avoir toujours des objectifs devant un tel document développe chez l’élève la capacité d’élaborer une relation d’entente entre sa propre culture et celle des « autres ». Cela signifie savoir s’imprégner de la culture étrangère. Le savoir-être consiste à avoir une attitude comparative face à deux cultures différentes. Pour dépasser toute forme de préjugé, il faut analyser leur convergence et accepter leur divergence si celle-ci existe.
Enfin, la capacité de gérer la pratique des connaissances acquises qui relève du savoir-devenir fait du scientifique un chercheur qui s’adaptera à toute sorte de situation. En conclusion, le chapitre a permis de comprendre que l’interculturalité est une situation à vivre non pas à apprendre. L’acquisition d’une LE oblige à une situation interculturelle inévitable car les connaissances résultent des échanges entre deux ou plusieurs cultures différentes.
Introduction |