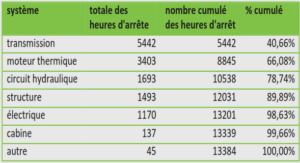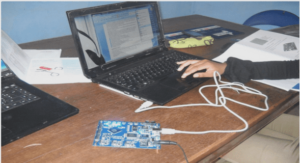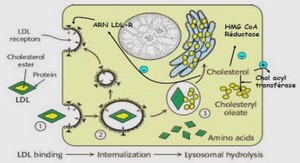Notion de fonctions et de fonctionnalités écologiques
La notion de services écosystémiques
Historique
La notion de services écosystémiques est apparue dans les années 1980 sous l’impulsion de biologistes de la conservation de la Nature, tels que Ehrlich et Mooney (1983), afin d’attirer l’attention au niveau mondial sur la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. A la fin des années 90, le concept s’est considérablement enrichi grâce aux travaux économiques de Costanza (1997) et de Daily (1997), avec le développement de l’économie écologique, intégrant notamment les paiements pour les services écosystémiques (évaluation économique). Mais cette notion de services écosystémiques a véritablement pris de l’ampleur suite à la Notion de fonctions et de fonctionnalités écologiques
En bon état de santé, de vitalité et de conservation et avec un aménagement et un 5 publication du Rapport sur l’Évaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (ou MEA pour Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005)), puis dans un second temps avec plusieurs initiatives récentes telles que la démarche TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), la plateforme IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services) ou des rapports institutionnels comme celui de la FAO. Maintenant popularisé, ce concept souligne la dépendance du bien-être humain envers les écosystèmes.
Il a très vite servi de support théorique à des études sur les relations entre la biodiversité à différentes échelles et les sociétés qui en dépendent. Cette notion de services écosystémiques a permis de développer une nouvelle approche interdisciplinaire où la gouvernance socio-économique et la connaissance des processus environnementaux sont interconnectées (Martinez-Harms et Balvanera, 2012 ; Vihervaara et al., 2010 cité par Monnerie, 2016).
La typologie des services écosystémiques
La notion de services écosystémiques se définit comme étant les « bénéfices que l’homme tire des écosystèmes » autrement dit tous les biens et les services générés par les écosystèmes qui contribuent, directement ou indirectement, au bien-être des humains (Monnerie, 2016). Aujourd’hui, face aux changements globaux, l’identification et l’évaluation des services écosystémiques deviennent un réel enjeu. Ces derniers se répartissent en quatre catégories (figure 1) telles que : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de support ou d’entretien (Monnerie, 2016).
Les services d’approvisionnement
Ces services rassemblent les ressources matérielles (ou biens écosystémiques) fournies par les écosystèmes aux humains : plantes consommées, sauvages et cultivées, poissons, gibier et animaux d’élevage, eau potable (donc nappes phréatiques et cours d’eau oligotrophes), bois de chauffage, fibres textiles, substances pharmaceutiques, etc. Ils incluent les espèces à l’origine de futurs médicaments et les populations sources de nouvelles variétés génétiques, précieuses au plan agronomique (Couvet et Couvet, 2010). Ces services conduisent à des biens « appropriables » qui peuvent être autoconsommés, échangés tels quels ou transformés, ou mis en marché. Ces ressources ont une valeur marchande, ce qui est plus rarement le cas des catégories suivantes (Ngom, 2014).
Les services de régulation Ils matérialisent la capacité à moduler dans un sens favorable à l’homme des phénomènes comme le climat, en l’occurrence et l’ampleur des maladies (humaines mais aussi animales et végétales) ou différents aspects du cycle de l’eau (crues, étiages, qualité physico-chimique), ou à protéger d’événements catastrophiques (cyclones, tsunamis, pluies diluviennes) ; contrairement aux services d’approvisionnement, ces services de régulation sont généralement non appropriables et ont plutôt un statut de biens publics (Chevassus-au-Louis et al., 2009). – Les services culturels Ils renvoient aux différentes valeurs de non-usage qui peuvent être attribuées aux milieux naturels et cultivés (valeurs récréatives, esthétiques, éducatives, spirituelles ou encore morales).
Les services de support Les services d’appui, d’entretien ou de support, communément appelés fonctions de base ne sont pas directement utilisés par l’homme mais conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes, à court terme mais également dans leur capacité d’adaptation à long terme : capacité de recyclage des nutriments, pédogenèse (formation des sols à partir de la roche mère), importance de la production primaire comme premier maillon des chaînes alimentaires, résistance à l’invasion par des espèces étrangères, etc. (MEA, 2005).