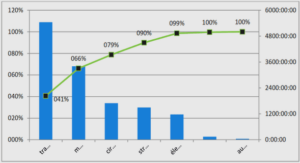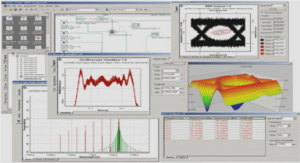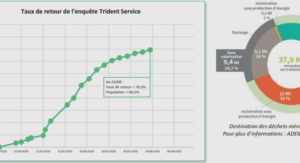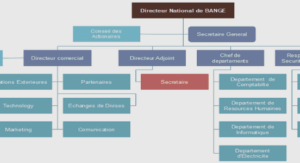La charte-partie un document normatif qui permet la convergence
Pourquoi conclure une charte-partie au voyage ?
Le terme « charte-partie » ou « charter-party », en anglais, résulte d’une pratique historique de l’affrètement maritime. À l’origine, ce document de transport n’était rédigé qu’en un seul exemplaire, il était ensuite coupé en deux, au moment du voyage, afin que chacune des parties détienne la moitié du contrat original. De nos jours, cette tradition historique n’existe plus mais le terme de charte-partie symbolise toujours un engagement qui, dans le cadre du transport maritime, prend la forme d’un contrat, conclu de gré à gré, entre un fréteur, un propriétaire de navire, le plus souvent un armateur, et un industriel qui souhaite exporter ses produits par voie maritime que l’on appelle un affréteur. Rappelons s’il était besoin que, dans ce travail, nous ne nous intéressons qu’à l’affrètement au voyage97, mieux connu sous l’appellation « tramping » en anglais. Concrètement, on parle d’affrètement au voyage lorsque le transporteur, qui peut être un armateur ou un opérateur, met à disposition un navire pour un itinéraire précis et à une date donnée, afin de déplacer un type de cargaison bien défini, le temps d’un unique voyage. Il ne s’agit donc pas pour l’affréteur d’une location de navire puisqu’il n’en assure ni la gestion nautique, ni la gestion commerciale, mais bien d’une prestation de service qui prend la forme d’un déplacement entre deux ports.
La charte-partie au voyage est donc un document contractuel spécifique à l’affrètement au voyage98 99 et dont la fonction première est de vendre des « unités de temps » (Sow 2013 ; Karimi 2016), dans un cadre normalisé qui inscrit la transaction dans une référence temporelle commune pour les parties prenantes (Elias 1996). Ces unités temporelles correspondent à la durée de mise à disposition de tout ou partie d’un navire à l’affréteur dans ces différentes attentes, notamment le temps de chargement, le temps du transport et le temps du déchargement. Les périodes de chargement et de déchargement doivent être évaluées avec précision car une redevance portuaire est calculée en fonction de la durée de présence du navire dans le port pour effectuer les diverses options de manutention de la marchandise à son arrivée et/ou à son départ du navire. On nomme tous ces éléments des staries ou encore « jours de planche » en français et « laytime » en anglais. Ils s’expriment le plus souvent sous la forme de cadences à respecter au moment du chargement et du déchargement de la marchandise– par exemple 300 tonnes à l’heure.
La liberté contractuelle est totale car il n’y a pas de convention internationale régissant ce type de contrat (Montas 2010, p.3). Par conséquent, en l’absence de règles impératives, les clauses sont, de fait, supplétives et résultent de la négociation entre les parties : « mis à part respecter les standards internationaux, tout peut se faire, on peut tout imaginer ! Tant que les parties sont d’accord » déclarait à ce sujet un courtier d’affrètement de vrac sec lors d’un entretien.
Ce document contractuel a pour but de fixer le niveau de responsabilités de chacun des protagonistes en présence. Le courtier d’affrètement maritime est l’acteur central de cette transaction puisqu’il va se retrouver, dans cette configuration d’affrètement au voyage, à l’interface de l’offre et de la demande de transport, les deux parties ne traitant jamais directement. La mission première du courtier d’affrètement consiste donc à gérer une forme de pression du temps (Bobot 2008) en termes de coûts et de délais afin de parvenir à faire converger les deux parties inscrites dans une négociation bilatérale, dans un sens jugé souhaitable par chacune d’elles. Pour ce faire, le courtier est le garant de l’acceptation mutuelle par les acteurs des différents éléments composant la charte-partie. Plusieurs entretiens auprès d’affréteurs ont confirmé que la médiation et le rôle de conseiller figurent parmi les principaux attendus de la relation de courtage.
« C’est le médiateur de ce que veut l’un ou l’autre, il trouve le point moyen ! C’est le broker qui légalise le contrat, il va être payé pour le faire par écrit, dans le cadre d’une charte partie, sa plus-value c’est du conseil ! » Analyste de fret dans un grand cabinet de négoce de matières premières, entretien réalisé le 16/03/2017.
Si l’on considère que l’aboutissement d’une négociation équivaut à la production de normes communes par les parties en présence, il est possible de distinguer deux manières d’y parvenir (Volckrick 2009, p. 138) : soit en important un modèle extérieur, soit par la co-construction pleine et entière des acteurs. Nous considérons que l’usage obligatoire et systématique de la charte-partie au voyage, dans ce type d’affrètement, nous place d’emblée dans la perspective de recourir à un modèle dans lequel certaines règles sont déjà préalablement établies, ce qui a pour effet d’induire et de borner les interactions futures. Le courtier d’affrètement maritime cherche alors à guider les parties afin de matérialiser une coprescription (Hatchuel 1997) au sein de la relation d’échange.
Les protagonistes se retrouvent alors en situation de pouvoir coordonner leurs actions par le dialogue à partir d’une norme de reconnaissance mutuelle et d’une identité pratique (Tully 2001), favorisant l’inter-reconnaissance. Ainsi, cet usage systématique nous place délibérément dans une configuration normée (Habermas 1992) de la négociation de transport qui s’inscrit, bien au-delà d’une simple diffusion de règles dans une véritable réponse processuelle à la négociation (Zartman 2014, p. 166). Les différentes clauses de la charte-partie doivent plutôt être considérées comme un outil de gestion microéconomique du risque logistique dans la mesure où elles permettent de déterminer, contractuellement et avec précision, les conditions du voyage. En outre, elles apportent un rééquilibrage dans l’asymétrie d’information initiale, vis-à-vis de l’affréteur dont le transport maritime n’est pas le cœur d’activité, en règle générale.
S’engager sur des dispositions en partie normées a pour fonction d’orienter et définir les termes en amont de tout processus de décision. La charte-partie offre donc un cadrage aux acteurs qui leur permet de mieux se situer. Ceci est propice aux futures négociations (Moncourrier 2006) mais favorise également la résolution de problèmes qui peuvent survenir dans des situations complexes (Touzard 2006). Ce document central a fait l’objet d’une procédure de normalisation dans le courant du XXème siècle. Une instance internationale a joué un rôle particulièrement actif dans le processus de standardisation des contrats de transports maritimes internationaux.
Normalisation des contrats de transport au voyage
Loin d’un simple cadrage historique nous considérons qu’analyser la normativité contractuelle, c’est avant tout reconnaître qu’elle exprime un choix de l’acteur social (Belley 1996, p. 467) ; il est donc indispensable d’étudier le contexte de son élaboration.
Le « Baltic and International Maritime Council » (BIMCO) a joué un rôle prépondérant dans la normalisation des clauses de la charte-partie. Fondé en 1905, dans un contexte de très forte structuration du secteur de l’armement au niveau international (Borde 2006) qui souhaitait, notamment dans le cadre du tramping, pouvoir se coordonner afin de réguler les pratiques d’affrètement (Bekiashev et Serebriakov 1981, pp. 10-11), le BIMCO a le statut d’association ainsi que d’organisation non gouvernementale, admise à titre consultatif auprès de l’Organisation Maritime Internationale. Il a, en outre, pour mission de faciliter les opérations commerciales à l’échelle internationale. Réunissant la plupart des grands acteurs maritimes mondiaux, principalement des armateurs, il va très rapidement proposer des « contrats type », utilisés au niveau mondial (Chaumette 2005, p. 180) pour l’ensemble des types d’affrètement et des types de cargaisons.
Avec environ 2000 membres représentatifs des secteurs de l’armement de la logistique industrielle et portuaire et du courtage, répartis dans plus de cent pays, le travail initié par le BIMCO peut se concevoir comme une politique internationale de normalisation, menée à bien par un consortium d’acteurs privés (Dudouet, Mercier et Vion 2006, p. 382) qui ont des intérêts communs dans l’industrie du transport maritime. L’avènement de ces chartes-parties types participe à l’harmonisation des pratiques et des conditions d’affrètement au niveau mondial. Surtout, il renforce la facilitation de la transaction fréteur/affréteur. En effet, les principaux modèles de charte-partie au voyage sont pour la majorité spécifiques à un certain type de marchandise transporté100 (grain, charbon, pétrole…) (Damien 2010, p. 110). Retracer brièvement ce processus de normalisation ne saurait faire oublier que, bien que standardisée, la charte-partie demeure un contrat individuel, réputé libre, le temps d’un voyage et pour un itinéraire précis (Dusserre 1988, p. 22). Dans cet univers normalisé, les courtiers d’affrètement maritime gardent donc un rôle prudentiel très important.
La plupart des chartes-parties compte entre vingt et quarante pages, selon les particularités énoncées durant les négociations. Il existe autant de modèles de chartes-parties au voyage qu’il y a de type de marchandises à transporter. Ainsi, selon les spécificités de celles-ci, des clauses particulières peuvent figurer. Par exemple, pour le transport de gaz, il est fait mention de la pression et de la température de conservation à bord ce qui ne sera pas le cas pour le transport de colis lourds. L’évolution de la réglementation maritime peut également avoir un impact important sur la suppression, l’ajout ou la modification de clauses déjà existantes101. Cependant, il est possible d’identifier des éléments transversaux qui viennent structurer l’ensemble des modèles de chartes-parties, à l’heure actuelle.
Dans l’immense majorité des cas, ce document contractuel est divisé en deux. Une première page, synthétique, donne le cadrage général du voyage et répertorie l’ensemble des informations cruciales de ce dernier, autour d’une vingtaine de points. La figure suivante est un extrait du modèle de charte-partie SYNACOMEX correspondant à un contrat type d’affrètement au voyage de céréales. Ce modèle est largement utilisé pour l’exportation de grains, notamment en France, son nom provient d’ailleurs de l’abréviation de Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales (SYNACOMEX). Ce modèle de charte-partie est également très répandu dans les autres pays du sud de l’Europe et les pays d’Amérique du Nord102.