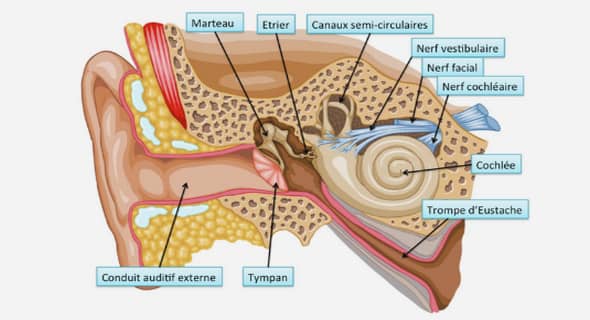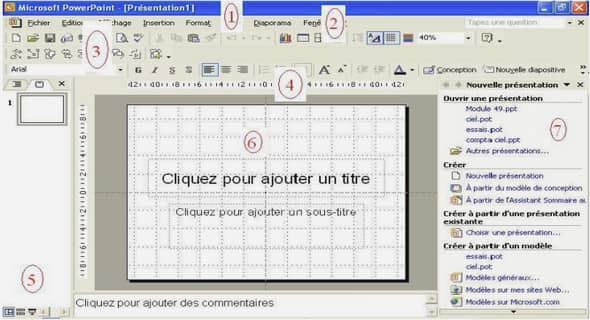Mutations du système de santé et logique de parcours
Design général de la recherche
Nous exposons dans la section qui suit notre démarche de recherche et une synthèse des méthodes que nous avons utilisées, afin de combiner différents niveaux d’analyse : le niveau micro-territorial grâce à l’étude du déroulement des prises en charge de patients, le niveau méso-territorial à travers le suivi du déploiement des projets précités (à l’exception de l’observatoire), et le niveau macroterritorial (régional), dédié à l’analyse de l’observatoire et du pilotage des projets par l’ARS. Pour l’un des projets, l’accompagnement a donné lieu à une intervention, au sens d’une co-construction avec les acteurs de terrain du cadre et des éléments de réponse à leur problématique (Perez, 2008). Le cadre général : une recherche-intervention articulée autour de l’accompagnement et de l’évaluation de plusieurs projets Présentation de la démarche de recherche La logique de parcours promue par les pouvoirs publics est porteuse d’un projet de transformation des modes de prise en charge des patients, qui s’ancre dans des lieux d’expérimentation de cette transformation, et dans des initiatives tels que le programme e-parcours ou les expérimentations de l’article 51. La concrétisation de cette nouvelle logique se prête donc bien à la mise en place d’une démarche de recherche-intervention que David (2012) définit comme l’aide que le chercheur apporte sur le terrain, pour « concevoir et mettre en place des modèles et outils de gestion adéquats, à partir d’un projet de transformation plus ou moins complètement défini » (p. 133). Elle repose sur un processus interactif entre les acteurs de terrain et les chercheurs, qui permet d’éclairer les représentations sous-jacentes aux pratiques des acteurs et qui offre la possibilité à ces derniers, s’ils le souhaitent, d’enclencher des transformations de leurs pratiques, grâce à une perception plus claire de leur mode de raisonnement actuel et des marges de manœuvre dont ils disposent (Hatchuel et Mollet, 1986, Moisdon, 2015). En l’occurrence, il s’agissait d’aider l’ensemble des acteurs – ARS et professionnels -, à analyser leur fonctionnement actuel et à imaginer les modalités de conception et de gestion des parcours répondant aux besoins des patients. La mise en place de cette démarche toujours en cours a suivi les étapes classiques décrites dans la littérature (Moisdon, 2015, Aggeri, 2016). Les questionnements initiaux A l’automne 2018, la Direction de la Stratégie de l’ARS d’Ile-de-France a sollicité le CGS afin qu’il réalise une évaluation des effets du projet e-parcours sur l’organisation territoriale des parcours. L’objectif était de mesurer non seulement l’impact du déploiement de la plateforme numérique Terr-esanté sur les pratiques de coordination des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social, mais également de comprendre comment la logique de parcours, qu’elle était réputée appuyer, conduisait à re-dessiner les modalités de prise en charge des patients. La question était formulée de manière assez générale car les territoires expérimentateurs du programme e-parcours avaient été choisis entre six et douze mois plus tôt, et certains acteurs à l’Agence estimaient qu’il fallait d’abord consolider la mise en place du projet dans les territoires et développer l’usage de Terr-esanté, avant d’aborder la question des effets. Une interrogation ne semblait en outre pas véritablement tranchée au sein de l’Agence : le programme e-parcours était-il un projet centré sur le déploiement d’un outil numérique destiné à soutenir les efforts de coordination des acteurs, ou devait-il être considéré comme le support d’une organisation territoriale dédiée à l’amélioration de la gestion des parcours de santé ? Dans le premier cas, le programme avait vocation à s’inscrire dans une temporalité précise, avec un début et une fin, et la question de l’usage de Terr-esanté s’imposait au premier plan de l’évaluation. Dans le second cas, le programme devait être pérenne, et la place du numérique apparaissait secondaire et, en tous les cas, déduite du diagnostic sur les problématiques d’organisation des parcours sur les territoires. L’ARS souhaitait également être conseillée dans la manière de piloter le projet e-parcours, dans un contexte où elle avait décidé de « donner la main » aux professionnels de terrain pour mener à bien son déploiement. Le questionnement de la Direction de la Stratégie portait sur les implications pour les professionnels et les différents niveaux hiérarchiques de l’ARS – siège et délégation départementale (DD) – de cette délégation : comment les uns et les autres allaient-ils s’en saisir, et comment le siège de l’ARS pouvait-il accompagner les DD, les chefs de projet e-parcours et les professionnels ? Une deuxième sollicitation a été exprimée au premier trimestre de l’année 2019, relative à l’action des dispositifs d’appui à la coordination (DAC), dans le contexte de la préparation de leur fusion, prévue par le plan Ma Santé 2022 et actée dans la loi du 24 juillet 2019. L’objectif de la fusion, qui s’accompagnait de l’élargissement des missions des dispositifs d’appui à l’accompagnement de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur pathologie, était d’offrir aux professionnels un interlocuteur unique pour répondre à des demandes d’informations et d’orientation de leurs patients, aider à la prise en charge des parcours des patients en situation complexe et participer à la réflexion territoriale sur la gestion des parcours (conformément aux trois missions définies en juin 2020 dans le cadre national d’orientation sur l’unification des dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes). A l’ARS d’Ile-de-France, la mise en œuvre de la stratégie régionale de convergence des dispositifs d’appui était confiée à une mission placée au sein de la direction de la stratégie. Sa responsable a demandé à l‘équipe de recherche de proposer une évaluation de l’impact des dispositifs d’appui sur la prise en charge des patients et sur l’animation de leur territoire, afin d’affiner la stratégie de convergence et de préciser l’articulation des dispositifs d’appui et des autres acteurs territoriaux en charge des parcours et participant à l’animation territoriale. Là encore, la question était formulée de manière large, afin d’alimenter la réflexion de la mission sur des points « difficiles » : visibiliser le rôle d’un acteur – le dispositif d’appui -, dans l’évitement de difficultés, voire de ruptures de parcours (ce qui est plus compliqué que d’identifier des ruptures avérées) et étayer la connaissance de l’Agence sur les liens en cours de construction au sein du paysage touffu des acteurs réputés jouer un rôle dans l’organisation des parcours (CPTS, GHT, DAC, etc.).
L’aide à la reformulation des enjeux, des problématiques et de la démarche d’accompagnement
Chacune de ces sollicitations a été « retravaillée » entre l’Agence ou l’observatoire et l’équipe de recherche, afin de préciser les enjeux et problématiques dont elle était porteuse, et proposer une nouvelle formulation du questionnement et du rôle possible de l’équipe de recherche. Ainsi, nos encadrants ont proposé à l’ARS de reformuler la demande d’évaluation du projet e-parcours en une démarche d’accompagnement et d’évaluation de ce projet. Cet élargissement visait tant les équipes de terrain que l’ARS. Elle ouvrait aux chercheurs la possibilité de soutenir les professionnels dans leurs initiatives visant à améliorer l’organisation des parcours, puis d’en évaluer avec eux les effets. Elle devait également permettre de suggérer à l’ARS, au fil de nos investigations, des évolutions dans la manière de piloter le programme e-parcours, en fonction de l’analyse des retours d’expérience des terrains et de nos observations sur la gestion du projet à l’ARS, en particulier sous l’angle de l’articulation entre le siège, les DD et les chefs de projet e-parcours. Accompagnement et évaluation apparaissaient ainsi très liés méthodologiquement et avaient vocation à être réalisés de manière synchrone. De même, la demande relative à l’impact des dispositifs d’appui a été étendue, en introduisant un questionnement complémentaire sur l’organisation de la polyvalence qui devait accompagner la fusion : notre équipe a proposé d’accompagner la réflexion sur le niveau et le type de polyvalence compatible avec un travail efficace sur les parcours, et d’en tirer des propositions sur les principes de spécialisation et de structuration des équipes au sein des DAC fusionnés. Cet axe d’étude s’intéressait donc aux problématiques d’organisation interne de l’activité, de rôles et de professionnalité des acteurs des dispositifs d’appui, ainsi que de structuration de leurs liens avec les partenaires extérieurs. En ce qui concerne l’observatoire des parcours de santé, la réunion de lancement des travaux fin février 2021 a permis de positionner la réflexion sur la diffusion généralisée de l’outil de signalement des difficultés de parcours dans une interrogation plus large sur l’utilisation des informations ainsi collectées, impliquant donc la définition des finalités de l’observatoire et de son positionnement tant vis-à-vis des territoires de coordination que des autorités de tutelle. La formulation de cette interrogation a permis de lancer une réflexion partagée avec une partie des membres du groupe de travail, volontaires pour nous accompagner dans la rédaction de propositions sur ce sujet. L’accompagnement des professionnels et de l’ARS La recherche s’est déployée sur la base des sollicitations (reformulées) que nous venons d’évoquer. S’agissant des deux premiers chantiers – le programme e-parcours et la fusion des DAC -, il convient de noter que si l’ARS était demandeuse d’une intervention de notre part, il n’en était pas de même initialement de la part des professionnels de terrain. Nous leur avons donc proposé notre aide, et les sollicitations sont venues assez tardivement et ne se sont pas toujours inscrites dans le cadre initial. Nous avons néanmoins pu proposer à l’automne 2019 des orientations sur le fonctionnement du comité de projet e-parcours du territoire 13/14 et la préparation d’un séminaire régional sur le déploiement de Terr-esanté (dont l’initiative émanait de ce territoire), qui n’a finalement pas pu se tenir en raison de la survenue de la crise Covid. Nous avons également participé à la rédaction de la réponse à deux appels à projets (AAP) auxquels certains acteurs de ville souhaitaient candidater, et pour lesquels ils ont sollicité notre participation et notre soutien méthodologique. Le premier appel à projets ne présentait pas de lien avec nos sujets de recherche, puisqu’il concernait l’usage des benzodiazépines en ville ; nous le mentionnons pour information car il a contribué à resserrer nos liens avec l’un des médecins généralistes du territoire, président d’une CPTS. Ce dernier nous a contacté de nouveau à l’été 2020, pour un deuxième appel à projets, lancé par la CNSA, visant à réaliser un retour d’expériences sur des dispositifs créés pendant la première vague de la crise Covid, au profit des professionnels et des patients. Nous avons co-rédigé la réponse à cet appel à projets avec les deux CPTS et le DAC du territoire. Bien que notre proposition n’a pas été retenue, son élaboration nous a permis de reprendre contact avec le territoire, distendu lors de la première vague de la crise sanitaire, et a alimenté notre réflexion sur la gouvernance territoriale des parcours et les dispositifs susceptibles de s’articuler avec Terr-esanté. Enfin, nous travaillons à l’heure où nous rédigeons ces lignes sur la rédaction d’une note de « précadrage » des missions et du fonctionnement de l’observatoire régional des parcours de santé, en lien avec des représentants du groupe de travail sur l’observatoire. L’accompagnement sur ce chantier se poursuit donc. Tout au long de notre recherche, nous avons effectué régulièrement des restitutions auprès de l’ARS sur l’avancement de nos travaux, afin de partager avec nos interlocuteurs sur des analyses intermédiaires. Nous avons bénéficié de leurs réactions, conseils et questionnements. Des restitutions de nos travaux ont également été assurées auprès du territoire 13/14, à trois reprises. Sur le territoire 77 sud, la crise Covid a repoussé l’organisation d’une restitution, toujours en suspens aujourd’hui. Présentation synthétique de notre itinéraire de recherche Le tableau ci-dessous présente de manière chronologique notre itinéraire de recherche, en mettant en perspective nos travaux de terrain avec nos restitutions auprès des professionnels et de l’ARS, et nos présentations auprès de la communauté académique, qui nous ont aidée à approfondir certains sujets. Nous rappelons également les travaux menés en parallèle (réponse aux appels à projets, encadrement d’étudiants, contribution à des travaux sur la crise Covid, etc.), dans la mesure où ils ont indirectement contribué à notre recherche, soit en renforçant les liens avec les acteurs de terrain, comme cela a été dit plus haut, soit en nous donnant un éclairage sur des problématiques de prise en charge de patients et d’organisation territoriale, dont nous nous sommes servie dans notre analyse. Nous y revenons dans le chapitre 5 de la thèse.
Introduction générale et résumé détaillé de la thèse . |