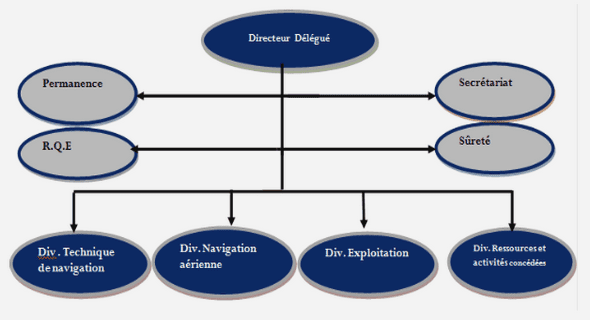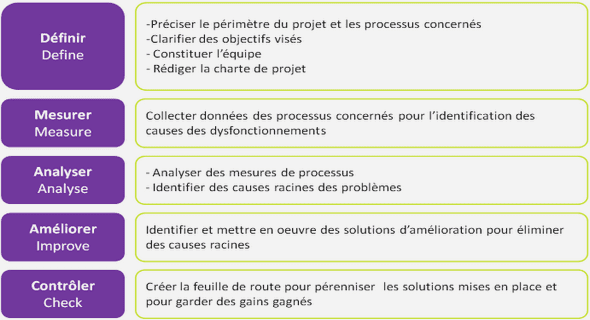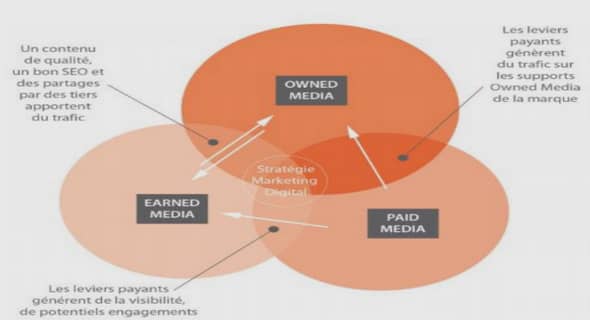Musiques « andines » en France objet et hypothèses.
Délimitations préliminaires et hypothèses provisoires
Avant de commencer à répondre à ces interrogations, et afin d’entamer une première étape dans l’élaboration de notre objet d’étude, il nous semble important de définir quelques frontières et de faire état de quelques définitions concernant les musiques qui nous occupent. Tout d’abord nous devons indiquer que notre intérêt principal ne portera pas sur les manifestations musicales « des Andes », au sens strict du terme1. Il portera sur des musiques qui, bien qu’ayant été créées ou transformées en France, ont toutefois été présentées et perçues comme des manifestations intégralement enracinées dans la tradition musicale des communautés indigènes andines2. Il s’agit des musiques et des musiciens qui en empruntant non seulement des éléments sonores ad hoc mais en s’appuyant aussi sur des éléments iconographiques, vestimentaires et discursifs appropriés, fixeront un certain imaginaire du monde andin au sein de la société française. En fonction de cet imaginaire riche en significations, une certaine homogénéité rend possible, à notre avis, la quête d’une éventuelle logique sociologique sous-jacente. Nous focaliserons notre intérêt essentiellement sur l’activité développée en France par des ensembles folkloriques nés au cours des années 1950 et 1960, dont la présence musicale et la notoriété vont précéder, par conséquent, la popularité des musiques latino-américaines en Europe à la suite des diasporas provoquées par l’instauration des dictatures militaires dans les pays du cône sud3. Nous faisons 1 Comme ça serait le cas, par exemple, dans le cadre d’une étude ethnomusicologique réalisée in situ. 2 Ce sera d’ailleurs sous cette forme qu’elles connaîtront à partir des années 1960 un succès commercial non négligeable en France et plus largement en Europe 3 Quoique chronologiquement elle soit loin d’être la première d’une longue liste, nous pouvons dater symboliquement cette diaspora avec l’avènement de la dictature militaire chilienne, qui entraîna, en septembre 1973, la chute du gouvernement de l’Unité Populaire de Salvador Allende. 18 allusion à des groupes tels que Los Incas et Los Calchakis qui deviendront emblématiques de la mode des musiques « des Andes » en France dans le tournant des années 1960 et 1970, mais aussi plus largement à l’activité de personnalités individuelles, comme Guillermo de la Roca, ou à des groupes de musiques latinoaméricaines tels que Les 4 Guaranis, Achalay ou Los Chacos. Dans l’ensemble, ces musiciens ne proposeront pas exactement des musiques que l’on retrouve dans les communautés indigènes andines, mais plutôt de musiques andines proches de celles créées dans les grands centres urbains latino-américains, notamment en Argentine , et qui vont s’avérer plus adaptées, pour ainsi dire, aux oreilles occidentales. C’est pourquoi nous appellerons dorénavant ces musiques développées en France musiques d’inspiration andine (MIA) en apportant ainsi une première précision à valeur méthodologique destinée à souligner, d’une part, l’écart qui existe entre ces musiques et les modèles indigènes auxquels elles seront souvent identifiées en France, et d’autre part, la volonté de ces ensembles de rapprocher ces musiques et de s’identifier eux-mêmes à un univers « andin ». Dans un second temps nous avons brièvement énoncé un aspect du phénomène qui, compte tenu de l’importance qu’il aura dans l’orientation générale de notre recherche, demande à être mentionné dès à présent en tant qu’élément isolé: dans la diffusion des MIA en France, et malgré leur affiliation à des modèles sudaméricains, ces musiques détiennent un sens qui est propre à leur existence dans l’Hexagone, et elles constituent de fait un objet musical présentant parfois des caractéristiques exclusives. Autrement dit, d’importantes modifications au niveau du matériau sonore sont devenues spécifiques à la diffusion de ces musiques en France. Ainsi, ces modifications révèlent une différenciation par rapport aux manifestations musicales propres aux communautés des hautes terres andines, sans reproduire toutefois systématiquement les transformations dont ces dernières ont été l’objet suite aux processus de métissage ou de « folklorisation »1 vérifiés dans 1 Nous associons ce terme au concept de « folklorisme » tel qu’il est défini par le musicologue espagnol Josep Marti: « Le folklorisme peut être défini […] comme l’ensemble d’attitudes qui impliquent une valorisation socialement positive de ce patrimoine cultural que l’on appelle généralement folklore. En tant qu’attitude ou ensemble d’attitudes, le folklorisme est constitué d’idées -par exemple, ce que l’on entend par « folklore »-, des sentiments -l’amour ou la vénération de ce folklore- et des tendances à l’action -autrement dit, toutes les actions motivées par cette conscience et par ces sentiments, comme, par exemple, l’élaboration de projets conversationnistes ou de diffusion de cet héritage traditionnel ». (Marti, Josep: « La Tradicion evocada: folklore y folklorismo, dans certains pays andins de l’Amérique Latine. Ces variantes sont associées pour l’essentiel au développement de ces musiques, nées comme des manifestations à forte connotation locale, dans un contexte urbain global. Au Pérou, par exemple, les modifications que les musiques des populations andines ont expérimentées tout au long du XXème siècle en vertu, entre autres, de leur diffusion dans la capitale (Lima) s’avèrent souvent divergentes, voire ouvertement opposées à celles qui ont été mises en place par les ensembles sudaméricains qui se produisaient en France à la même époque. Ainsi, pendant qu’à Lima, dans les années 1940 et 1950, des ensembles popularisaient des musiques qui mélangeaient des instruments « typiques » (comme la quena1), à des instruments traditionnels, mais d’origine européenne (tels que la guitare, la mandoline, le violon ou encore le saxophone)2, on constate qu’en France, au même moment, c’était surtout l’étalage d’une panoplie d’instruments « andins » (quenas, charangos3 ou sikus4) qui faisait rage.
S’adapter ou disparaître
Le deuxième document que nous examinerons fait émerger précisément certains aspects du rôle actif et « contraignant », au sens durkheimien du terme, qui aurait pu jouer la société française dans la configuration particulière des MIA. Il s’agit du mémoire d’Emmanuelle Durand, Les musiciens vénézuéliens à Paris1, recherche qui nous permet de déplacer la problématique en mettant en avant des explications et des déterminants autres que ceux énoncés par G. Borras. Tout d’abord il faut souligner que le fait même que l’étude soit consacrée aux musiciens vénézuéliens suscite en nous un intérêt tout particulier : bien que géographiquement et géopolitiquement lié au contexte andin, le Venezuela n’appartient pas à proprement parler à la même aire culturelle que les régions andines de l’Equateur, du Pérou, de la Bolivie, du nord du Chili et du nord de l’Argentine. Si ces dernières partagent un héritage marqué par la domination Inca, il n’en va pas de même pour les régions andines du Venezuela, qui n’ont jamais été sous l’égide du Tawantinsuyu, dont les limites septentrionales s’étendaient plus au moins jusqu’à l’actuelle frontière nord de l’Equateur2. Or, la trajectoire en France des musiciens et des musiques vénézuéliens va pourtant se lier intimement à l’itinéraire des musiciens et des musiques venus d’autres contrées d’Amérique du Sud, notamment ceux qui vont produire des MIA. C’est ainsi que non seulement des ensembles emblématiques de MIA comme Los Incas ou Los Calchakis vont publier des albums avec des musiques vénézuéliennes, colombiennes, et caribéennes3, mais un nombre non négligeable de musiciens vénézuéliens y participeront directement en tant qu’interprètes. L’importance de ce travail pour notre démarche réside sur le fait que E. Durand recueille des témoignages suggérant que les musiciens vénézuéliens ont souvent dû jouer en France le rôle plus large de « musicien latinoaméricain », et que les musiciens interviewés interprètent cette situation comme une sorte de concession face aux « demandes » du public français. 1 Durand, Emmanuelle : Les musiciens vénézueliens à Paris, mémoire de DESAL, Université ParisIII Sorbonne-Nouvelle (Institut de Hautes Etudes de l’Amérique Latine, IHEAL), 2000-2001. En règle générale, les musiques traditionnelles de ces pays vont refléter cette différence historique et culturelle. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de notre étude. Il faut noter que le titre de ce mémoire permet de préciser déjà les différences qui le séparent de l’article de G. Borras ainsi que de notre étude : le mémoire d’E. Durand s’occupe fondamentalement de musiciens plutôt que de musiques. En effet, cette étude cherche à restituer le parcours de musiciens vénézuéliens en fonction de leur double condition de musiciens et d’immigrants, en s’appuyant pour cela sur les discours qu’ils ont à propos de leur vécu en France. L’auteur tente ainsi de donner une vision panoramique des expériences recueillies au long des années 1980 et 1990, en les confrontant avec la présence en France des musiques latino-américaines. Ce choix s’explique surtout par le fait que, à la différence des musiques ou danses telles que la Salsa, le Tango, la musique brésilienne et les MIA à proprement parler, les musiques traditionnelles vénézuéliennes n’ont jamais vécu en France une période de notoriété ou de succès commercial. Si nous nous intéressons au travail de Durand c’est précisément parce que, bien que n’ayant pas pu profiter d’une mode de musiques vénézuéliennes en France, ces musiciens vénézuéliens ont pu largement exercer leur métier en tant que musiciens latino-américains. Or, compte tenu de la relative popularité de ces « autres » musiques latino-américaines –il suffit de penser à l’engouement durable des Français pour la Salsa ou le Tango- il est clair que les concessions que ces musiciens ont dû accorder n’ont pas été des moindres : « Si l’on veut continuer à faire de la musique sud-américaine il faut changer de style – signale l’un des enquêtés- parce qu’une fois que c’est passé [la mode] c’est fini. En ce moment, beaucoup de musiciens vivent de la Salsa, peut-être que dans dix ans il vivront de la nouvelle musique équatorienne, ou on aura peut-être tous des chapeaux mexicains sur la tête »1. Les pistes avancées par ces témoignages s’avèrent par conséquent très pertinentes pour notre recherche, car elles suggèrent que le rôle du public français n’est pas circonscrit à une écoute ou une admiration passive pour les musiques latino-américaines. Ce rôle peut bien être vécu comme une contrainte, au sens durkheimien du terme, par les musiciens concernés. Pour les musiciens vénézuéliens interrogés par E. Durand, en tout cas, tous les « changements de style » qu’ils ont dû effectuer n’ont pas été forcément motivés par l’intention de profiter des rêves d’exotisme des français, mais plutôt d’accéder et de « toucher » le public français de la seule manière dont il leur était possible en tant que vénézuéliens. Pour ces musiciens le vrai problème, comme le souligne l’un d’entre eux, est plutôt qu’ « à chaque fois qu’on pense à l’Amérique Latine [en France] on ne pense qu’à la Salsa […] Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas et qu’il faut faire connaître…il y a un problème de désinformation terrible »1. En fonction des éléments apportés par ces témoignages – comme cette « désinformation » – à travers lesquels on s’aperçoit qu’aux yeux de ces musiciens il y a dans cette situation quelque chose qui échappe à leur contrôle, il est légitime de penser à l’éventuelle action d’un impératif « extérieur » agissant sur ces musiciens et facilitant la transformation des musiques en question. Ceci renforce également l’idée que, dans le cas de la popularisation des MIA en France, une intentionnalité orchestrée et destinée à tromper le public français n’est pas forcément la seule hypothèse à explorer. D’autant plus que, à en croire les dires des musiciens vénézuéliens interviewés par E. Duran, les contraintes qui pèsent sur eux sont loin d’être négligeables : « La musique vénézuélienne n’est pas du tout à la mode…il faut vraiment se bagarrer, essayer de l’imposer, il n’y a que très peu de demande…On ne peut pas l’imposer comme ça, ça n’intéresse pas les gens, ils ont des images dans la tête et la musique vénézuélienne n’a pas d’image ici »2. Certes, les témoignages relevés par E. Durand parlent d’une époque postérieure au zénith des MIA en France, et ils gravitent autour de musiciens et de musiques qui n’ont pas évolué autour d’un univers « andin ». Ils peuvent donc paraître quelque peu décalés par rapport au sujet qui nous intéresse. Mais le fait de ne pas rejeter sur les musiciens toute la responsabilité des « changements de style » repérables dans les musiques latino-américaines en France reste un antécédent non négligeable pour la construction de notre objet d’étude, d’autant plus qu’il nous semble tout à fait légitime et nécessaire de savoir dans quelle mesure certaines de ces « images dans la tête » du public français auraient pu influencer à leur tour l’activité des musiciens « andins » en France et la configuration même des MIA.