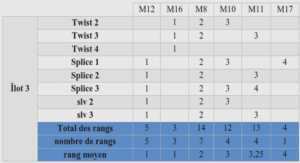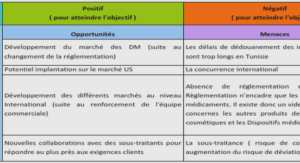Mortel préambule.
Je m’appelle Eric Vincent. Je sais, c’est écrit sur la couverture… Je suis né le 1er avril 1966, à Cognac. Voici la situation de ma vie à l’entame de ce récit, le 19 février 2010 : j’ai viré ma femme – deuxième divorce -, mes amis, ma famille, mes collègues. Seule une poignée d’irréductibles gaulois résiste toujours à l’invasion de mon esprit par le Mal. J’ai trois enfants âgés de 20, 15 et 7 ans, issus de mes unions passées. Mon aîné, Valentin, vit au Canada avec une copine que je n’encadre pas (Et c’est réciproque). Elle suit des études, fait trimer mon fils et pompe son fric. J’ai rompu le contact avec lui. Je crains de déteindre sur sa personnalité, de le contaminer de mes noirs desseins. Ma fille, Tess, vit en province avec sa mère et son beau-père, un connard de première, repris de justice. Nos échanges sont rares, artificiels et empruntés. A ses yeux, je suis un géniteur et aux miens, c’est une inconnue. Parfois, un sursaut d’orgueil la pousse à s’accrocher à son déchet de père. Elle déploie une énergie stupéfiante pour se rapprocher et met ensuite une distance infinie. Je la fuis. Pourquoi faire connaissance avec un mort comme moi ? J’ai la garde de Sven, mon cadet, fruit de mes secondes noces. J’estime qu’il n’a plus de mère. Elle a fui face à nos problèmes comportementaux. Fuite contre fuite. Elle n’a jamais été mère. Je lui interdis de porter ce titre ! Sven, c’est mon oxygène et mon gaz carbonique à moi. Il me tue et me fait vivre. Il est mon reflet, tellement moi… Côté profession, je suis devenu informaticien par hasard. Un « technicien » raté et obsolète. Je remplis ma tâche pour manger et payer les traites. J’ai loupé ma vocation d’écrivain, par manque de talent, d’éditeur et de public. Je ne suis pas pilote d’avion : j’ai abandonné en cours de route. Que de ratés ! Voilà ma vie condensée en une phrase : des échecs sentimentaux, deux mariages, deux divorces, trois enfants malmenés, un métier haï, une passion avortée. Un désastre. Cet écrit pourrait s’arrêter à ce résumé. Sera-t-il avorté, comme tant d’autres ? Je l’ignore. Les ténèbres me cernent, aucune lumière ne filtre. Le 1er avril 2010, je ramperai pour boucler mes quarante-quatre printemps. Ce n’est pas une certitude, juste un pressentiment : je ne traînerai plus longtemps mes guêtres sur cette planète exsangue. Par précaution, je vais autopsier ma vie et rédiger ma « nécrographie ». Cet acte médical lève le voile sur le mystère nimbant un décès. Aux yeux du quidam moyen, l’autopsie incarne une démarche effrayante, taboue. L’humain, choqué par le mot, mute en téléspectateur et se réfugie derrière les images aseptisées, inodores des séries policières d’outre-Atlantique. L’usage du verbe « autopsier » déclenche un tsunami nauséeux dans mon organisme. Malgré cette aversion, une force intérieure me pousse à élucider l’énigme de ma destinée : pourquoi suis-je mort-né ? Pour toucher au but – l’ultime compréhension – point besoin de techniques savantes, de machines infernales, ni de scies circulaires à faire pâlir un bûcheron canadien ! La découpe de ma misérable existence passera par un zeste de simplicité, d’humilité, de dépouillement, une dose bétonnée d’impartialité, d’abstraction, de méditation et par une kyrielle de raisons moins bidonnées les unes que les autres. Si je résiste aux sirènes de l’autodérision et du nombrilisme, si je vaincs ma tendance compulsive à céder à la colère, à l’insulte. Ce n’est pas gagné ! L’incertitude lance un assaut contre mon esprit. Et s’il me fallait toute une vie pour me déchiffrer, sans avoir la conviction d’emporter la victoire suprême : l’accès à la vérité ? Si une existence ne suffisait pas pour me disséquer ? Si ma mort, violente, soudaine, était l’unique encart temporel assez vaste pour m’expliquer ? Au cours de ce – presque – demi-siècle, j’ai toujours choisi les chemins les plus courts, les lignes droites… en résumé : la facilité. Même pour mourir ! Les cachets, délivrés avec ou sans ordonnance, sont plus faciles à obtenir qu’un 357 Magnum pour liquéfier une cervelle. Alors, pourrai-je mener à bien une mission ardue, tortueuse, semée d’embûches et de longue haleine ? Voici venir le match mental du jour : d’un côté, championne du monde toutes catégories, invaincue jusqu’à ce jour (Jésus, pistonné de L’Autre, compte pour du beurre), « L’éternité de la mort », alias la solution de facilité. Dans l’autre coin du ring, challenger improbable, peu de victoires à son actif, « La brièveté de la vie ». Un enjeu rude : me décrypter. La tentation me guette… mais… dans ce cas, pourquoi me lancer dans ma « nécrographie » ? Pourquoi ce préambule ? Pourquoi pas trois plaquettes de Tranxène combinées à une overdose de Sumatriptan, histoire de prendre mon temps pour quêter, glaner ou au contraire, glander ad vitam aeternam ? Maudit instinct de survie, détestable ego désireux d’accoucher de l’écrit révélateur. Tant pis ! Je me lance. * * * * * * * Erreur numéro 1 : mauvais aiguillage Avant le commencement était le néant. Un mystère a engendré le bigbang, les atomes, les heurts, les agrégats, la fusion. Une monstrueuse équation avec des trillions d’inconnues, un défi des probabilités appelé hasard ou destin. Qui a commencé ? Une machine ? Une entité intangible ? Une communauté sociale et énergétique ? Des matériaux injectés par l’Infiniment Grand à l’intérieur de billes de matière noire ? Etait-ce intentionnel ou involontaire ? Aucune idée ! Qu’un scientifique ou un religieux apporte l’explication définitive, je m’en tamponne le coquillard avec une poignée de graviers secs ! La face de mon univers ne changera pas pour autant. Dix milliards d’années ont passé. Cognac, 1er avril 1966, 11H45 : ma naissance. Mon grand-père maternel, Emile, est heureux : je viens d’accéder au rang d’humanoïde le jour de ses cinquante printemps. Il fonce à la pâtisserie et achète des religieuses pour fêter ma venue au monde. Pas chiche pour un rond, il les partage avec mes autres grands-parents. Des religieuses… Marrant ! Un chou fourré au chocolat accolé à un autre rempli de crème au café, ça donne… un divorcé ! Un achat ô combien symbolique et prophétique pour mon existence.
Mauvais aiguillage.
A propos de religieuses, parlons un peu de religion ! Mes parents (Je traduis : ma mère !) décident de me baptiser en juin 1966. Ai-je eu mon mot à dire ? Que nenni ! C’est le principe bien chiant des croisades : imposer une religion par la force. Une méthode fasciste. Je hais les religions intolérantes, les extrêmes. Ce baptême, c’est le viol de ma liberté de choix. Je rejette le catholicisme et cette imposition de toutes mes forces. Ils craignaient quoi ? Que je sois possédé par le diable ? Que je sois un monstre ? Croyances stupides, fondées sur la peur ancestrale, collective, reposant sur du vent, sans fondement scientifique. Le baptême n’a pas chassé les idées noires de mon esprit et n’a pas entravé mes mauvaises actions. Quel souvenir ai-je de ma vie prénatale, utérine ou de ma prime enfance ? Aucun. Logique, non ? Pas sûr ! Certains illuminés affirment se souvenir de leurs vies antérieures, se vantent de régresser dans le temps sous hypnose – ou pas -. Je n’ai pas ces dons, ces informations et je m’en tape ! Mes premiers instants et leurs poursuivants ont été éliminés de ma vie comme on va aux chiottes, avec la colique et ses douleurs en prime. Que puis-je glaner sur mes péripéties post-natales ? La question n’est pas là. Des premières heures de mon existence, seule l’histoire des religieuses de mon grand-père a transpiré. Ce n’est pas qu’anecdotique. Une omerta, édictée par ma mère, imposée à mon père, a régi ma famille depuis des temps immémoriaux. Rares sont les faits rapportés sur mes agissements, hormis des actes néfastes, des bêtises. Ma brûlure avec un mégot mal éteint sur une plage de l’île d’Oléron lorsque j’avais 14 ou 15 mois, mon ravalement des toilettes chez les parents (J’ai déchiré la tapisserie, j’ai refait la décoration avec mes excréments) et ma chevauchée fantastique en direction de la nationale 141, stoppée net par mon père alors qu’une Renault 4 CV allait me tailler un short, voire me scalper. Mes parents m’ont équipé d’un harnais et d’une laisse, jusqu’à ce que mon grand-père installe un portail, le cœur arraché par la vision de son premier petit-fils tenu comme un Pitbull. Succincte, la petite enfance ! Je ne regrette qu’une chose : ne pas avoir battu mon père à la course. Si j’avais atteint la chaussée avant lui, je ne serais plus qu’une tombe dans un cimetière (Ils n’auraient pas procédé à ma crémation, comme je le souhaite), un vague souvenir encombrant, quelques photos jaunies désireuses de s’échapper d’un album poussiéreux. Un détail, maintes fois relaté, me revient en mémoire : Timouine, la chatte de mes parents, se couchait au pied de mon berceau ou de mon landau. Pourquoi veillait-elle sur moi ? Etait-ce ma chaleur corporelle ? Mes pleurs similaires aux cris d’un chaton ? L’attrait de la nouveauté, piquant à vif la curiosité du félin ? Les chats me suivront toute ma vie et je les vénèrerai. Reprenons les faits tangibles. Mes parents se sont mariés le 24 avril 1965. D’après la rumeur, ma gestation est allée au-delà du terme, une dizaine de jours, grand maximum. Un simple calcul arithmétique replace ma conception aux alentours du 20 juin 1965. Deux petits mois d’écart entre le mariage et la fabrication d’un ersatz humain. Quand deux adultes s’épousent sans s’être fréquentés ou si peu, quand ils n’ont jamais vécu sous un toit commun (Pas de ça, en ce temps-là !), ils font connaissance, ils s’apprivoisent, ils profitent un peu d’être à deux, non ? Rares sont les couples qui enfantent dès la nuit de noces, sauf les illuminés adeptes des familles nombreuses. Je n’ai qu’un frère, né en juillet 1969, à sept mois (Un grand prématuré, à l’époque). Une fratrie de deux péquins, ce n’est pas une smala ! Bien. Admettons qu’en 1965, la contraception n’ait pas été à leur portée. Emportés par leur élan, ils m’ont conçu avec une frénésie démoniaque, à force de tentatives dans tous les coins de la baraque. Pourquoi n’y a-t-il pas d’autre grossesse après avril 1966 ? Pourquoi et surtout, comment avoir attendu décembre 1968 pour remettre le couvert et fabriquer le frangin ? L’accès à la contraception, cette fois ? Tout aurait changé en neuf mois ? Curieux. L’abstinence pendant deux ans et demi, peut-être ? Allons donc ! Un autre fait est à prendre en compte : ma mère n’a jamais cessé de seriner qu’ils avaient tout fait pour avoir mon frère. Que ne l’ai-je pas entendue, cette phrase ! Tout à leur honneur et au bonheur de mon frère, si fragile à sa naissance tandis que moi, je n’avais pas été la victime d’une santé précaire et d’une naissance compliquée. De là à entendre le message subliminal : « Nous ne t’avons pas désiré alors que ton frère, lui, a été voulu plus que tout au monde », il n’y a qu’un pas. Une grossesse très rapide après le mariage, une abstinence ou une absence de fécondité (artificielle ?) après, une volonté de tomber enceinte pour mon frère et le désir de ne plus avoir d’enfant avant que j’attrape mes 15 ans. Mes parents n’ont jamais connu la passion, c’est une certitude. De l’amour au début, lorsque mon père appelait ma mère Bibiche, qu’il était tendre avec elle. L’inverse n’était pas visible. Le désamour entre eux est survenu très tôt. Ils n’avaient rien du couple prêt à engendrer une dizaine de marmots.
A la lecture de ces faits et ces déclarations, j’ai acquis la certitude de n’avoir été qu’un simple accident de jeunesse. J’étais un gamin difficile, perturbé par de monstrueuses colères où je me retenais de respirer jusqu’à devenir violet, noir. Pourquoi ce comportement ? Hum ? Ma mère coupait mes apnées à coup de douches glacées. Violent, efficace et pas cher, c’est la baffe qu’elle préfère ! (Pour parodier une célèbre chanson publicitaire) A part les âneries citées plus haut, rien n’a transpiré sur moi. Juste le négatif : j’entrais en furie, j’avais le geste rageur et je m’empiffrais. Que disent les psychiatres à propos de la gloutonnerie ? Ils n’évoquent pas la faim, ils parlent de manque à combler. Lequel ? Un défaut d’amour ? De reconnaissance ? D’encouragement ? D’identité ? Un mix ? Autre chose ? Je n’ai pas trouvé un praticien pour approfondir mes malaises et répondre à mes interrogations. Mon rapport à la nourriture a toujours été compliqué, passionnel et conflictuel ; il s’est aggravé avec l’inaction à l’armée. Ma mère a nié mes problèmes de surpoids avant cette période mais, à sa décharge, elle n’a jamais entendu les réflexions encaissées à l’école, elle n’a jamais lu dans mes pensées, elle n’a jamais eu vent de mon aversion pour les miroirs. Elle a vite, très vite oublié mes descentes nocturnes dans les placards à bouffe, dans le réfrigérateur ou le congélateur. Je ne laissais que quelques miettes : – Tu as encore mangé les cacahuètes ! – Non, c’est le chien. – Et il a ouvert le placard ? Tu as tout mangé ! – Non, il en reste, je n’ai pas tout mangé ! Mes dévastations, dignes des plaies d’Egypte, alimentaient des engueulades dantesques. L’engloutissement sans fin (Les courses sont un éternel recommencement), sans faim (Je me mets rarement à table avec des gargouillis dans l’estomac) cristallisait mes multiples vengeances contre mes moulins à vent, mus par mes cyclones intérieurs, ma haine de la vie. Avec le recul, je trouve les pertes de mémoire maternelle assez comiques : elle nie quand ça l’arrange, elle s’offusque lorsque je mentionne Alzheimer. Je me suis toujours gavé. C’est un fait. J’ai vécu ma première crise de boulimie à 6 ans, au mariage de mon oncle. Je me suis rempli sans compter, j’ai vomi, remué par la honte d’avoir trop avalé et j’ai recommencé de plus belle. Ma mère rejette la faute sur sa belle-famille, accusée d’avoir favorisé, voire encouragé ma goinfrerie. D’accord ! Admettons que le versant paternel de la famille ait concouru à entretenir mon embonpoint, ait comblé mes besoins, mes manques, en me filant des steaks à ne plus savoir où les mettre, à m’en dégoûter. Pourquoi ma mère oublie-t-elle les repas interminables, pantagruéliques organisés par sa propre mère, des marathons où tous les convives se disputaient, où l’ambiance de merde était de règle et où j’ai développé d’autres dégoûts ? Tant que nous y sommes, omettons que mes grands-parents paternels nous ont reçu dix fois moins que mes grands-parents maternels. Enterrons ces différences pour ne nous concentrer que sur un seul point : chère Mère, plutôt que de rejeter la faute sur les autres, ne valait-il pas mieux t’interroger sur le comportement anormal de ton fils ? Non ? Hum… Ah… M’envoyer chez un psychiatre, cela aurait fait une tache sur son CV de mère proche de la perfection… Quand mon frère rencontrera ses premières difficultés scolaires, qu’il s’adonnera aux joies de l’école buissonnière en réponse à une institutrice mollassonne et inexistante, tu te mettras en quête d’une autre boîte à formater les neurones, tu remueras ciel et terre pour qu’il trouve sa voie, son rythme. Oh ! Aurais-je été coupable de ne pas avoir fait de vagues lors de ma scolarité, faisant tes quatre volontés jusqu’à mon baccalauréat suivi de cinq longues et belles années d’études, couronnées par le diplôme tant demandé ? Ah oui, j’oubliais : des études au rabais, que tu diras après. Voilà le cœur du problème : à quatre ans, je me suis tu. Mon silence a muselé ma révolte, mes besoins, mes désirs. Je n’ai montré que des signes extérieurs de mal-être. Je n’ai pas été pris en charge, j’ai tout laissé pourrir à l’intérieur. Les manques gangréneux ont ravagé mon âme et ont castré mon savoir-aimer, mon savoir-vivre. J’ai grandi comme une vigne sauvage, juste bon à faire de la vinasse. Naissance non programmée mais programmé pour perdre, enfant éconduit mais conduit sur la voie de l’imprévu, victime d’une erreur d’aiguillage d’un spermatozoïde vers une saleté d’ovule. Depuis la gare de départ, je suis et je reste un train lancé vers une destination secrète. Un convoi – un con qu’on voit – dont il manque des wagons, des pièces. Je ne comprends pas qui je suis, pourquoi je suis là, ce que je dois faire. Je ressens l’inachèvement mais quelle était l’idée de départ ? Un tableau ? Une nature morte, alors… Ajout du 28 juillet 2012. La veille, j’ai rencontré ma tante Maïté, l’unique personne en vie, témoin objectif du mariage de mes parents. Ma tante a rassemblé ses souvenirs et n’a pas vu de choc émotionnel, de trauma direct. Elle m’a rapporté qu’effectivement, mes parents se sont à peine fréquentés avant de se marier. A l’évidence, ma mère fuyait le giron familial très pesant, au passif de violence digne d’une société cannibalisée par un fonds de pension américain. Ma mère n’était pas mécontente d’être tombée enceinte dès le second mois de vie commune. Par contre, ma grand-mère accueillit la nouvelle de manière glaciale par un « Ah ! Vous n’avez pas perdu de temps ! ». Connaissant ma mère, cette réflexion a dû l’atteindre et plutôt que vider son sac sans délai, elle aura ressassé la gifle durant des mois, jusqu’à son complet pourrissement, à l’intérieur du cœur. L’ambiance familiale était très dure. Je peux avoir ressenti, en tant que fœtus, bébé, une haine cordiale, un héritage familial. J’en suis d’autant plus persuadé que j’ai vu, devenu adulte, ce qu’un milieu sans amour, animé de querelles ou de rancœurs, pouvait engendrer sur le devenir d’un nourrisson.