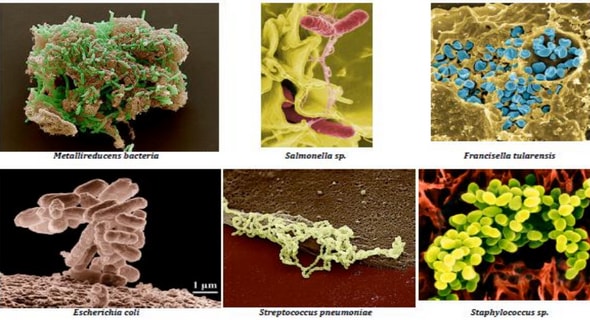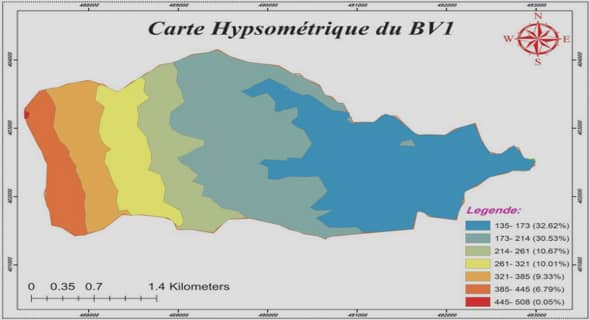Les métaux lourds
Le terme de métaux lourds est arbitraire et imprécis. Il est utilisé pour des raisons de simplicité et il recouvre des éléments ayant des propriétés métalliques (ductilité, conductivité, densité, stabilité des cations, spécificité de ligand…) et un numéro atomique >20 . Les métaux lourds sont définis comme étant des éléments chimiques toxiques ayant une densité supérieure à 5 g/cm3. Sous cette appellation figurent des éléments qui, pour certains, sont effectivement des métaux tels que Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Al… mais aussi des métalloïdes tels que As et Se. Ceux-ci sont présents le plus souvent dans l’environnement sous forme de traces. Les plus toxiques d’entre eux sont le cadmium, l’arsenic, le plomb et le mercure. Ces éléments sont présents naturellement dans la croûte terrestre et dans tout organisme vivant, à des concentrations variables suivant les milieux et les organismes. Selon les textes législatifs, la pollution par les métaux toxiques (METOX) regroupe sept métaux et un métalloïde (chrome, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic, cadmium et mercure) .
Les métaux lourds : oligoéléments ou éléments toxiques
Chez les végétaux, si les métaux sont souvent indispensables au déroulement des processus biologiques (oligo-éléments), nombre d’entre eux peuvent s’avérer contaminants pour diverses formes de vie, lorsque leur concentration dépasse un seuil, lui-même fonction de l’état physico-chimique (spéciation) de l’élément considéré.
C’est le cas du fer (Fe), du cuivre (Cu), du zinc (Zn), du nickel (Ni), du cobalt (Co), du vanadium (V), du sélénium (Se), du molybdène (Mo), du manganèse (Mn), du chrome (Cr), de l’arsenic (As) et du titane (Ti) (Miquel, 2001). Certains de ces métaux sont aussi impliqués dans les processus moléculaires tels que le contrôle de l’expression des gènes, la biosynthèse des protéines, des acides nucléiques, des substances de croissance, de la chlorophylle et des métabolites secondaires, le métabolisme lipidique ou la tolérance au stress (Rengel, 1999). D’autres ne sont pas nécessaires à la vie et peuvent être même préjudiciables comme le mercure (Hg), le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et l’antimoine (Sb) .
Tous les métaux lourds peuvent, à partir d’une concentration seuil, induire une toxicité chez les plantes. L’exposition excessive aux métaux lourds peut conduire à des effets très néfastes sur la santé humaine. Or les produits végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire donc ils contribuent à l’imprégnation de l’homme par ces métaux lourds, d’où l’intérêt d’étudier et de contrôler l’accumulation des métaux lourds dans les végétaux.
Toxicité et tolérance des plantes aux métaux lourds
Certains éléments métalliques sont essentiels aux organismes vivants à de faibles concentrations. Mais, ils agissent à de fortes concentrations comme un facteur de stress qui entraîne une modification de la réaction physiologique. Le terme « sensibilité » décrit les effets du stress, qui peuvent aller jusqu’à la mort de la plante.
Par opposition, le terme «résistance » fait référence à la réaction de la plante qui lui permet de survivre face au stress métallique et d’assurer sa descendance .
Toxicité : Les symptômes de toxicité associés aux métaux lourds sont peu différents de ceux produits par différents types de stress. Ils peuvent être classés en deux catégories: les symptômes visibles et les symptômes uniquement mesurables ; leur importance étant fonction de la mobilité du métal à l’interface sol-plante et à l’intérieur de la plante, mobilité qui détermine la concentration endogène du métal. L’effet le plus habituel et le moins spécifique des métaux lourds consiste en une réduction de la croissance des différentes parties de la plante. Selon l’importance du stress, les feuilles peuvent présenter une chlorose due à la fois à une perte de chlorophylle, à une relative augmentation des caroténoïdes et à une déficience en fer . Dans les cas les plus sévères, une apparition de tâches nécrotiques est observée. Les métaux induisent également un abaissement de la photosynthèse qui résulte soit d’un effet direct sur le transport des électrons et les enzymes du cycle de Calvin (en particulier de la Rubisco) soit d’un effet indirect, en raison d’une diminution de la teneur en chlorophylle .
Tolérance : Un nombre restreint de plantes se révèlent capables de se développer sur des sols fortement contaminés par les métaux lourds. C’est en 1885 que le botaniste allemand Baumann observa que certaines espèces accumulaient ainsi dans leurs feuilles des quantités extraordinairement élevées de zinc. Ces espèces rencontrées sur des sols naturellement riches en éléments métalliques ont été utilisées comme indicateurs lors de prospections minières. Certains de ces végétaux, qualifiés d’hyperaccumulateurs, sont capables de stocker en très grandes quantités les métaux dans leurs parties aériennes. L’étude de ces plantes résistantes, par leurs capacités de détoxication, d’immobilisation ou d’absorption des métaux lourds, pourrait donc constituer un outil intéressant, non seulement pour estimer les risques de transfert potentiel des métaux lourds au sein de l’écosystème , mais aussi comme outil de réhabilitation des sols . Ces plantes utilisent alors des mécanismes spécifiques de défense pour éliminer les métaux ou pour les rendre moins ou non disponibles afin de réduire leurs toxicités. Deux stratégies sont ainsi observées : l’exclusion qui consiste à éviter l’absorption des métaux, présents à concentrations élevées dans le sol et, l’accumulation voire l’hyperaccumulation, qui se traduit au contraire par une absorption importante des métaux, qui se réalise également avec de faibles concentrations en métal dans le sol. En outre, quelques plantes tolèrent les métaux en ayant une faible vitesse de translocation vers les parties aériennes, effectuant ainsi une protection de leur photosynthèse .
L’élément cadmium
Le cadmium, découvert en 1817 par le chimiste allemand Stohmeyer est un métal malléable d’aspect blanc bleuâtre, qui présente une grande résistance à l’oxydation et une bonne conductibilité électrique. Le cadmium élémentaire a un numéro atomique de 48 et une masse atomique de 112,4 g/mol. Le cadmium se trouve souvent associé dans les roches aux éléments du même groupe, comme le zinc et le mercure. La valence Cd2+ est la valence la plus souvent rencontrée dans l’environnement et est vraisemblablement la seule valence du cadmium dans les systèmes aqueux . Aucune fonction biologique n’est connue pour le cadmium . En revanche, ses propriétés physiques et chimiques, proches de celles du zinc et du calcium, lui permettent de traverser les barrières biologiques et de s’accumuler dans les tissus.
La toxicité du cadmium et ses risques sur la santé humaine
Le cadmium est un métal lourd relativement rare dans l’écosphère. Il fait partie des polluants les plus toxiques et les plus mobiles dans le système sol-plante. Par conséquent, son assimilation et son accumulation dans les tissus des végétaux peuvent constituer des vecteurs de contamination en cas de consommation animale ou humaine . Les premières observations portant sur la toxicité du cadmium chez l’homme furent faites au Japon vers les années 1950. Le cadmium, provenant d’une mine de montagne avait produit une pollution de la rivière Jinzu dont l’eau était utilisée pour l’irrigation des rizières. L’ingestion orale de ce riz par les habitants aboutissait à une forte accumulation du cadmium dans le corps humain et à une maladie appelée au Japon Itai-Itai (qui signifie «j’ai mal, j’ai mal », phrase souvent répétée par les malades) .
Le cadmium présente des risques chez le consommateur. Même à de faibles concentrations, il tend à s’accumuler dans le cortex rénal sur de très longues périodes (50 ans) où il entraîne une perte anormale de protéines par les urines (protéinurie) et provoque des dysfonctionnements urinaires chez les personnes âgées. En fait, le rein semble être l’organe le plus touché par les méfaits du cadmium.
Le cadmium atteint le rein sous la forme de complexe cadmium-métallothionéines. Cependant, il existe plusieurs preuves de la cancérogénicité du cadmium, notamment en ce qui concerne le cancer rénal chez l’Homme .
Les mécanismes moléculaires de la carcinogenèse induite par le cadmium ne sont pas encore compris. On peut cependant citer que la régulation de la signalisation mitogène est altérée par le cadmium, ainsi que les mécanismes de réparation et d’acquisition d’une résistance apoptotique. Une augmentation des cas de certains cancers, en particulier des poumons, est observée chez les populations exposées au cadmium. La transformation cellulaire induite par le cadmium et la tumorogenèse sont associées à une activation d’oncogènes et à la production de ROS .
Table des matières
Chapitre I : Introduction générale
1. Les métaux lourds
1.1. Définition
1.2. Origine des métaux lourds
1.3. Les métaux lourds : oligoéléments ou éléments toxiques
1.4. Toxicité et tolérance des plantes aux métaux lourds
1.4.1. Toxicité
1.4.2. Tolérance
2. Le cadmium
2.1. L’élément cadmium
2.2. Origines du cadmium dans le sol
2.2.1. Origine naturelle
2.2.2. Origines anthropogéniques
2.2.2.1. Rejets d’origine industrielle
2.2.2.2. Les pratiques agricoles
Les pesticides et les fongicides
L’irrigation
Les matières fertilisantes
2.3. La toxicité du cadmium et ses risques sur la santé humaine
2.4. Les végétaux : principale voie d’entrée du cadmium dans la chaîne alimentaire
2.5. Les principaux paramètres physico-chimiques influençant la biodisponibilité du cadmium dans le sol
2.5.1. Formes du cadmium dans le sol
2.5.2. Le pH
2.5.3. La matière organique
2.5.4. Effet des compétitions ou des synergies entre éléments chimiques
2.5.5. Effet de la température du sol
3. Interactions entre le cadmium et les plantes
3.1. Phytotoxicité du cadmium
3.1.1. Effet du cadmium sur la croissance
3.1.2. Effet du cadmium sur le statut hydrique
3.1.3. Effets du cadmium sur la nutrition minérale
3.1.4. Effet du cadmium sur la photosynthèse
3.1.5. Induction d’un stress oxydatif par le cadmium
3.2. Mécanismes de défense induits par le cadmium
3.2.1. Absorption
3.2.2. La chélation et la séquestration du cadmium
3.2. 3.Transfert et translocation
3.2.4. Le Système enzymatique antioxydant
3.3. Autres stratégies de défense
3.3.1. Accumulation des métaux dans les feuilles âgées
3.3.2. Biosynthèse d’éthylène
3.3.3. Les acides aminés
3.3.4. Transporteurs membranaires
3.4. Prélèvement et accumulation du cadmium
3.4.1. Prélèvement du cadmium
3.4.2. Accumulation du cadmium
4. Utilisation des halophytes en phytoremédiation
4.1. La phytoremédiation
4.1.1. Définition
4.1.2. Les différents procédés de la phytoremédiation
4.1.2.1. Phytovolatilisation
4.1.2.2. Rhizofiltration
4.1.2.3. Phytostabilisation
4.1.2.4. Phytodégradation
4.1.2.5. Phytoextraction
4.1.3. Plantes accumulatrices et hyperaccumulatrices
4.2. Cas des halophytes
4.3. Mécanismes de tolérance au stress abiotique chez les halophytes
4.3.1. La phytoremédiation vis-à-vis des métaux lourds
4.3.2. La phytoremédiation vis-à-vis des sols salins
5. Les plantes du genre Atriplex
5.1. Origine et distribution
5.2. L’Espèce Atriplexnummularia
6. Objectifs du travail
Chapitre II : Matériels et méthodes
2.1. Conditions de culture
2.2. Le dispositif expérimental
2.3. Techniques analytiques
2.3.1. Paramètres de Croissance
2.3.1.1. Détermination de la matière sèche
2.3.1.2. Détermination de l’indice de succulence
2.3.2. Paramètres Physiologiques
2.3.2.1. Extraction et dosage des sucres solubles totaux
2.3.2.2. Dosage des chlorophylles
2.3.3. Analyse de l’accumulation du cadmium
2.3.3.1. Détermination de la quantité deCd excrétée sur la surface de feuilles
2.3.3.2. Dosage du Cd accumulé par les plantes
2.4. Analyse statistique
Chapitre III : Résultats et discussion
3.1. Paramètres de croissances
3.1.1. Impact du cadmium sur la longueur moyenne des tiges d’Atriplexnummularia L. en fonction de la salinité du milieu
3.1.2. Impact du cadmium sur la longueur moyenne des racines d’Atriplexnummularia L. en fonction de la salinité du milieu
3.1.3. Impact du cadmium sur le volume des racines d’Atriplexnummularia L. en fonction de la salinité du milieu
3.1.4. Impact du cadmium sur la biomasse d’Atriplex nummularia L. en fonction de la salinité du milieu
3.1.5. Impact du cadmium associé à un stress salin sur l’indice de succulence chez Atriplex nummularia L.
3.2. Les Paramètres physiologiques
3.2.1. Impact d’un traitement au cadmium associé à un stress salin sur la synthèse chlorophyllienne chez Atriplex nummularia L
3.2.2. Impact d’un traitement au cadmium associé à un stress salin sur la teneur en sucres solubles chez Atriplex nummularia L.
3.3. Analyse de l’accumulation du cadmium
3.3.1. Accumulation du cadmium chez Atriplex nummularia L. en fonction de la salinité du milieu
3.3.2. Détermination de la quantité du cadmium excrétée à la surface des feuilles d’Atriplex nummularia L
Conclusions et perspectives
Références bibliographiques
Annexes