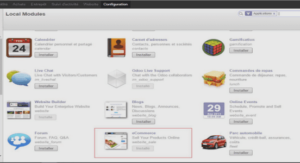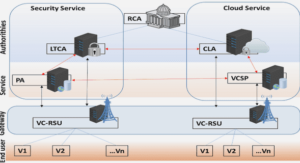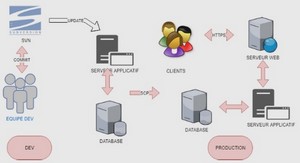Nous vivons dans un monde sans précédent, avec des dimensions et des horizons totalement nouveaux, dans lequel les limites de la technologie et de l’imagination ont été repoussées à l’infini. Un nouveau pouvoir, celui de l’Information, modèle une géographie différente avec de nouvelles cultures, de nouveaux acteurs et de nouvelles structures organisationnelles.
Ces notions, décrivent une nouvelle et troisième révolution dans l’histoire de l’humanité : l’ère de l’Information, qui conduit à une vaste redistribution de sources de travail, de production et de pouvoir qui touche le monde entier et tous les réseaux. La première révolution a été agricole, la seconde industrielle, la troisième informationnelle. La révolution informationnelle est due principalement au développement fulgurant des technologies de l’information qui permettent actuellement le traitement, le stockage et la transmission d’énormes quantités de données quasiment en temps réel. Les différents moyens de télécommunications ont permis la création de nouveaux marchés mondiaux sans considérer les frontières des nations ni les distances qui les séparent. Ces moyens correspondent principalement aux trois grands réseaux déployés à l’échelle mondiale : le réseau de données Internet, le réseau téléphonique et le réseau de diffusion TV.
Jusqu’à présent, la spécialisation était la caractéristique principale de ces moyens de communications puisque chaque réseau permettait l’accès à un service particulier à travers une infrastructure particulière. Ceci obligeait les utilisateurs à s’abonner aux trois réseaux et à utiliser un terminal spécifique pour accéder aux services transmis par chacun d’eux. Cette situation commence à changer graduellement grâce aux évolutions technologiques réalisées durant ces dernières années. En effet, la numérisation des données et l’élaboration de nouveaux standards et de nouveaux composants électroniques de plus en plus petits et de plus en plus performants, ont permis aux réseaux de devenir numériques, sans fil et mobiles. Aussi, l’augmentation des capacités de transmission a permis la multiplication des services sur toutes les infrastructures. Par conséquent, les barrières qui séparaient auparavant les différents types de réseaux de communications commencent à céder les unes après les autres et les terminaux d’accès deviennent multimédia et multiservices intégrant plusieurs interfaces de communication leur permettant de se connecter à différents réseaux. Actuellement, les acteurs des télécommunications s’acheminent vers la notion de convergence qui regroupera tous les réseaux et tous les services sous une seule infrastructure censée représenter le réseau de nouvelle génération NGN (Next Generation Network). Les différents acteurs s’accordent à dire que la technologie IP sera la brique de base pour bâtir les NGNs. En effet, la simplicité et la puissance du protocole IP, démontrées dans les réseaux Internet, fait de ce dernier la technologie de prédilection qui offre un compromis entre le coût de déploiement et l’efficacité de fonctionnement. La technologie IP est confortée par le concept Tout-IP dont l’objectif est de faire migrer tous les services traditionnels vers la technologie IP. Toutefois, la réalisation des NGNs engendre plusieurs défis techniques (Qualité de Service, hétérogénéité, sécurité, handover, etc.) qu’il faudra relever pour basculer définitivement d’un concept théorique vers une architecture réellement exploitable. La problématique de la qualité de service, représente l’un des plus grand défis. En effet, les services de téléphonie et de diffusion TV possèdent des contraintes de QoS difficiles à respecter dans les réseaux actuels de données et plus particulièrement dans les réseaux d’accès sans fil du standard 802.11. C’est dans ce cadre là que s’inscrivent les travaux de cette thèse, proposer des solutions de maîtrise de la QoS pour le support d’applications temps réel et multimédia dans les réseaux locaux sans fil afin de faciliter leur intégration dans les NGNs.
Les réseaux locaux sans fil (Wireless Local Area Network ou WLAN) ont reçu ces dernières années un grand succès grâce à leur simplicité, rapidité et faible coût de déploiement. Dès lors, ils constituent une alternative sérieuse aux réseaux locaux filaires. On commence d’ailleurs à les trouver partout : dans les aéroports, les hôtels, les bureaux et ainsi que dans les environnements domestiques. Cependant, l’utilisation de ces réseaux est limitée aux services de données et elle n’est pas encore étendue aux services de la voix ou de la vidéo.
L’un des domaines d’utilisation future du WLAN . C’est le cas du réseau domestique dans lequel le câblage disparaît complètement et tous les équipements (ordinateurs fixes et portables, téléphones, télévisions, PDAs, imprimantes, lecteurs DVD, etc.) communiquent ensemble via des liaisons radio utilisant différentes technologies sans fil. Tous ces équipements accèdent au réseau internet via le point d’accès lequel utilise la technologie sans fil définie pas le standard 802.11.
Le scénario d’utilisation décrit ci-dessus ne peut pas être envisagé à ce jour car il reste encore plusieurs verrous inhérents à la nature sans fil de ces réseaux qui ne sont pas complètement résolus. L’un de ces verrous est lié à la méthode d’accès de base DCF (Distributed Coordination Function) et son incapacité à garantir la QoS requise par les applications temps réel et multimédia ; applications dont le besoin de leur support sur les réseaux informatiques continue à croître jour après jour.
En 1999, le standard 802.11 a définit la méthode d’accès distribuée DCF. Cette dernière a été conçue pour le support unique des applications élastiques de transfert de données et du web, et il n’a pas été prévu initialement que le standard DCF puisse être utilisé par les applications exigeantes en termes de QoS comme la voix et la vidéo. Dès lors, 802.11 DCF a été incapable d’assurer la performance demandée par ce type d’applications. La présence de cette limitation accompagnée du besoin croissant du multimédia a poussé les activités de recherche à investiguer et proposer différentes solutions possibles capables d’améliorer la performance des WLANs. Parmi ces différentes solutions, une solution basée sur la différentiation de service a été retenue par l’IEEE 802.11 qui a fondé un groupe de travail qui a aboutit en 2005 à la standardisation d’un amendement de QoS appelée 802.11e. Dans cet amendement, DCF a été remplacée par EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) qui supporte quatre catégories d’accès (Access Category ou AC), chacune possède ses propres paramètres d’accès : Arbitration Inter Frame Spacing (AIFS), Contention Window (CW) et Transmission Opportunity Limit (TXOPLimit). La priorité de chaque catégorie d’accès est définie par les valeurs des ces paramètres qui ne sont pas fixes comme dans DCF mais ajustables selon les besoins.
802.11e EDCA a réussit à améliorer la performance du 802.11. La différentiation de service qui y est introduite a aboutit à de bons comportements du protocole avec les applications ayant des contraintes de QoS. Cependant, aucune garantie de QoS ne peut être assurée par EDCA surtout lorsque le réseau est saturé. Plusieurs études d’évaluation d’EDCA ont démontré cette limitation, et plusieurs propositions d’amélioration ont essayé de résoudre ce problème. Cependant, ces propositions pour l’amélioration des performances d’EDCA restent limitées par le problème de dégradation des performances dans les conditions de saturation du réseau. En effet, ces améliorations ne proposent toujours pas de garanties de QoS.
De ce fait, nous avons aboutis à la conclusion que la maîtrise de la QoS dans 802.11e EDCA ne peut être assurée que par un mécanisme de contrôle d’admission efficace qui empêche le réseau d’atteindre un état de saturation importante et qui permet par la même de garantir les besoins de QoS des applications multimédia. C’est dans cet objectif là que s’inscrivent les contributions dans cette thèse.
Chapitre 1 Introduction |