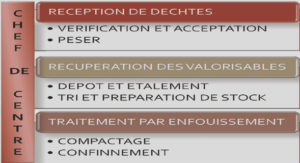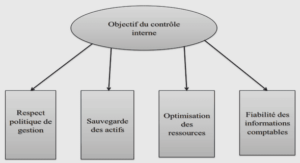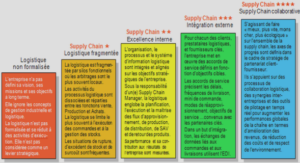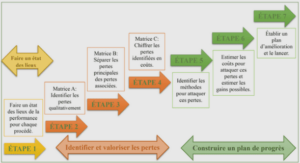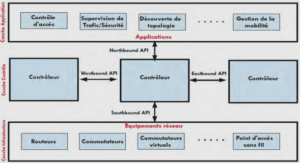MODELES FONCTIONNEL ET DE LA MESURE DE L’OBSERVATEUR EXPERIENTIEL
« Pour quoi est fait l’Observateur Expérientiel ? »
Un agentiel d’observation de pratiques sociales situées (modèle de la mesure) Notre présentation du modèle fonctionnel de l’Observateur Expérientiel débute donc par la question : « pour quoi est-il fait ? ». Nous présentons d’abord notre domaine empirique (situations d’activités des adhérents) puis nous justifions le rôle de l’Observateur Expérientiel par rapport à ce dernier. Dans la première partie de cette thèse nous avons défini les situations d’activités comme le cours d’actions des interactions de services. Nous avons montré que ces dernières n’étaient pas prises en compte totalement.
En effet, l’analyse des situations d’activités dans les pratiques de gestion de l’expérience client se limite à l’étude de la consommation du service, des points de contact (le parcours client) et à l’activité de l’entreprise (les processus clients). La vision hors produits, ou hors services, des assurés n’est pas pris en compte. En d’autres termes, toutes leurs situations de vie sont omises. C’est ce que nous entendons ici par situation d’activité.
L’Observateur Expérientiel doit donc permettre de saisir ces situations d’activités et de développer un marketing situé. Mais alors, si les situations d’activités sont toutes les situations de vie, comment les saisir ? Quel cadre théorique utiliser ? Ici nous avons retenu de nous inscrire dans le paradigme de l’action située (Relieu et al., 2005) en écho aux critiques que nous avons porté aux pratiques de gestion de l’expérience client dans la partie 1.
Un point important est le concept de situation naturelle : « Les situations de laboratoires comme terrain privilégié d’analyse de l’action et de la cognition ont été abandonnées au profit des situations dites « naturelles ». Cette prééminence donnée aux études naturalistes menées en situation non-contrôlée est d’ailleurs à l’origine d’une confusion fréquente entre « situé » et « en situation naturelle » (Relieu et al., 2005, p.7). Pour saisir les situations d’activités (domaine empirique)
« Quelles sont les données mobilisées ? » : Vidéos de situations d’activités en milieu urbain
Dans notre premier chapitre, nous avons noté que les traces numériques (Champin et al., 2013) sont un matériau d’observation privilégié pour les situations d’activités. Lorsque l’on évoque des traces numériques d’une d’activité, quasiment tous les types de matériaux sont possibles. Des traces écrites qui peuvent être des retours de satisfaction, des courriels, des commentaires sur des réseaux sociaux ou non, exploitées au moyen de techniques de Natural Language Processing (NLP) comme chez (Delalonde, 2007) ou (Calvez, 2015). Des traces audio (Mengoni et al., 2017), issues d’enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’ambiances sonores. Des traces visuelles et audiovisuelles (Seng et Ang, 2018) a l’instar des vidéos à la première personne ou des vidéos en plan fixe.
Des traces neurologiques issues des études d’analyse de l’activation du cerveau (Sun et al., 2020). Des traces physiologiques : Gilles BEAUDON Projet de recherche entre LMG et UTT 22/02/2021 Thèse de doctorat G. Beaudon – Version finale 168 captation du rythme cardiaque, détection des mouvements des yeux ou encore détection des mouvements du visage (Generosi et al., 2018). Des traces physiques comme des relevés GPS de déplacement (Sturari et al., 2016) ou (Calvez, 2015).
Des traces structurées issues des journaux d’enregistrement d’activités (Laflaquière et al., 2006). Idéalement, en suivant le modèle organique de l’expérience et les méthodes ethnographiques classiquement appliquées pour observer les pratiques sociales situées, il aurait été idéal de combiner l’ensemble de ces types de traces pour obtenir un résultat le plus proche possible de la situation naturelle.
Cependant, nous n’avons pas été en mesure de le faire, notamment à cause de la difficulté d’accès aux données, des délais d’acquisition trop importants ou encore de la complexité du traitement de ces données qui ne nous était pas accessible. Pour développer l’Observateur Expérientiel et l’observation de situations d’activités, nous nous sommes centrés sur les vidéos. D’une part, car dans le premier chapitre, le potentiel des vidéos dans le domaine de l’expérience client a été prouvé.
D’autre part, car les données de type vidéo permettent de s’astreindre aisément de la dimension cognitive des personnes et que la dimension spatio-temporelle est nativement intégrée, ce qui fait le lien avec la méréotopologie (Beaudon et al., 2020). Ainsi, nous répondons à la première partie de la question « à partir de quoi est fait notre modèle » : des vidéos, mais il convient aussi de nous intéresser à la constitution de notre jeu de données (dataset) pour l’observation de pratiques sociales situées.