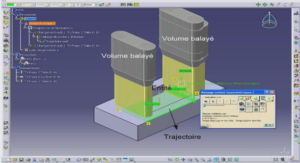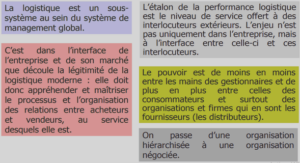Modèles économiques des IDS
Valeur des IDS Il s’agit à présent de préciser comment appliquer ce cadre d’analyse et ces méthodes aux IDS.
De la valeur de l’information à la valeur d’une infrastructure d’information spatiale
Bien que les enjeux économiques des IDS soulèvent différents problèmes, une base commune repose sur la valeur économique de l’information. Depuis les années 1970, l’économie de l’information occupe une place centrale dans le domaine de l’organisation industrielle où il s’agit avant tout de mieux comprendre les enjeux des asymétries d’information entre agents et comment en réguler les effets dommageables. Dans une société qui multiplie les dispositifs d’observation et accroît à un rythme accéléré sa capacité de stockage, de transformation et de diffusion, les questions de valeur de l’information se posent avec une acuité particulière.
L’information peut être utilisée sans être consommée, reçue sans le vouloir, ayant ainsi des caractéristiques de bien public*. Du point de vue économique, la valeur de l’information reflète l’importance de sa contribution à l’amélioration des décisions ; c’est-à-dire au fait qu’elle permet de mieux guider les choix vers des situations socialement préférables. Dans cette perspective, la valeur d’une IDS est donc celle d’un investissement qui permet de générer et de gérer l’amélioration de l’information.
La valeur d’une IDS se calcule donc comme la somme actualisée des avantages futurs espérés de ces gains informationnels (Δinfo) : 𝑽𝑰𝑫𝑺 = ∑ 𝑽𝒕 (𝜟 𝒊𝒏𝒇𝒐) 𝒕=𝑻 𝒕=𝟎 /(𝟏 + 𝒂) 𝒕 T étant la durée de vie de l’IDS ou de l’investissement considéré, a le taux d’actualisation*. En adaptant l’équation classique qui définit la valeur actualisée nette (VAN), l’évaluation ex ante de l’investissement dans une IDS devient : 𝑽𝑨𝑵𝑰𝑫𝑺 = −𝑰 +∑ (𝑽𝒕 (𝜟 𝒊𝒏𝒇𝒐) 𝒕=𝑻 𝒕=𝟎 − 𝑪𝒕)/(𝟏 + 𝒂) 𝒕 I étant l’investissement initial et Ct les coûts annuels de fonctionnement et de maintenance. Cette présentation qui peut paraître évidente, doit cependant être considérée avec discernement.
Les recherches en sociologie de la décision ont mis en évidence la difficulté d’identifier le moment où sont faits les choix et les théories économiques de la décision analysent comment, avec une information donnée, prendre les meilleures décisions telles qu’elles ressortent de critères généraux (comme la maximisation de l’espérance d’utilité*). Le problème de l’acquisition de l’information ne vient qu’ensuite et sa valeur de l’information est souvent restée une question un peu académique qui l’assimile avec les avantages retirés de la possibilité de réviser ses choix lorsqu’une amélioration de l’information met en évidence que cette révision est avantageuse.
Ce gain est exprimé par le concept de « valeur d’option » (Encart 2.6) : Encart 2.6. : Précisions sur le concept de valeur d’option La valeur d’option est l’avantage, mesuré en gain d’espérance d’utilité de la préservation d’une option future de choix. Ce gain est a priori positif ou nul et il est étroitement lié à l’amélioration de l’information entre deux moments : celui où le choix est fait et celui où une option sera définitivement réalisée (après que l’information sur ses conséquences sera connue). La valeur d’option prend de l’importance si le contexte de la décision remplit trois conditions : Incertitude sur la réalisation future des états du monde ; Information croissante ; Irréversibilité de certaines options de choix.
La notion d’irréversibilité joue ici un rôle central. Elle est définie comme le fait que certaines options ont pour effet de réduire l’éventail des choix futurs. Son importance tient au fait que si, dans le futur, l’amélioration de l’information devait conduire à souhaiter changer d’option, la disparition de ces options rendrait ce changement adaptatif impossible. La valeur économique de l’information serait donc nulle puisqu’on ne pourrait pas en tirer avantage. Si toutes les options sont réversibles sans coût spécifique (si la réversibilité est coûteuse, on est ramené au cas irréversible avec des calculs plus compliqués), alors la valeur de l’information se mesure par l’anticipation de l’amélioration potentielle de la situation qui résulte de sa prise en compte. Cette anticipation suppose de pouvoir représenter tous les scénarios probables et d’en évaluer les conséquences ; ce qui est évidemment une hypothèse très contraignante.
Spécificités économiques des modalités d’accès à l’information
valorisation des IDS et tarification des produits L’un des apports souvent mis en exergue en matière de fonctions des IDS concerne les gains liés à la mutualisation des traitements et des images. Dans une perspective statique, la mutualisation des images permise par une IDS est cependant assez ambiguë : en première approximation, on pourrait considérer que l’IDS ne joue qu’un rôle d’intermédiaire entre les producteurs d’image et une large diversité d’usagers, sans autre effet que de maîtriser un réseau de diffusion. En l’absence d’IDS, on peut penser que les producteurs d’images essaieraient de les vendre directement aux usagers potentiels, à leur coût marginal* (qui peut être assez élevé, bien que très difficile à calculerEncart 2.7) ou bien à des prix incitatifs assez arbitraires ou liés à une politique commerciale pour développer l’usage de ces produits.
Encart 2.7. : Précisions sur la notion de tarification au coût marginal La notion de tarification au coût marginal a été discutée et clarifiée dans les années 1950-60, en particulier en réponse aux questions soulevées par la tarification de l’électricité en France. Pierre Massé et surtout Marcel Boiteux ont été les principaux contributeurs à ce débat international. La tarification au coût marginal, principe traduisant l’efficacité économique, est confrontée au « paradoxe du voyageur de Calais » (Allais, 1989), parabole qui met en évidence que le coût marginal d’un voyageur supplémentaire dans un train sur le trajet Paris-Calais dépend de la situation de référence :
quasi nul s’il y avait des places libres, mais s’élevant en fonction du niveau d’investissement (voiture supplémentaire, train supplémentaire, voie supplémentaire) éventuellement nécessaire pour l’accueillir. La solution, parfois qualifiée de « coût marginal de développement », consiste à intégrer dans le coût marginal l’amortissement des investissements8 rendus nécessaires (ou considérés comme tels dans les scénarios de développement retenus) par une demande croissante.