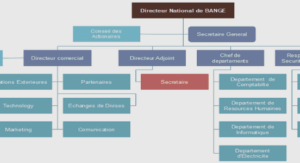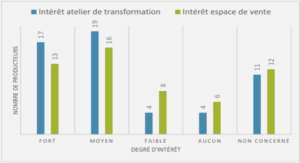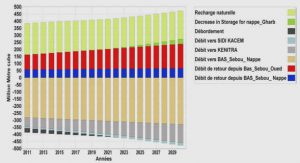La station de traitement des eaux de Draa El Mizan est construite dans la daïra de Draa El Mizan située à 40 km de Tizi Ouzou. Elle est construite en décembre 2008 pour alimenter en eau potable la ville de Draa El Mizan. La capacité de la station s’élève à 105 m³ /h, soit une production quotidienne de 2520 m³.
L’eau à traiter est transportée d’un lac de barrage vers la station de traitement par un pipeline à partir d’une pompe immerge dans le lac de barrage. Lors de la conception de l’installation, l’analyse de la qualité d’eau brute est basée sur une étude prés établie.
L’eau potable d’une qualité correspondante aux normes standards de l’OMS (Organisation Mondiale de la Sante) est directement reliée à la station de pompage, qui pompe cette eau vers deux réservoirs de capacité de 800 m³ , situés à la proximité de l’habitat ensuite, distribuée aux abonnes par un système de gravitation.
Présentation de la station
La station est conçue et disposée comme des conteneurs de conception modulaires, à raison d’une capacité quotidienne de 2520 m³ . La station comprend plusieurs unîtes :
Unité d’alimentation et distribution de l’eau brute
L’eau brute pompée du lac du barrage vers la station de traitement par une pompe immergée dans le lac de barrage et un pipeline disposant d’un filtre à tamis installe en amont de la vanne de réduction de pression afin de protéger celle-ci des débris, d’une capacité de 105 m³ /h, maintenue à l’aide d’un contrôleur de pression. La distribution est assurée par une canalisation, construite à base des tuyaux en acier ST-37 à bride soudes longitudinalement, sables et revêtues d’une couche d’époxy d’une épaisseur minimale de 200 micromètres. La boulonnerie sera en acier galvanise avec joints à bague en caoutchouc, qui finit par un distributeur via la section SF12 et SF13.
Il dispose des points d’injection des produits chimiques, avec en amont un mélangeur statique remuant 105 m³/h d’eau brute avec les produits chimiques et en avale un débitmètre.
Unité de préparation de produits chimiques
Pour l’alimentation de la station de traitement complète, des réservoirs centraux à deux bacs de préparation de produits chimiques sont prévus. Les bacs de préparation et de stockage des solutions sont en béton armé avec un revêtement interne compatible avec le produit utilisé. Chaque bac est équipé de :
➤ Une arrive d’eau de dilution ;
➤ Un trop-plein ;
➤ Une vidange avec robinet ;
➤ Un orifice de sortie avec robinet d’isolement ;
➤ Un électro-agitateur y compris sa commande locale.
Le bâtiment existant comprend également :
➤ Un local de préparation et de dosage ;
➤ Un local des suppresseurs pour les unîtes existantes ;
➤ Un bureau ;
➤ Un laboratoire ;
Les produits chimiques sont utilises pour la désinfection, la floculation et l’ajustement du PH d’eau brute. Ils comprennent le chlore, le sulfate d’aluminium, le polymère et le carbonate de sodium. Le dosage des produits chimiques varie selon la qualité d’eau brute.
Chloration
Le chlore est prépare en solution de 12.5%. On a deux points d’injection de chlore :
a- La prèchloration
Pour l’oxydation de la matière organique et minérale, à la moyenne de 1 mg/l. une pompe de dosage injecte la solution dans la conduite d’arrivée de l’eau brute.
b- La postchloration
Pour la désinfection et garantir l’eau potable le long du réseau, avec une moyenne de 0.8 mg/l et au final (consommateurs). Un résidu de 0.1 à 0.2 mg/l (la consommation du chlore dans le réseau sous l’effet de la corrosion et l’entartrage oxydante). Une pompe de dosage injecte la solution dans le collecteur des conduites de sortie des filtres.
Sulfates d’aluminium
Pour la turbidité, injectée à la moyenne de 2 mg/l. Il a pour rôle :
a- La coagulation : qui consiste à la neutralisation des charges.
b- La floculation : la formation des flocons
Une pompe de dosage injecte de la solution dans la conduite d’arrivée de l’eau brute.
Polymère
Utilise comme adjuvant de floculation, injecté à la moyenne de 0.2 mg/l, pour la formation de flocon plus dense ainsi facilite la décantation et avoir une bonne sédimentions. Une pompe de dosage injecte la solution dans la conduite d’arrivée de l’eau brute.
Carbonate de sodium
Pour ajuster le PH au voisinage de 6.8 à 7.3, car l’efficacité de la coagulation n’est présenté que lorsque le PH se situe en dessous de 7.4 dans ce cas on utilise du sulfate d’aluminium. Une pompe de dosage injecte la solution dans la conduite d’arrivée des eaux brutes.
Unité de traitement des eaux brutes
Elle est constituée de deux sections SF12 et SF13 à trois chaine de traitement chaque une. Une chaine de traitement est conçue comme suite :
Un réservoir de floculation et de sédimentation
Il a les dimensions d’un conteneur de 12.2 m et sera devise en trois compartiments : Un réservoir de floculation pour la floculation, un réservoir de sédimentation à lamelle à une capacité d’environ 52 m³ . Les lamelles intégrées se composent de profiles en plastique de forme alvéolaire. La surface de sédimentation effective est la projection horizontale de toutes les faces supérieures des alvéoles. Dix vannes de boue, garantissent l’évacuation des boues et un réservoir d’eau claire d’une capacité d’environ 12.5 m³ est raccorde à la suite de chaque réservoir de sédimentation ; ainsi, on dispose d’une réserve d’eau claire d’environ 37.5 m³ pour chaque section. Chaque réserve d’eau claire est supervisée par un détecteur de niveau (transmetteur de pression) avec un point de contact de niveau bas, protection contre la marche des pompes intermédiaires et niveau bas contre le débordement.
Pompes intermédiaires
Pompes centrifuges horizontale avec vanne coté aspiration et coté refoulement et clapet de retenue pour l’alimentation et le rinçage de filtre. La pompe est montée avec un moteur à accouplement, boitier de protection et accessoires, sur une fondation en béton. Le tout pour une capacité d’environ 105 m³/h.
Filtres sous pression
Chaque filtre à sable raccorde à la suite du décanteur par l’intermédiaire d’une pompe et se présente sous la forme d’un cylindre de 2400 mm de diamètre par 5000 mm de longueur, disposant de trois couches de sable gravier, moyen et fin, a pour rôle de retenir les particules résiduelles qui peuvent être encore dans l’eau décantée, d’une surface de filtration de 10.8 m² . Avec une filtration de 115 m³/h, la vitesse de filtration s’élève à 10.7 m/h. les filtres sont rinces à contre courant à l’air à raison de 60 m³/h et à l’eau à raison de 27 m³/h. à l’entrée et sortie de chaque filtre est place en manomètre ainsi indiquant la pression d’entrée et de sortie.
Introduction générale |