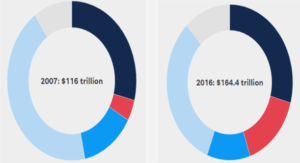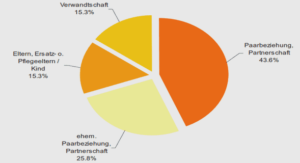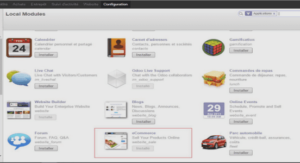Modèle de Stephan (2007)
Justification du choix du modèle
Bien que la culture entrepreneuriale soit issue de la culture nationale dans le sens le plus large. Johanissone (1991) 489 définit la culture entrepreneuriale comme « une culture qui valorise les caractéristiques personnelles associées à l’entrepreneuriat : l’individualisme, la marginalité, le besoin de réalisation personnelle, la prise de risque, la confiance en soi et les habilités sociétales ; qui valorise également le succès personnel tout en pardonnant l’échec, qui encourage enfin la diversité et non l’uniformité et encourage le changement et non la stabilité ».
Même si beaucoup d’attention a été portée par le passé sur l’entrepreneur, ses traits et caractéristiques, il n’en demeure pas moins que ces attributs sont liés à son milieu de vie social et culturel (Borges, Simard et Filion, 2005)490. Tel que le souligne Julien « si les entrepreneurs et les organisations sont les conditions nécessaires pour soutenir le développement, un milieu entrepreneurial et innovateur constitue la condition suffisante pour l’assurer » (2005, page 153). C’est ce milieu qui recèle la ressource indispensable à l’entrepreneuriat : une culture qui stimule et soutient les initiatives d’affaires. De l’avis de plusieurs, la culture d’un pays, ses valeurs, croyances et normes ont une influence sur l’orientation entrepreneuriale de ses citoyens (Busenitz et Lau, 1996; Davidsson et Wiklund, 1997).
Pour Julien un milieu sera doté d’une culture entrepreneuriale s’il démontre « cette attitude ou aptitude par laquelle une société territoriale reconnaît et stimule chez les entrepreneurs les valeurs personnelles et les habiletés de gestion, et leur permet donc de mettre à profit dans des expériences diverses leur esprit d’initiative, leur sens du risque ainsi que leur capacité d’innover et de gérer efficacement leurs relations avec l’environnement » (2005, pages 160 et 161). Cette définition rejoint celle de Morrison491 décrivant une telle culture : « as one in which a positive social attitude towards personal enterprise is prevalent, enabling and supporting entrepreneurial activity » (2000, page 61).
On voit donc l’importance que revêtent les valeurs qui sont mises de l’avant dans la société. Davidsson et Wiklund (1997) ont pour leur part cherché à identifier les dimensions de la culture du milieu susceptibles d’expliquer les disparités régionales en termes de taux de création d’entreprises. Les dimensions étudiées ont été regroupées sous les valeurs et les croyances des habitants d’une région donnée. Les valeurs correspondent aux attitudes généralement associées à l’entrepreneuriat (besoin d’accomplissement, d’autonomie, etc.) alors que les croyances visent des concepts davantage liés à la culture tels le statut social de l’entrepreneur ou sa contribution à la société. À l’aide de ces variables, il a ainsi été possible de discriminer entre huit régions différentes de la Suède mais non de façon très convaincante. Qui plus est, il n’a pas été possible d’identifier les dimensions des valeurs ou croyances expliquant le mieux les disparités régionales en termes d’entrepreneuriat.
Relation entre culture et intention entrepreneuriale
Le concept d’intention entrepreneuriale requière un intérêt particulier vu son caractère médiateur entre l’acte de création et les facteurs exogènes (traits de personnalité, caractéristiques démographiques, croyances, etc.). En effet, il permet d’expliquer le phénomène de l’émergence organisationnelle quand il s’agit des comportements intentionnels (Reitan, 1996)495. Généralement, les recherches sur l’intention entrepreneuriale (Krueger et Carsrud 1993 ; Davidsson, 1995 ; Kolveried, 1996 ; Tounès, 2003 ; Emin, 2003 ; Fayolle et al., 2005 ; Moreau et Raveleau, 2006)- en se basant sur la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) et sur la théorie de l’événement entrepreneurial (Shapero et Sokol, 1982)- se référent à deux éléments explicatifs de ce concept :
la désirabilité perçue (ou norme subjective perçue et attitude envers le comportement) et la faisabilité perçue (contrôle perçu) de l’acte d’entreprendre (Krueger et Carsrud, 1993). En explorant les fondements de ces variables, certains auteurs (Krueger et al., 2000 ; Autio et al., 1997) notent un changement des effets de l’attitude, de la norme sociale perçue et du contrôle perçu d’un contexte à un autre. Dans cette perspective se pose la question de l’encastrement social des entrepreneurs (Granovetter, 1985) 496 ou encore le rôle joué par les variables socioculturelles dans l’intention entrepreneuriale.
Par ailleurs, Vesalainen et Pihakala (1999) estiment que l’entrepreneuriat est influencé par deux écoles : « l’école humaine » (people school) et « l’école environnementale »(environmental school). C’est cette dernière approche qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette recherche. L’entrepreneuriat se nourrit de l’existence de conditions culturelles et structurelles. Par conséquent, la culture entrepreneuriale apparaît comme un des facteurs les plus susceptibles d’influencer l’intention de créer une entreprise. Davidson et Wiklund (1997) affirment que la culture d’un pays, ses valeurs et ses croyances influence la décision d’entreprendre et ce en cherchant à identifier les dimensions de sa culture.