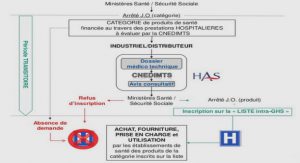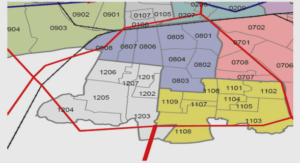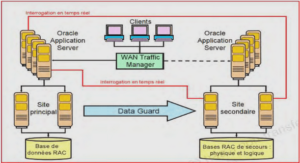Modèle conceptuel d’accès aux ressources informationnelles
Après la proposition d’un pouvoir d’expression propre au bassin du Congo, faite au chapitre 4, nous allons dès à présent construire le modèle conceptuel qui s’y rapporte. Tel est l’objet du présent chapitre, qui se compose de quatre parties se déclinant de la manière suivante : – Dans le premier paragraphe nous situons le rôle des métadonnées dans la recherche d’information.
– Dans le second paragraphe, nous présentons la norme ISO 19115 et montrons en quoi celle-ci est utile dans le cadre de notre modèle. – Le troisième paragraphe quant à lui présente toute la mise en œuvre du modèle. – Enfin nous terminerons le chapitre par une synthèse suivie d’une conclusion.
Le rôle des métadonnées dans la recherche des informations
Ce paragraphe situe le rôle que les métadonnées jouent dans le cadre de la recherche d’information au moment où celles-ci évoluent à une vitesse vertigineuse. Nous allons ciaprès situer la place et le rôle des métadonnées dans la société de l’information qui est la nôtre. Une société de l’information La société dans laquelle nous vivons se caractérise par un foisonnement informationnel sans précédent. Aujourd’hui, la façon de diffuser l’information prédomine sur le contenu lui-même au point que notre société a été qualifiée de société de l’information [McLuhan, 1964], [Popovici et al, 2006], [Auffret, 2005].
Face à ce déluge informationnel, deux canaux font autorité comme moyen de diffusion des informations et supplantent tous les autres, à savoir : la télévision et l’Internet. En ce qui concerne la télévision, elle est devenue un média de masse du fait qu’elle capte l’attention exclusive de millions de foyers à travers le monde et ce quel que soit son contenu [Vuillemot et al, 2007], contenu qui du reste, a un caractère éphémère, du fait que le téléspectateur capte passivement l’information à l’instant.
Pour ce qui est de l’Internet, notamment sa partie web, c’est un fabuleux gisement planétaire d’information ; mais une information avec laquelle l’internaute peut interagir (recherche, sélection, capture, diffusion, publication, …), car l’Internet est un média interactif. Il est de nos jours, le principal pilier sur lequel s’appuient les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Son principal problème (qui peut éventuellement être un atout) réside dans le Modèle conceptuel d’accès aux ressources informationnelles 150 fait qu’on l’assimile de plus en plus à une jungle, parfois même une poubelle dans laquelle on retrouve toutes sortes d’informations [Serres, 2004].
Pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de recherche d’informations, les concepteurs des solutions orientées web se sont efforcés d’élaborer des techniques et des méthodes de recherche novatrices. Le but visé dans ces travaux a été de proposer aux utilisateurs des moteurs de recherche efficaces, qui leur fournissent des résultats moins bruités, c’est-à-dire, contenant le moins possible d’informations non-désirées. Au nombre des techniques proposées pour rechercher l’information nous avons l’utilisation des métadonnées. Pour bien comprendre leur importance, il nous paraît important de revisiter brièvement ce concept.
Le rôle des métadonnées
L’expression « ancilary data » était autrefois l’appellation du terme ‘‘métadonnées’’. Son utilisation est récente [Gail Hodge, 2001]. Il comporte un préfixe « méta », qui signifie en grec « après » ou « ce qui dépasse, englobe». C’est la raison pour laquelle on désigne les métadonnées comme des données sur les données ou bien les informations qui renseignent sur des informations et qui permettent ainsi leur utilisation pertinente [Bergeron, 1993]. Au début, l’usage des métadonnées s’est fait de façon disparate dans plusieurs domaines d’activités (archivages, bibliothécaires, etc.).
C’est donc dans un souci d’échange d’informations que les premières initiatives de standardisation ont vu le jour [Servigne et al, 2005]. Ces initiatives ont conduit à la mise en place de standards élaborés par chaque communauté d’utilisateurs. Ces standards ont par la suite donné lieu à des normalisations par des organismes autorisés [Lesage, 2008]. A ce jour, il existe une quinzaine de standards parmi lesquels le Dublin Core (DC) que l’on peut considérer comme le noyau des autres normes, le Learning Object Metadata (LOM), l’Encoding Archive description (Description archivistique encodée), ISO 19115, FGDC76, etc.
Toutes ces normes sont complémentaires les unes les autres dans leurs objectifs [Morel-Pair, 2007]. Au moment où la société actuelle est l’objet d’un mouvement d’intégration sans précédent, les organismes ont été mis face à de nouveaux défis notamment ceux des économies fondées sur 76 Federal Geographic Data Commettee 151 le savoir dont les technologies de l’information constituent le support indispensable [Cardon et al, 2008]. A ce titre, l’apport des solutions orientées Système d’Information Géographique (SIG) qui se basent sur les métadonnées ne méritent pas de discussion [Servigne et al, 2005]. En effet, là où régnait l’hétérogénéité des supports et le hiatus entre les traitements (analyse visuelle, dénombrement, calculs statistiques), les métadonnées offrent une gestion continue et intégrée de l’information [Joliveau, 2003], [Servigne et al, 2005].