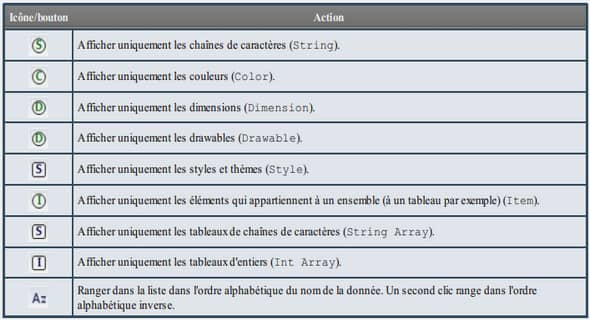Le Métaphores et symboles dans les contes : Kirikou et la sorcière
Pour achever ce parcours autour de la question de la métaphore et de l’inconscient, quelques mots maintenant sur ces métaphores en partie d’origine inconsciente telles qu’on peut en percevoir dans les œuvres. On a déjà signalé, à propos des contes de fées étudiés par Bettelheim, par exemple, la possibilité d’interpréter des éléments de récits comme des « métaphores », des symboles : la métaphore s’y révèle très proche du symbole, en effet, comme lorsque les géants figurent les adultes, mais il faut rappeler que l’une comme l’autre ne sont pas réalisés. La métaphore surtout correspond dans les contes à ce que j’ai appelé la métaphore potentielle. L’image des adultes peut être projetée sur celle du géant, ou celle d’une marâtre bien réelle sur celle de la sorcière, et ce d’autant plus aisément qu’une projection semblable a très vraisemblablement motivé l’invention du conte. Que l’association initiale ait été consciente ou non, par exemple entre le sommeil de cent ans de « La Belle au bois dormant » et la période de latence de l’enfant, n’y change rien : les contes qui plaisent le plus sont ceux qui ont réussi à donner une forme, par un travail conscient ou préconscient, à l’association initiale, une forme dont les virtualités de signification sont particulièrement bien délimitées. Il en va de même d’ailleurs pour les symboles dont l’origine n’est pas métaphorique, comme la cabane du troisième petit cochon qui peut s’interpréter comme figurant la possibilité d’un compromis entre principe de plaisir et principe de réalité : si le principe de plaisir n’est évidemment pas une notion présente à l’esprit de l’enfant, et si elle n’était pas à la disposition de l’auteur, le plaisir du jeu n’en est pas moins mentionné très explicitement dans « Les Trois Petits Cochons ». Néanmoins, la cabane apparaît avant tout comme une cabane, et les trois animaux comme des personnages : le symbole et la métaphore ne sont pas clairement perçus comme tels. Mais, en même temps, si l’histoire plaît, c’est en raison des virtualités de signification des trois cabanes et des trois petits cochons qui, pour multiples qu’elles soient, sont toujours précisément orientées et toujours plus ou moins confusément perçues. Le terme de symbole convient donc bien : même s’il a été bâti à partir d’une métaphore, et s’il peut être à nouveau utilisé au sein d’une métaphore, comme la figure du géant ou de la sorcière, cette potentialité de signification correspond à la nature du symbole, à sa surdétermination par de nombreuses significations possibles. Aussi le chasseur peut-il apparaître comme une image du père protecteur : il est celui qui terrasse les bêtes féroces. À la base de ce symbole, étudié dans Psychanalyse des contes de fées, il y a par exemple l’analogie entre les « tendances animales, asociales et violentes de l’homme » et les bêtes fauves.564 Mais, si l’on parle ici de symbole et non de métaphore, c’est non seulement que la tension de la métaphore (entre comparé et comparant) n’existe plus vraiment, qu’elle s’efface au profit d’un lien beaucoup plus étroit (entre signifié et signifiant), non dialectique (ou alors, si l’on conserve comme Ricœur l’idée d’une dialectique, ce qui se justifie dans le symbole vivant, il faut dire qu’il s’agit d’une dialectique bien différente, « verticale »), mais c’est aussi que la signification du symbole n’est pas forcément présente à la conscience du lecteur, de l’auditeur. Même si celui-ci perçoit confusément le loup ou le chasseur comme une figure familière porteuse de significations, faisant écho à quelqu’un ou à quelque chose de connu, le personnage ne s’impose pas clairement à la conscience comme un symbole. Il en va de même, on l’a vu, pour les trois petits cochons qui représentent une évolution au sein de l’enfance, ou pour la forêt de ronces et d’épines qui entoure le château de la Belle au bois dormant. C’est d’ailleurs ce qui rend le symbole si efficace : l’enfant peut projeter sur celui-ci la force qui lui ressemble le plus, parmi celles qu’il connaît – sur l’aîné des cochons, le courage et la persévérance dont l’enfant aura fait preuve dans telle ou telle occasion, et sur le chasseur la force protectrice qu’il aura reconnue dans tel ou tel adulte, voire dans sa propre psyché. Il y a donc métaphore sous le symbole et métaphore à nouveau, éventuellement, sous la plume de l’analyste. Alors, et alors seulement, l’image peut retrouver une certaine équivocité, différente de celle du symbole utilisé et/ou façonné dans un conte : Bettelheim précise par exemple que « le chasseur des contes de fées n’est pas un personnage qui tue d’innocentes créatures » et l’enfant peut constater, dans un second temps moins marqué par l’empathie, que si les adultes ressemblent parfois à des géants, à des ogres, il y en a, parmi eux, qui lisent des histoires aux enfants, qui compatissent aux déboires du jeune héros et prennent plaisir à ses victoires. Autrement dit, pour que le conte ait une efficacité, il est indispensable que le symbole ne soit pas perçu immédiatement, ou en lui-même, comme une métaphore : là où le symbole s’impose, consciemment ou non, là où il ne saurait être discuté, la métaphore apparaît souvent relative, discutable. Rien n’empêche, en revanche, que le symbole soit interprété ensuite comme une métaphore – qu’il en soit le support, le point de départ, ou la gangue, l’enveloppe qui lui succède et dont on la débarrasse. Ce sommeil de la métaphore dans le symbole, le rapport « absolu » de celui-ci à la signification – qui, certes, peut être précisée, mais dont le noyau de sens ne saurait être remis en question – c’est donc ce qui fait son efficacité sur le plan psychique. Bettelheim met en garde par exemple contre une interprétation étroitement rationaliste de la religion, de Dieu, des « déesses mères » ou des anges gardiens, pour ne pas « déprécier cette imagerie tutélaire en la réduisant à des projections puériles issues d’un esprit immature », pour ne pas dérober à l’enfant ce qui peut constituer « la sécurité » et le « réconfort dont il a tant besoin » : ces images ne sont pas « fausses » mais des « projection “puériles” » qui seront mieux interprétées par la suite, remplacées par « des explications plus rationnelles ».565 Ricœur ne dit pas autre chose, finalement, lorsqu’il plaide pour le symbole dans De l’interprétation, pour qu’on n’en fasse pas seulement une lecture régressive mais également « progressive », pour qu’on le perçoive comme porteur de progrès, comme désignant une direction, comme « aurore de sens ». Pour cela, pour renouer avec une « parole vive », il importe en effet de réveiller la métaphore qui y sommeille. Ce moment-là ressemble beaucoup au deuxième moment indiqué par Ricœur, au « stade antithétique » de la réflexion. Il convient alors de souligner que le symbole, comme la métaphore, n’est jamais qu’une première approximation, parfois géniale, certes, mais une approximation (autrement dit, que le troisième moment de Ricœur, l’étape dialectique, ne saurait être posée tout le temps dans les mêmes termes : si le conflit des interprétations, si « le heurt des opposés » peut être dépassé, dans le symbole ou dans la psychanalyse, par exemple, « le passage de l’un dans l’autre » ne dissout pas toujours l’opposition). De ce point de vue, si « le lien symbolique s’édifie dans le langage », comme le lien métaphorique, s’il y a un « travail de culture » dans le symbole, celui-ci n’illustre peut-être pas aussi bien celui-là que la métaphore, à cause de la liaison « verticale » du symbole qui ne favorise pas autant le ressaisissement par la conscience, en toute clarté, des termes de l’association – même dans le niveau supérieur de créativité du symbolisme, non plus celui des « symboles sédimentés » ou usuels, mais celui des « symboles prospectifs »
La métaphore et les formalistes russes
Il importe maintenant, pour comprendre le destin de la théorie de la métaphore, notamment chez les néo-rhétoriciens, de se pencher sur l’aventure « formaliste ». Les liens par Jakobson avec le milieu structuraliste sont connus. En revanche, il peut être utile de souligner la façon dont les travaux dits formalistes s’articulent avec le marxisme, ainsi que la façon dont le rapport entre forme et « contenu » y est posé, sans négliger, bien sûr, la place de la métaphore dans ces théories. Dans sa préface à Résurrection du mot, Andreï Nakov souligne par exemple à quel point l’importation du formalisme en Occident, à travers Jakobson et Todorov, s’est faite sur fond d’oublis pour l’un et de méconnaissance pour l’autre – combien il convenait de gommer les liens avec le futurisme notamment, et plus largement avec la nouvelle « philosophie de l’existence » du modernisme russe, avec la promesse d’un « monde nouveau », pour pouvoir conserver au formalisme « son charisme » et « ses qualités “avant-gardistes” et idéologiques ».570 C’est contre une semblable intemporalité que je proposerai une partie des remarques qui suivent.
Chklovski : la pensée et l’image, le prosaïque et le poétique
La charge contre une « pensée par images » qui ouvre « L’art comme procédé » est restée célèbre. Victor Chklovski y présente cette définition de l’art comme une opinion d’écolier. S’il l’observe aussi chez un « savant philologue », Potebnia (« il n’existe pas d’art et en particulier pas de poésie sans image », la poésie et la prose ne seraient qu’« une certaine manière de penser et de connaître »), il dénonce sa reprise servile par son « disciple », l’académicien OvsianikoKoulikovski. Pourtant, à y regarder de plus près, on voit bien que la charge est plus précise. Ce qui déplaît à Chklovski, c’est plutôt l’idée de l’image comme « prédicat constant pour des sujets variables », l’existence de ce « moyen constant d’attraction pour des aperceptions changeantes » (je souligne), ainsi que la recommandation d’user d’une image « beaucoup plus simple et beaucoup plus claire que ce qu’elle explique ». Par ailleurs, l’auteur de Résurrection du mot conteste l’idée selon laquelle « sans images, il n’y a pas d’art » et tourne en dérision Ovsianiko-Koulikovski qui, « après un quart de siècles d’efforts », s’est résolu à distinguer un « art sans images » à côté d’un « art par images » : s’il n’y a pas véritablement rupture entre les deux, selon Chklovski, s’il y a un continuum entre la poésie lyrique de l’opéra et celle de la littérature, par exemple, c’est parce que l’essentiel est ailleurs. Et de préciser enfin sa cible principale : la définition « l’art est avant tout créateur de symboles », d’images, cette définition qui « a résisté et a survécu à l’effondrement de la théorie sur laquelle elle était fondée » et qui survit « plus qu’ailleurs dans le courant symboliste », « surtout chez ses théoriciens » d’ailleurs.571 On le voit, les cibles de Chklovski sont multiples, et mouvantes, dans ce texte de 1917 : sous l’attaque justifiée contre la définition réductrice « l’art, c’est la pensée par images », il s’en prend à toute une série d’affirmations différentes, dont les identifications « l’art = l’image » et « l’art = un moyen de penser » sont les principales. Seulement, si elles paraissent réductrices, elles aussi, elles ne sont pas forcément fausses – je pense notamment à la dernière. Sous le couvert de ces attaques légitimes, on perçoit par moments l’envie d’en découdre avec l’idée même que l’image serait un moment privilégié de l’art pour exprimer des idées. Enfin, dans cet article, Chklovki traite également de la définition de la métaphore, et il vise en particulier la théorie littéraire issue du symbolisme. Pour étayer sa charge, il reprend même, en apparence, la définition de Potebnia de l’image comme prédicat fixe : comme « les images sont presque immobiles », comme « de siècle en siècle, de pays en pays, de poète en poète, elles se transmettent sans être changées », il y voit la preuve que la poésie n’est pas une « pensée par images », puisque l’histoire de la poésie ne consiste pas « en une histoire du changement de l’image » mais bien plutôt en l’« accumulation » et la « révélation de nouveaux procédés pour disposer et élaborer le matériel verbal » et, en l’occurrence, « beaucoup plus en la disposition des images qu’en leur création. » Si la dernière affirmation me semble assez juste, il faut relever néanmoins qu’elle repose sur une identification de l’image au comparant ou, à la rigueur, au seul couple comparant-comparé, et qu’elle ne prouve pas ce qu’elle prétend démontrer. Pourquoi un nouveau tissage d’image, qui met en jeu beaucoup plus qu’un ou deux mot(s), un ou deux signes(s), ne serait pas une création, par exemple ? N’est-ce pas justement par cette attention fine au détail d’un rapprochement que du nouveau surgit au cœur même de l’usuel ? Si l’image du vaisseau de l’État est ancienne, comme l’image du peuple ou d’une foule comme d’une mer agitée, désordonnée, elle n’est pas utilisée de la même façon par Cicéron et par Gance, par exemple : c’est bien en filant celle-ci que le réalisateur de Napoléon découvre et invente, dans son film, l’image du drapeau-voile. Sans parler de S. M. Eisenstein qui présente, au début du Cuirassé Potemkine, quelques plans sur une mer déchaînée s’abattant sur une digue avec violence, comme pour la renverser, avant de proposer un intertitre qui commence par ces mots de Lénine : « La révolution est une guerre. C’est la seule guerre juste, légitime, nécessaire. » Peut-on ne pas lire ici une métaphore et même, plus précisément, à côté de « la révolution est une guerre », l’énoncé : « la révolution est une tempête, la seule violence qui soit légitime » ? L’image de la tempête est en effet idéale dans ce contexte : c’est une façon de justifier la colère des hommes, de la présenter comme naturelle, de la rendre aussi nécessaire qu’une grande marée qui souhaiterait renverser une digue. Autrement dit, la métaphore traditionnelle est ici renversée, subvertie, le cinéaste supprime l’image du capitaine de navire et propose de considérer plutôt le conflit des éléments, les uns statiques, les autres dynamiques, et notamment le rôle de la digue. Peut-on dire, là encore, qu’il s’agit de la même métaphore – et qu’il n’y a pas une pensée qui s’exprime là ?