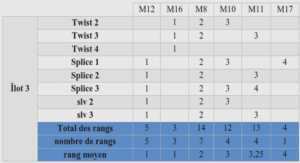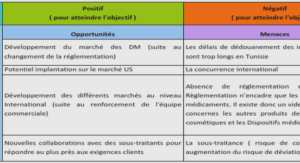Métaphore, symbolisme et allégorie : liaisons dangereuses au moment du « triomphe »
Le jugement de Proust sur Flaubert suggère assez, à mes yeux, la part de méprise qu’il existe au fond de son éloge de la « belle métaphore », seule capable d’apporter « une sorte d’éternité au style ». Faut-il pour autant rejeter l’idée d’un apport spécifique de la métaphore, l’idée qu’elle constituerait un lieu particulier où se cristalliserait la beauté d’une œuvre – de certaines œuvres, en tout cas ? Je ne crois évidemment pas, et le simple fait qu’il existe aussi chez Flaubert de « belles métaphores » me semble conforter cette hypothèse. D’ailleurs, la supériorité de la métaphore vient finalement chez Proust de la « vision » dont elle témoigne, qu’il mentionne souvent pour le style mais presque jamais explicitement pour la métaphore, plutôt pour la grammaire de Flaubert par exemple, probablement par goût du paradoxe et selon un procédé que Genette a étudié, que l’on voit à l’œuvre chez le Narrateur de La Recherche comme dans les tableaux d’Elstir (la terre est décrite comme la mer, la ville comme le port, et vice-versa). On comprend bien néanmoins, dans « Remarques sur le style » par exemple, que ces images qui « naissent […] d’une impression », ces « rapports nouveaux » qui « unissent » les choses, proviennent du fameux talent d’« apercevoir les ressemblances ». L’erreur, c’est de croire qu’il n’y a rien de tel chez Flaubert, sous prétexte que l’idée du narrateur n’est pas exhibée, qu’il travaille de préférence sur l’imaginaire, assez commun en effet, de ses personnages. Le malheur tiendrait donc plutôt à une certaine idéalisation de la métaphore, pierre précieuse quasi philosophale, difficilement compatible avec l’esthétique discrète, modeste, de la métaphore flaubertienne. En fait, il semble se jouer quelque chose, autour de la seconde moitié du XIXe siècle, qui se poursuit au début du XXe et qui excède la simple reconnaissance du mérite propre à la métaphore. On a déjà relevé la phrase d’Alfred de Vigny tirée de son Journal d’un poète : « Les hommes du plus grand génie ne sont guère que ceux qui ont eu dans l’expression les plus justes comparaisons ». Baudelaire écrit quant à lui, dans son Salon de 1845, à propos d’un tableau inégal de Victor Robert, que « L’allégorie est un des plus beaux genres de l’art ».466 On pourrait citer aussi un jugement de Potebnia similaire à celui de Proust, relevé et contesté par Victor Chklovski : « Il n’existe pas d’art et en particulier pas de poésie sans image » ; l’art témoigne ainsi d’« une certaine manière de penser et de connaître ».467 Or, s’il y a dans cette assimilation de la poésie à l’image quelque chose d’abusif, il n’est pas aisé de la condamner rapidement, tant ce lien n’est pas le pur produit d’une illusion, tant il trouve des causes multiples et variées et, pour certaines, profondément liées à leur époque : il nous faut notamment faire la part entre un certain idéalisme et la réaction aux progrès fulgurants du scientisme, ou plus largement de la modernité capitaliste, dont on sait à quel point Baudelaire l’avait en horreur. C’est cette complexité-là qu’il faut avoir à l’esprit quand on envisage le prétendu « culte » de la métaphore de l’époque, tel qu’on peut le percevoir aujourd’hui, sinon dans la théorie, du moins dans les faits. Dans cette réputation flatteuse que possède encore la métaphore aujourd’hui, dans cette image idéalisée qu’elle présente au début du XXe siècle, le rôle du Parnasse apparaît finalement important, dans la mesure où il prépare la voie au symbolisme avec, d’une part, son idéal de perfection formelle, mais aussi, d’autre part, son souci d’impersonnalité, qui pousse les poètes à confier à l’image tout ce qu’ils ne peuvent pas dire. C’est ce pouvoir accordé à l’image que développeront les symbolistes. Pour bien comprendre la fortune de la métaphore à l’époque, on peut se souvenir de ces nombreux poèmes où elle constitue le cœur de l’œuvre : aussi bien chez Gautier, avec « Le Pin des Landes » par exemple, que chez Baudelaire avec « L’Albatros », chez Rimbaud avec « Le Bateau ivre », ou chez Mallarmé avec « Cantique de Saint Jean ». Les deux premiers possèdent d’ailleurs la même structure : trois strophes entières consacrées à un arbre ou à un animal, un comparant qu’on ne présente pas comme tel, qui est même comparé à des humains (le pin des landes est assassiné par l’homme, c’est « un soldat blessé », et l’albatros un « roi de l’azur », un « voyageur ailé »), suivies d’un quatrième quatrain où la comparaison s’énonce enfin, où le thème « véritable » apparaît et renvoie ce qui précède au statut de comparant (« Le poète est ainsi dans les Landes du monde », « Le poète est semblable au prince des nuées »). Nous ne sommes vraiment pas loin de l’allégorie, ou de la fable qui réinterprète, in fine, tout ce qui vient d’être exposé. Il en va d’ailleurs de même dans « Le Bateau ivre » et le « Cantique de Saint Jean », si ce n’est qu’ils présentent un nouveau degré de complexité, en n’exposant plus clairement la place respective des comparés et des comparants. Or, si le recours n’est pas nouveau à une métaphore pour bâtir le poème entier, il y a quelque chose de spécifique à l’époque dans la façon de mettre en œuvre ce pouvoir accordé à l’image : associée à une relative impersonnalité, dans une forme plus ramassée, l’idée acquiert un charme nouveau, lié à un certain mystère, une forme de pénombre, de semi-obscurité. Il suffit de comparer « Le Pin des Landes » ou « L’Albatros » à l’allégorie du pélican de Musset, qui évoque elle aussi la souffrance du poète, pour l’apercevoir : c’est comme si Gautier et Baudelaire avaient supprimé les vers qui précèdent chez Musset, dans sa « Nuit de mai », qui exposent calmement le thème avant de proposer la comparaison et où l’énonciation est clairement personnelle (la Muse s’adresse au poète). Dans « L’Albatros », au contraire, non seulement Baudelaire ne s’implique qu’indirectement, qu’à travers la généralité du mot « Poète », comme chez Gautier, mais l’idée est encore constamment implicite : même dans la quatrième strophe, la métaphore continue d’être filée ; c’est toujours à elle qu’il confie le soin d’exprimer les sentiments de grandeur, de solitude et d’inadaptation de l’artiste. L’évolution est encore plus frappante si l’on considère « Le Bateau ivre » : Arthur Rimbaud refuse d’écrire « Je suis tel qu’un ponton sans vergues et sans mâts… », comme Léon Dierx l’avait fait dans « Le Vieux Solitaire », il refuse de corriger son poème en ajoutant « Je suis un bateau ivre », comme Banville le lui avait suggéré. D’une certaine façon, ce n’est plus l’exposition du comparé qui est différée, c’est plutôt celle du comparant : il faut attendre la cinquième strophe pour que le lecteur comprenne avec certitude que le locuteur n’est pas le passager ou le capitaine d’un bateau ivre, ou plutôt que le poète n’est pas seulement un jeune homme mais aussi un navire. L’ambiguïté concernant l’identité du locuteur est radicale : c’est à la fois un bateau qui parle, un navire personnifié, et un homme comparé à un bateau. Même si, en dernière analyse, il s’agit bien d’un poète qui s’identifie à un bateau, l’originalité du poème est de gommer l’élaboration progressive de l’image, telle qu’on pouvait la rencontrer chez ses prédécesseurs (un bateau, personnifié à l’occasion, qui fournit ensuite une comparaison – sur le modèle, déjà, de La Fontaine, ou même de Phèdre). La voie est alors ouverte à Mallarmé, à une poésie plus hermétique encore. Seulement, c’est là qu’il ne faut pas se tromper : l’hermétisme d’un Rimbaud ou d’un Mallarmé est tout relatif. C’est la beauté d’une semi-clarté qu’ils recherchent, d’une demi-obscurité qui n’empêche pas totalement l’accès à la signification, qui ne l’interdit pas, qui ne nécessite pas une initiation secrète. Rimbaud ne cherche pas à faire croire qu’il est réellement un bateau : son poème 434 reste une allégorie, bien qu’il apparaisse sérieusement mâtiné d’énigme. Si le groupe µ ironise sur Baudelaire, si Genette évoque le symbolisme, c’est évidemment à cause de poèmes comme « Correspondances », « Le Bateau ivre » ou « Voyelles ». Il serait pourtant d’une singulière mauvaise foi de les prendre à la lettre : ni Baudelaire ni Rimbaud ne cherchent à créer un nouveau culte. En revanche, on peut discerner une mission très haute confiée au poète, telle qu’elle a pu être énoncée par les fameuses lettres du Voyant. Mais, là encore, il ne faut pas piéger Rimbaud en prenant ses métaphores au mot : si son projet de « dérèglement de tous les sens » vise bien à faire de lui une sorte de pythie qui, dans un état de transe, pouvait entrevoir une vérité, le dérèglement en question reste « raisonné », il s’agit surtout d’expérimenter tous les possibles, de se rendre disponible à l’inconnu, au nouveau, à sortir de soi, mais pour mieux se connaître (à la différences des romantiques, qui n’ont « trouvé du moi que la signification fausse ») et pouvoir ainsi aller vers les autres (comme Prométhée, « voleur de feu »). Il ne s’agit plus vraiment d’être un phare, comme Hugo, qui surplombe de son génie, mais d’inventer une langue, d’être « un multiplicateur de progrès ». On peut alors, si l’on veut, déceler quelque idéalisme dans ce rêve de « trouver une langue » : quand il annonce qu’elle « sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant de la pensée et tirant », on peut d’ailleurs penser à Hegel qui assignait à la poésie romantique (c’est-à-dire, rappelons-le, chrétienne) la possibilité de regarder « l’âme dans l’âme », de parler d’« âme humaine […] à âme humaine ».468 Seulement, Rimbaud prend bien soin de souligner que « cet avenir sera matérialiste », « toujours plein du Nombre et de l’Harmonie » et, comme s’il répondait à Hegel, d’ajouter : « au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque ». Alors, bien sûr, Rimbaud comme d’autres poètes du XIXe et d’autres auteurs du début du XXe siècle jouent avec l’idée d’ésotérisme, d’alchimie : ils se font volontiers « abstracteurs de quintessences ». Même quand Rimbaud revient sur « l’histoire d’une de [s]es folies », précisément, dans Une Saison en enfer, dans « Alchimie du verbe », que dénonce-t-il, très concrètement ? C’est d’abord son sonnet des Voyelles, ce rêve d’« un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens », et plus largement une certaine obscurité avec laquelle il n’a pas encore totalement rompu (il « réserve » encore beaucoup « la traduction », dans cette prose poétique autobiographique). S’il « croyait à tous les enchantements », il évoque alors des rêves d’aventures, ou historiques, qui ne concernent que lointainement la littérature et qui ressemblent à ceux qu’il tentera de réaliser plus tard (notamment ces « voyages de découvertes dont on n’a pas de relation »). La seule critique, mais de taille, qui nous concerne vraiment, est celle de « la vieillerie poétique » qui « avait une bonne part dans [s]on alchimie du verbe » : il écrit qu’il s’habitua « à l’hallucination simple : je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine » et qu’il expliqua ensuite ses « sophismes magiques avec l’hallucination des mots ! » Même s’il n’évoque pas explicitement la métaphore, même si, parmi les visions, toutes ne paraissent pas « métaphoriques », on ne peut évidemment pas s’empêcher d’y penser ici. L’idée d’une alchimie, d’une hallucination des mots peut légitimement y faire songer. Mais faut-il y croire davantage qu’auparavant ?
Le soupçon sur l’allégorie
L’allégorie est souvent perçue comme un genre pataud en effet, forcément lourd, maladroit, dont l’esthétique serait nécessairement douteuse. Goethe la distingue ainsi de la poésie véritable : « un poète qui cherche le particulier pour illustrer le général est très différent d’un poète qui conçoit le général dans le particulier. De la première manière résulte l’allégorie, elle ne donne le particulier que comme illustration du général ; mais c’est la deuxième manière qui constitue véritablement la nature de la poésie : elle exprime le particulier sans penser au général, sans y faire allusion. Celui qui saisit de manière vivante ce particulier, saisit en même temps le général ». Armand Strubel, qui discerne ici une opposition entre allégorie et symbole, présente cette opposition comme une tendance lourde à la fin du XVIIIe et au XIXe siècles. Inutile de préciser que, quand elle est rapprochée du symbole, elle ne gagne pas en légèreté ce qu’elle perd du côté de la « simple illustration ». Plus largement, il me semble significatif que même Strubel, pourtant spécialiste de l’allégorie (du moins celles du Moyen Âge), commence son ouvrage par un jugement globalement négatif, lui qui pourtant défend l’allégorie contre ses conceptions réductrices, contre celle de Goethe par exemple, comme s’il était tenté de porter malgré tout un jugement esthétique sur le genre en luimême. 475 Il en va d’ailleurs de même dans La Rose, Renart et le Graal, comme s’il fallait s’excuser de travailler sur l’allégorie.476 On retrouve une défiance voisine chez Umberto Eco, lorsqu’il définit l’allégorie comme une sorte de métaphore dont le sens premier serait maintenu, inspirée en cela du mode symbolique, une sorte de métaphore « systématique » et réalisée « sur une large portion textuelle » et qui, en outre, « met en jeu des images déjà vues ailleurs ».477 Ainsi définie, on le voit, l’allégorie est lourde dans son principe même – sinon par l’idée de système, du moins par l’étendue de la figure et par cette idée, soulignée par lui-même, de signes déjà vus ailleurs. Il est évidemment possible de la définir de façon moins lourde, mais il reste toujours quelque chose de peu plaisant chez elle pour les adeptes d’une esthétique de la « transparence », de la discrétion : elle présente toujours le sens premier, même quand il possède une certaine autonomie, ce qui est le cas des meilleures allégories, comme dépendant du sens figuré. Autrement dit, l’autonomie est toujours relative, la richesse figurée apparaît comme nécessairement écrasée sous le sens. Nous partageons volontiers l’idée, aujourd’hui, d’un « gaspillage représentatif », pour reprendre l’expression d’Eco. Elle nous semble toujours un peu artificielle, si ce n’est précieuse, ostentatoire, à cause de cet effet d’énonciation indirecte placé au premier plan. Il n’est pas dans mon propos d’étudier en détail une tel jugement. Néanmoins, comme cette figure ou ce genre joue un rôle important dans le soupçon que l’on porte sur la métaphore, il convient de proposer quelques remarques. Pour l’essentiel, je voudrais suggérer que ce jugement négatif sur l’allégorie est probablement lié, pour une large part, non pas à la réalité même de l’allégorie – dont je serais tenté de dire qu’à proprement parler elle n’existe pas : comme pour toute figure, il y a d’abord des œuvres et, plus que pour les autres, elle prend des formes très variées, sans parler des esthétiques différentes – mais plutôt au découpage conceptuel dont le mot résulte. Ce découpage est en effet largement arbitraire : son histoire en atteste, l’allégorie naviguant entre simple métaphore filée et personnification, idée de « double sens » et acception moderne, voisine du symbole, avec toutes les ambiguïtés et simplifications y afférant. La délimitation de la notion fait d’ailleurs encore l’objet d’âpres querelles : il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux mises au point sanglantes, mais solidement instruites, d’Armand Strubel. Néanmoins, puisqu’il faut s’entendre sur des termes, et que les mots ont été employés pendant des siècles d’une façon approximativement stable tout de même, nous pouvons accepter la définition de Strubel, qui la ramène du côté de la métaphore continuée, qui se garde d’employer la notion de symbole et se méfie de l’idée de personnification, même s’il retient finalement cette dernière. Il parle d’ailleurs, à propos de cette « combinaison de la métaphore et de la personnification », de « principe directeur de l’écriture allégorique », en précisant qu’il existe « une importance variable des deux figures selon les textes (les plus rudimentaires se contentent généralement de la personnification) », et il ajoute cet « autre trait fondamental » : « la coexistence de pratiques liées à la description/énumération (“allégorie statique”) et de pratiques narratives (“allégorie dynamique” – les limites de ces formulations sont très approximatives). » On pourrait souligner d’ailleurs, concernant le second point, que l’allégorie possède le plus souvent une dimension descriptive ou narrative plus marquée. Autrement dit, même pour ce qui est du noyau de signification de l’allégorie, pour ce qui concerne aussi bien son « principe directeur » que son « autre trait fondamental », les choses sont très mouvantes. C’est assez dire que l’unité de l’allégorie est largement illusoire : le mot désigne un ensemble de formes plus qu’un genre ou une figure bien déterminée. Strubel prend d’ailleurs soin de préciser que sa description « vaut essentiellement pour le corpus médiéval ».478 Si nous pouvons donc accepter cette définition de l’allégorie en guise d’approximation, y compris pour les autres formes historiques d’allégories, il nous faut noter, en même temps, que le jugement négatif résulte essentiellement, d’une part, de ces différents découpages arbitraires et, d’autre part, de la faiblesse effective de certaines œuvres, qui collent parfois de très près à la caricature de l’allégorie (une idée préconçue, illustrée ensuite), en précisant que cette seconde part est, dans une certaine mesure, imputable à la première, comme effet induit, la perception du genre structurant sa pratique. Une fois cela concédé, il faut souligner l’immense variété du genre, qui ne se réduit pas à la carte du Tendre, au plafond de la galerie des glaces ou aux films d’Angelopoulos. De Platon à Marat (je pense à l’allégorie de l’opinion, dans Les Chaînes de l’esclavage), du roman de la Rose au détail analysé plus haut dans « Boule de Suif », d’Intolérance à Stalker ou du Septième Sceau à la première séquence des Harmonies Werckmeister, l’allégorie présente des formes variées, dont certaines ne sont pas lourdes. L’idée n’est pas toujours formée a priori par exemple ou, plus exactement, elle se précise parfois en même temps que son image, qui apporte de nouvelles intuitions à l’auteur, dans un mouvement de double précision et de double correction, de l’idée et de l’image, de nature à produire alors une belle allégorie. Enfin, on voit bien le caractère « théorique » du jugement porté sur l’allégorie par l’exemple de Guy de Maupassant ou des Harmonies : on peut être tenté de ne pas les inclure dans la notion, en jouant sur les critères de définition légués par la tradition. La première est très ponctuelle, par exemple, et la seconde ne s’affiche pas comme allégorie, n’impose pas la perception d’un sens second, même si elle y invite fortement. C’est peutêtre ce qui fait que l’on pense à La Liberté guidant le peuple, quand on évoque l’allégorie, et non au Radeau de la Méduse : dans le second cas, seule la scène s’impose à nous, du moins aujourd’hui. C’est seulement dans un second temps, par exemple quand on voit qu’il s’agit d’une micro-société,que l’on perçoit une intention allégorique – ce fonctionnement en deux temps ne constituant pas une garantie contre la lourdeur, évidemment, on le perçoit ici. Enfin, il me semble que c’est parfois rétrospectivement que lesdites allégories nous apparaissent lourdes, quand nous nous en souvenons comme allégories précisément, comme si la richesse de la figure s’émoussait sous le poids de l’idée que nous avons fini par nous représenter, qui a pris son autonomie et qui ainsi, notons-le, a échappé à l’œuvre : c’est le cas de l’immense majorité des exemples précédents où le simple fait de les mentionner comme allégories les leste déjà d’un poids pénible, alors que l’effet produit, ressenti au moment de la lecture ou de la projection, est souvent plus beau, même dans le cas d’Intolérance. Autrement dit, à cause de la complexité de la figure, difficile à saisir d’un seul mouvement, il semble que la mémoire et l’entendement agissent de conserve pour défaire le travail de l’allégorie. Ce rôle de la pensée, ce travail de l’esprit semble donc déterminant. Celui-ci joue d’ailleurs un dernier tour à la figure : c’est parfois, peut-être même souvent, l’épaisseur de l’idée elle-même et non du procédé qui est en cause, quand nous jugeons négativement l’allégorie, comme chez Angelopoulos, Griffith, voire dans Le Radeau de la Méduse. Plus qu’ailleurs peut-être, il s’y mêle jugement esthétique et jugement philosophique, politique, moral ou religieux. Elle pâtit donc doublement ou triplement du risque des jugements de valeur : à travers le genre, c’est souvent l’idée qui est dénoncée.