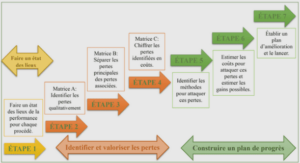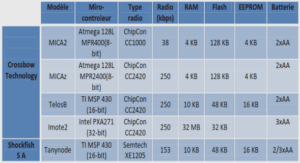Métaphore et rhétorique pour une déconnexion partielle
À l’issue de ce panorama forcément succinct, on peut constater combien la place de la métaphore dans les traités de rhétorique, parfois centrale, d’autres fois beaucoup plus marginale, est problématique. Les contours reconnus des phénomènes métaphoriques sont eux-mêmes extrêmement mouvants : les connexions sont parfois établies entre la métaphore et ses figures voisines, la comparaison, l’allégorie, la catachrèse, l’antonomase, etc., mais pas toujours, loin de là. Certaines nouvelles rhétoriques ont même compliqué les choses en établissant de nouvelles liaisons, par exemple entre métaphore et synecdoque – radicalisant ce qui s’esquissait chez Lamy, Dumarsais ou Fontanier, on l’a vu, pour l’antonomase. On peut se poser alors la question de la liaison entre métaphore et rhétorique. Est-elle nécessaire ? Présenter la métaphore comme une figure de style, qu’on en fasse la reine ou pas, suffit à l’associer à toute une tradition qui est, en partie, discutable. C’est d’ailleurs cette liaison obligée, presque ce cliché, qui semble à l’origine du discrédit qu’on a pu faire porter sur elle : tantôt à cause de l’image dégradée qu’on pouvait avoir de la rhétorique, tantôt au contraire pour tenter de « sauver » cette dernière du déclin, par une saignée en l’occurrence, ou par une refondation d’autant plus difficile qu’elle se présente en même temps comme une restauration. Mais comment imaginer une étude de la métaphore « hors de la rhétorique », non dans le sens d’une exclusion de celle-ci, mais d’une saisie hors de ses problématiques obligées, dans un mouvement partiel de déconnexion ? D’abord, il faut souligner qu’Aristote lui-même a évoqué la métaphore dans deux ouvrages distincts, dans deux contextes très différents, dans Rhétorique donc, mais aussi dans Poétique, ce qui indique assez qu’elle ressortit à des pratiques, à des champs d’analyse différents (sans compter que le champ de pratiques couvert par la rhétorique est lui-même très fluctuant, et parfois très large). Ensuite il faut rappeler, plus largement, comme le font par exemple Paul Ricœur ou Catherine Détrie au début de leurs ouvrages, que la rhétorique est née à une époque très précise, en Sicile, aux alentours de 460 avant J.-C., de la chute d’une tyrannie, et que sa forme la plus prestigieuse, celle inventée par Aristote cent trente ans plus tard, naît d’une sorte de compromis entre les exigences contraires de la philosophie et de la sophistique.87 Aussi, comme tout compromis, peut-on lui trouver des vertus et des vices, selon que l’on considère qu’elle permet d’introduire des arguments rationnels dans la controverse, ou que l’on s’arrête au fait qu’elle compose avec la sophistique, qu’elle s’autorise elle aussi des arguments plus spécieux, qu’elle ne cherche pas seulement à convaincre mais aussi à séduire. Cette tension a traversé toute son histoire : Athénée définissait la rhétorique comme l’art de tromper. Enfin, la rhétorique est associée à tout un ensemble de traditions, notamment scolaires, qu’il n’est pas dans notre intention d’étudier ici. Quoi qu’il en soit, la notion de rhétorique a une histoire lourde : elle n’a pas cette innocence, cette unité perçue intuitivement que la métaphore semble avoir malgré tout conservée. Quand on parle de rhétorique, personne n’entend exactement la même chose : les contenus et les définitions varient énormément. Pour certains, ce sera un art de bien dire ; pour d’autres une pratique de persuasion, détachée de la morale et de la philosophie, à des fins exclusivement pratiques (c’est ainsi que Guy Achard présente la Rhétorique à Herennius dans son introduction par exemple) ; pour d’autres encore, cela semble désigner l’organisation même du discours (avec cette idée que tout est rhétorique, que nous en faisons sans le savoir), etc. Il n’en va pas de même pour la métaphore : tout le monde s’entend sur un certain nombre d’exemples, à défaut de définitions, et non seulement sur ce noyau de cas mais aussi sur le lien entre métaphore et comparaison, par exemple, même quand on pointe la différence entre ces deux figures. C’est pourquoi j’ai pris le parti, très largement, de cette « déconnexion ».88 Si la métaphore a résisté à l’érosion de la rhétorique, c’est probablement parce qu’elle est d’une nature plus solide, plus essentielle : elle entretient des liens étroits avec des modes de pensée, comme peu de figures en entretiennent. On voit la différence qu’il peut exister entre la métonymie, l’anaphore ou l’hyperbole, d’une part, et la métaphore ou l’ironie, d’autre part : sans métaphore, pas de raisonnement analogique ; sans raisonnement analogique, pas de métaphore. De même, l’ironie et l’antiphrase entretiennent des liens étroits avec certaines formes de raisonnement, comme en témoigne le fameux chapitre « De l’esclavage des nègres », dans L’Esprit des lois. 89 Ce n’est pas un simple jeu de massacre auquel se livre Montesquieu dans ce texte : à travers ses énoncés ironiques, à l’antiphrase soigneusement dosée, il propose un véritable raisonnement par l’absurde. En explorant l’hypothèse selon laquelle les Européens auraient eu le droit de réduire les Noirs en esclavage, il est contraint de recourir à toutes sortes d’arguments spécieux et aboutit à des conclusions intenables : ce ne sont pas des hommes ; l’injustice qu’ils subissent n’est pas grande, puisque nos rois ne s’en préoccupent pas. C’est ainsi qu’il démontre, ironiquement, par l’absurde (dans les deux sens du terme), en nous ayant mis sous les yeux la réalité du racisme et de l’esclavage, que les Européens ne respectent pas les lois chrétiennes (« on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens ») et – au passage – que les monarques ne font « entre eux » que des traités inutiles, négligeant d’établir et de faire respecter une sorte de déclaration des droits humains (« ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? »). Cet exemple souligne donc à quel point l’ironie peut constituer le support d’une pensée : les préjugés esclavagistes ne sont pas simplement tournés en dérision par Montesquieu, mais comme démontés de l’intérieur. L’ironie permet cela, en effet : en mimant le discours d’autrui, en lui donnant une forme adaptée, on peut en révéler la logique, en souligner les présupposés et les contradictions. La métaphore possède un grand pouvoir, elle aussi, peut-être plus grand encore : elle permet de penser le réel. La meilleure preuve en est le recours fréquent qu’y ont les philosophes, de Platon à Nietzsche ou Derrida, de l’allégorie de la caverne au complexe d’Œdipe. Les savants l’utilisent aussi. En biologie, par exemple, l’image de l’arbre du vivant remplace à la toute fin du XVIII e siècle celle de l’échelle pour penser les relations entre les êtres vivants existant ou ayant existé. C’est un progrès énorme : on perçoit non seulement les liens entre les êtres, mais aussi leur histoire. La théorie de l’évolution n’est pas loin : la métaphore de l’arbre en a jeté les bases, avec ses branches qui permettent de dépasser le débat traditionnel entre l’idée de continuité et de discontinuité entre les espèces. Darwin reconnaît lui-même sa dette : « On a quelquefois représenté sous la figure d’un grand arbre les affinités de tous les êtres de la même classe, et je crois que cette image est très juste sous bien des rapports. Les rameaux et les bourgeons représentent les espèces existantes ; les branches produites pendant les années précédentes représentent la longue succession des espèces éteintes. […] ». 90 Mais dans cette image il reste encore l’idée d’une hiérarchie. Il existerait un sommet de l’évolution : l’homme. Pour gommer toute téléologie, tout anthropocentrisme, et ne plus confondre diachronie et synchronie (l’arbre semble présenter des espèces vivant actuellement comme appartenant à des moments différents de l’évolution), les savants optent parfois pour une nouvelle métaphore : le buisson du vivant. Tous les animaux actuels sont ainsi au sommet de « l’arbre », qui part dans tous les sens. Le documentaire Espèces d’espèces, qui expose brièvement cette histoire de la taxinomie, est tout entier bâti sur ce progrès métaphorique de la classification des espèces, de la représentation de la grande famille du vivant.91 Nous sommes désormais bien loin de la rhétorique. Ce film qui plaide pour une image sphérique du buisson, représentée en trois dimensions, souligne à quel point le choix de la bonne métaphore est un enjeu non seulement pédagogique mais aussi scientifique.
La métaphore et autres notions voisines
« L’allégorie est une figure très efficace pour la transmission des concepts », nous dit également Marc Bonhomme. « Traduisant la pensée en images, elle possède une grande vertu explicative, comme le montre la Carte du Tendre exposée dans Clélie (1654) de Mlle de Scudéry. Concrétisées par une allégorie géographique, les étapes de l’amour précieux y ressortent avec un relief accru ».92 L’exemple est intéressant, en effet : comme on le voit aussi avec l’allégorie de la caverne, ce genre littéraire entretient des liens étroits avec les concepts. Mais on peut aller plus loin : comme la métaphore de l’arbre du vivant (ou du buisson), l’allégorie ne possède pas une simple vertu explicative, elle sert aussi à formuler l’idée, à rendre sensible par l’intuition ce qui serait difficilement transmissible par les concepts déjà existants. En cela, elle utilise le pouvoir de la métaphore, dont on vient de voir le statut de figure de la pensée, d’outil intellectuel. Il est donc temps de préciser les liens de la métaphore avec les notions voisines de symbole et concept. Beaucoup confondent en effet la métaphore avec le premier et l’opposent au second, alors que le concept – par exemple – ne lui est pas étranger. C’est dire si ces rapports sont beaucoup plus importants que ceux généralement relevés avec la métonymie ou la synecdoque.