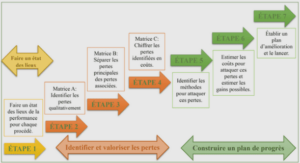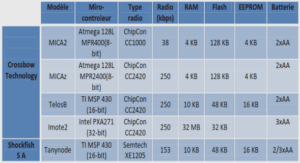Métaphore, allégories et lectures allégoriques
De telles exégèses, en particulier bibliques, ont marqué les esprits, et l’on voit comment le recours à la métaphore a pu en être entaché : pour justifier son interprétation des textes anciens, Tertullien développe donc l’idée de « figure », en donnant à ce concept métaphorique une nouvelle signification mise en évidence par Erich Auerbach. La dimension métaphorique des « figures » elles-mêmes n’a pas besoin d’être démontrée : elle saute suffisamment aux yeux à partir des exemples précédents. Seulement, à la différence du signe envoyé par Zeus, quasi métaphore exigeant d’être comprise comme image de l’avenir, impliquant un aigle et un serpent, ce sont des hommes, des prophètes, qui sont cette fois concernés, ou des événements considérés comme historiques. Même si ces personnes impliquées pouvaient être comprises – pour certaines – comme envoyées par Dieu et apportant un message pour l’avenir, elles ne se donnent pas, dans l’immense majorité des cas au moins, comme constituant par elles-mêmes un message. Chez la plupart des auteurs de l’Église latine, chez Augustin par exemple, et même d’une certaine façon chez Origène, elles possèdent une valeur historique, elles ne sont pas une « simple allégorie », elles possèdent par elles-mêmes une valeur éminente qui empêche de les réduire à de simples signes.305 Un glissement s’est donc opéré, là aussi, sur la base du modèle du prophète qui réalise une ancienne prophétie : le texte ancien n’est plus donné comme le témoignage de prophètes ayant prononcé des prophéties mais comme prophétie lui-même. Des événements relatés dans l’Ancien Testament et des personnes y agissant deviennent comme des paroles de Dieu – des prophéties en acte. Une telle idée possède une longue histoire, malgré ses variantes. L’exégèse de type allégorique est une vieille tradition qui remonte bien plus haut que Philon d’Alexandrie, Origène ou les quatre docteurs latins de l’Église. On la trouve déjà chez les Grecs, dans les écrits les plus récents de la Bible hébraïque, sans parler des quatre évangiles bien sûr, où l’on sait que Jésus lui-même, rencontrant les deux disciples d’Emmaüs, dans L’Évangile selon Saint Luc, « commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, […] leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait ». On peut distinguer néanmoins, comme le propose Auerbach, l’interprétation figurative – l’idée de prophétie en acte – et l’interprétation allégorique – comme méthode plus large, pouvant inclure des pratiques rationalistes, un projet éthique, spirituel ou métaphysique, ne recourant pas nécessairement à l’idée d’une authentique préfiguration. Pour l’auteur de Figura, ce sont d’ailleurs les épîtres pauliniennes qui inaugurent vraiment la ré-interprétation de l’Ancien Testament comme prophétie en acte, plus que les évangiles synoptiques qui se contentent de suggérer une telle interprétation. Ce faisant, la méthode figurative se montre solidaire d’une démarche aujourd’hui bien connue, que l’on retrouve dans la méthode allégorique, visant « à dépouiller l’Ancien Testament » de ses caractères propres, de sa double dimension de Loi et d’histoire d’Israël, « et à montrer qu’il s’agit seulement de l’ombre de ce qui devait venir ». Comme c’est le cas plus tard chez Augustin, l’Ancien Testament devient ainsi, à travers les épîtres de Paul, « du début à la fin [le livre] de la promesse et de la préfiguration du Christ. Rien n’y trouve son sens définitif, tout y est au contraire la prophétie 305 E. Auerbach, Figura, op. cit., p. 38-45 par exemple. 352 Métaphore, allégories et lectures allégoriques de ce qui est maintenant accompli. » 306 Parmi les fonctions de cette interprétation allégorique, l’une des plus importantes est donc d’adapter un texte ancien à son nouveau public, et cela ne concerne pas seulement la Bible. Cela permet déjà, chez les Grecs, de « sauver » Homère par exemple, en le débarrassant de tout ce qui pouvait choquer, comme le souligne Gadamer. 307 L’ambiguïté de la démarche est remarquable : il s’agit souvent d’un effort de rationalisation, devant des croyances désuètes, et donc d’une façon de se libérer de l’emprise des anciennes superstitions, mais il s’agit aussi de conserver le texte, de le préserver des attaques, et donc d’une façon de prolonger son influence, en dégageant un sens caché, plus admissible que le sens apparemment littéral, qui permet ainsi de sauver en apparence sa cohérence. Il en ira de même avec l’Enéide de Virgile. Il est certain néanmoins que, dans cette longue tradition d’exégèse allégorique, une certaine subtilité s’est fait jour : quand on décèle dans les aventures d’Ulysse ou dans l’Enéide des leçons sur la vie de l’âme, ou même quand Philon d’Alexandrie perçoit dans l’Écriture sainte une allégorie du mouvement de l’âme pécheresse en quête de salut, nous ne sommes pas très loin de la démarche de Freud ou de certains philosophes qui utilisent la littérature comme matériau privilégié de réflexion. La seule question qui reste est la suivante : prétend-on que c’est l’œuvre elle-même qui délivre ces significations ? ou, si c’est bien l’œuvre elle-même qui les délivre, prétend-on qu’elles constituent le « vrai » sens, le seul, l’unique, ou du moins le principal ?
La métaphore, l’équivocité et l’analogie de l’être
On ne saurait quitter l’Antiquité et plus encore le Moyen Âge sans évoquer la mouvance des théories de l’analogie de l’être qui ont joué, elles aussi, un rôle important par ricochet dans le soupçon porté sur la métaphore. Ces théories procèdent pourtant, d’une façon générale, d’une volonté de rationaliser les théories de l’analogie. Seulement, c’est au prix paradoxal d’une grande confusion. On sait aujourd’hui que l’analogia entis est en fait une création médiévale, formulée sur la base d’un héritage aristétolicien filtré par les théories d’Avicenne, al-Ghazālī et Averroès, sous l’influence de Porphyre et Boèce, reprises notamment par Albert le Grand et Thomas d’Aquin.317 Dans cette synthèse, de nombreux textes d’Aristote, aux problématiques différentes, sont amalgamés dans le cadre d’une inspiration clairement « platonicienne » ou néo-platonicienne. Dans un développement marqué lui aussi par la lecture de Pierre Aubenque, Ricœur présente par exemple la problématique médiévale de l’analogie comme une réponse de l’ontologie au défi d’unité lancé par la théologie : pour ce qui nous intéresse, on peut noter que l’analogie proportionnelle y est rapprochée du rapport ad unum, d’une autre forme d’analogie, plus verticale, marquée par l’influence d’un terme premier, ce qui permet de « sauver » la relation transcendantale.318 C’est le texte aristotélicien des Catégories qui constitue l’une des bases principales de la doctrine de l’analogie de l’être, même s’il n’est utilisé comme tel qu’au XIII e siècle alors qu’il était connu bien avant. En effet, rapproché depuis l’Antiquité de tout un ensemble de textes aux problématiques différentes, parfois proches mais finalement spécifiques, il se trouve alors associé à une série de notions étrangères, notamment le concept d’analogie. Celui-ci pourtant, du moins dans son acception proportionnelle, n’a que peu à voir chez Aristote avec la question des catégories qui se préoccupe d’établir la différence entre synonymes, homonymes et paronymes. Il en va différemment chez les médiévaux qui, soucieux d’établir la possibilité de parler de Dieu, proposent une nouvelle distinction entre termes équivoques (les homonymes), termes univoques (les synonymes) et « termes analogiques », ou « équivoques par dessein ». C’est cette troisième catégorie qui constitue un infléchissement notable : une nouvelle notion se forge qui s’émancipe de celle de paronyme, qui convenait moins à la nouvelle problématique. Il s’agit alors d’une seconde forme d’équivocité, intermédiaire entre l’univocité des synonymes et l’équivocité des homonymes, cette dernière étant conçue comme équivocité « totale », « équivocité par hasard » souvent. Cette forme intermédiaire nous intéresse au premier chef car il s’agit pour les médiévaux de réfléchir à une « bonne équivocité », à une équivocité réduite en quelque sorte. Hélas, cette réflexion a lieu dans un contexte théologique où l’analogie se trouve désormais mêlée, sous l’influence de la tradition arabe, aux concepts d’être, de substance et d’accident tirés de la Métaphysique et, qui plus est, sans que la notion elle-même soit précisément donnée comme théologique ou onto-théologique puisque la réflexion est en effet d’une portée plus large, qu’elle reste avant tout logique et sémantique. En outre, second handicap, cette forme intermédiaire d’équivocité amalgame désormais sous ce nom d’analogie ce qui, chez Aristote, dans Éthique à Nicomaque, constituait trois formes différentes et déjà problématiques d’homonymes « intentionnels », fondés en raison sans que l’on puisse dire exactement sur quoi : trois formes dont une seulement est donnée comme proportionnelle, les deux autres étant la forme άφø ἑνός (ab uno), quand l’homonymie procèderait d’une origine commune, et πρὸς ἓν (ad unum), quand l’unité du nom proviendrait d’une même tendance, d’une même fin recherchée. L’entrée dans la problématique de l’être donne ainsi à l’analogie une fonction transcendantale, ce qui a entre autres pour conséquence, comme le souligne Ricœur, de rejeter fréquemment « la métaphore parmi les analogies impropres », là où elle était souvent considérée comme une « bonne équivocité » jusqu’alors. Cela ne sera pas tout, cependant : on relève deux traits de la référence ad unum qui marquent l’analogie et, de proche en proche, la théorie de la métaphore qui lui est tout de même adossée : la domination d’un terme premier et le rapport hiérarchique entre les significations – c’est ce que Ricœur appellera plus loin la « métaphore verticale, ascendante, transcendante ».319 Il s’opère donc une redéfinition du concept d’analogie, un affaiblissement du sens lié à son extension, dus à cette troisième modalité d’attribution entre univoque et équivoque, celles des « termes analogiques », et plus précisément « équivoques par dessein » : il ne s’agit plus vraiment, la plupart du temps, d’une analogie à quatre termes. Et même, en théorie comme à travers les exemples donnés, il ne s’agit plus de la métaphore. Le problème posé est celui de savoir si l’on prédique de la même façon ou non quand on dit qu’un remède ou qu’un être vivant est sain ou que l’on prédique quelque chose de Dieu ou de sa créature, pour dire qu’ils sont justes par exemple. La réponse est négative, évidemment, mais il convient alors d’expliquer en quoi. On ne se contente plus de dire que le mot est propre, impropre ou métaphorique : il existe maintenant une pluralité des sens de l’être, plusieurs modes de l’analogie. On reprend alors l’exemple d’Aristote : la santé d’un animal apparaît « en premier lieu » dans l’ordre de la connaissance, alors qu’elle est seconde dans l’ordre des phénomènes ; dans ce cas, l’animal est dit sain par rapport au remède qui produit la santé ou à l’urine qui indique cette santé. C’est l’une des formes du rapport ad unum. Dans la seconde forme, c’est le contraire : la substance est donnée avant l’accident, comme avec le mot « être ». Qu’en est-il, pour Dieu ? Comme la santé, il n’est connu que par ses effets et, s’il n’est pas premier dans l’ordre de la connaissance, il l’est nécessairement dans l’ordre des choses, comme la substance l’est par rapport à l’accident. Dieu apparaît forcément « en premier lieu », puisqu’il est en quelque sorte « la substance de la substance », l’être de la substance : il ne peut pas être considéré comme une idée, le produit d’une induction. Pour sortir du problème, Thomas d’Aquin distingue par exemple, dans le De Veritate, l’analogie de proportion de l’analogie de proportionnalité, la première exprimant un rapport simple entre deux termes, et la seconde un rapport complexe entre quatre termes, un rapport entre deux rapports. Mais, si l’analogie proportionnelle est réintroduite ici, ce qui n’est pas toujours aussi clairement le cas, si elle est choisie pour penser le rapport de la créature à Dieu, c’est une proportionnalité encore particulière, c’est finalement une pure hypothèse, dans le cas de Dieu du moins, parce que le rapport est considéré comme indéterminable : il n’a pas de commune mesure entre les deux proportions, celle de Dieu et celle de l’homme.320 Autrement dit, sous le vocable aristotélicien d’analogie, c’est bien le thème platonicien et néoplatonicien de la participation qui s’impose, chez Thomas d’Aquin comme chez les autres. Alain de Libera conclut à ce propos à une « replatonisation » du corpus aristotélicien dès l’Antiquité, à « une dérive péripapéticienne de l’aristotélisme ».321 L’exemple de « prédication analogique » avec « sain », repris inlassablement au livre IV de la Métaphysique d’Aristote, l’indique bien : le fonctionnement général de l’analogie se caractérise par la dépendance à un terme premier. Aubenque souligne déjà que « ce rapport au principe », au terme « premier », l’auteur d’Éthique à Nicomaque lui « laissait toute son ambiguïté » : « ce qui demeurait obscur pour Aristote (le fondement de la commune dénomination) s’exprime désormais [pour Alexandre d’Aphrodise en l’occurrence] dans le langage platonicien de la communauté et de la participation ».322 On force ainsi le texte de la Métaphysique dans le sens d’une compréhension ad unum des termes équivoques, forme elle-même interprétée dans un sens « participatif », en négligeant la nette préférence d’Aristote exprimée dans L’Ethique pour une autre hypothèse, celle de l’analogie, et ce alors que les deux contextes sont pourtant explicitement tournés contre Platon. C’est dire si l’idée d’une analogie ad unum est éloignée du texte aristotélicien, malgré toutes ses ambiguïtés, notamment les troisième et quatrième modèles de métaphores. La notion d’équivocité « selon l’antérieur et le postérieur » s’amalgame d’ailleurs au XIIIe siècle à celle d’équivocité « par analogie », ne renvoyant plus clairement à la proportionnalité d’Aristote mais bien davantage à la problématique avicenienne de l’être, le mot analogique étant dit alors premièrement et principalement de la substance et seulement secondairement des autres réalités ou accidents.