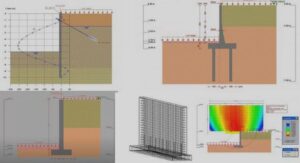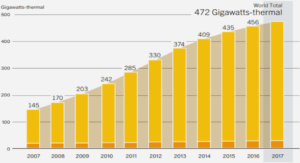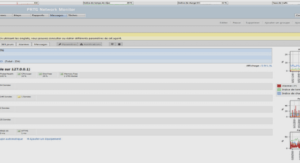Mesures des effets des politiques des publics
La structuration d’un champ de recherche statistique sur les pratiques culturelles est étroitement liée à l’institutionnalisation de la culture comme catégorie d’intervention publique (Dubois, 2012). À partir de 1961, un Service des études et recherches23 parvient à s’implanter sous l’égide d’A. Girard comme outil du ministère de la culture : les recherches qui y seront menées serviront dans un premier temps à mettre au jour et à légitimer la nécessité des politiques de démocratisation culturelle lancées par le jeune ministère.
À mesure que les résultats des enquêtes sur les pratiques culturelles des publics réitèrent l’impression du « toujours pareil », ces enquêtes vont progressivement se retourner contre ces politiques culturelles ministérielles. Comme le montre V. Dubois au travers de la réception de ces enquêtes véhiculée dans les médias, la statistique culturelle menée au ministère ne servirait plus aujourd’hui qu’à alimenter « la mauvaise conscience de ceux qui, au sein du ministère et dans les institutions culturelles publiques, auraient failli dans la mission prosélyte à laquelle ils étaient supposés se consacrer » (Dubois, 2003 : 32).
En dépit de ce discours médiatique, ces enquêtes témoignent au contraire de dynamiques d’évolution des publics qui se font jour et nuancent l’implacabilité du constat d’échec de la démocratisation culturelle. Par suite, les recherches menées sur les mécanismes de transmission culturelle conduisent à se situer au plus près de la culture vécue des individus pour analyser la manière dont des politiques culturelles peuvent conforter ou contrarier les dynamiques sociales qui façonnent les pratiques culturelles et le rapport des publics à celles-ci. Aussi, après avoir rendu compte de ce constat d’échec relatif de la démocratisation culturelle, nous présenterons les recherches récentes menées sur les publics qui peuvent constituer le socle d’un cadre interprétatif élargi pour mesurer les effets des politiques culturelles de démocratisation.
Démocratisation culturelle : un cadre interprétatif des effets des politiques des publics
• Les schémas d’évolution de la structuration sociale des publics La mesure des effets d’une politique de démocratisation culturelle sur les publics des institutions culturelles suppose que soient comparés deux états séparés dans le temps. Par suite, Sylvie Octobre (2001) formule un cadre interprétatif des évolutions possibles de la structure sociale des publics en identifiant cinq schémas : – le renouvellement des publics : dans ce cas, la part des publics des classes sociales les plus et les moins favorisées restent inchangées sur la période. Ce schéma correspond au processus générationnel par lequel les nouveaux arrivants de chaque groupe social viennent remplacer leurs aînés ; 23 Qui deviendra ultérieurement le Département des Études et de la Prospective (DEP) puis le Département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS). Mesures des effets des politiques des publics – l’élitisation : ce schéma correspond au cas où la part des publics des classes les plus favorisées augmente en même temps que diminue celle des publics les moins favorisés (l’élitisation sera alors dite absolue) ou qu’elle se maintient au même niveau sur la période (auquel cas, l’effet sera dit relatif) – la popularisation, soit le schéma inverse : la part des publics populaires augmente tandis que se maintient ou que diminue celle des publics des classes supérieures. Là encore, on parlera respectivement de popularisation relative ou absolue ; – la banalisation : dans ce cas, la part respective des publics des classes supérieures et populaires augmentent dans les mêmes proportions sur la période ; – la désaffection : symétriquement opposé au précédent, ce cas est celui où la part des publics des classes supérieures et populaires diminuent dans les mêmes proportions.
La visite comme « pratique intemporelle »
Compte tenu de ce cadre interprétatif, O. Donnat et F. Lévy livrent en 2011 une analyse longitudinale des cinq éditions d’enquêtes Pratiques culturelles des Français menées sur 35 années et proposent ainsi de suivre les comportements culturels de chaque génération au cours du temps. Cette approche permet ainsi de différencier les effets d’âge, entendus comme l’évolution d’un comportement culturel au cours du cycle de vie, et les effets de génération lorsqu’un comportement culturel caractéristique d’une génération se maintient dans le temps à mesure que les membres de cette génération avancent en âge. De ce point de vue, plusieurs schémas d’évolution des pratiques émergent selon que les effets générationnel et d’âge convergent (en faveur26 ou en défaveur27 d’une pratique culturelle) ou qu’ils divergent entraînant alors le déclin de la pratique en l’absence de renouvellement générationnel de ses pratiquants 28 ou bien son expansion lorsque les jeunes générations s’en emparent davantage que leurs aînés et conservent ce taux de pratique en avançant en âge 29 (Donnat et Lévy, 2007 : 5-6).