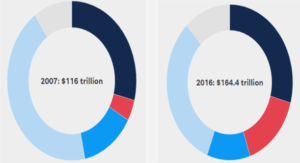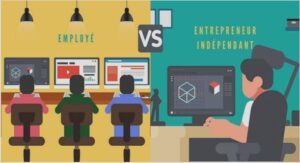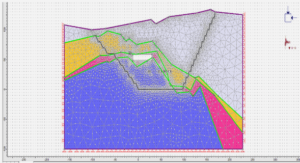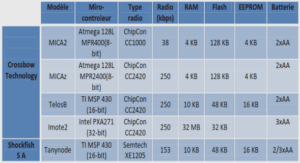MESURER LA MARCHE URBAINE DU QUANTITATIF AU QUALITATIF
A l’instar de ce qui ce passe pour l’étude d’autres réalités sociales, deux écoles de pensée structurent le champ des recherches consacré à la marche en sciences sociales, déterminant à leur tour les outils d’analyse les plus pertinents pour déconstruire le phénomène en des séquences saisissables qui permettent d’en appréhender le sens. La première école pose qu’il faut travailler sur la base de données quantitatives susceptibles d’être traitées statistiquement et de donner lieu à des résultats fondés sur des probabilités. Elle procède tantôt par comptages et suivis de trajectoires (tracking), tantôt par échantillons de sujets, de questionnaires et parfois d’entretiens, d’autant plus courts et directifs que l’échantillon de sujets interrogés est plus important. La seconde école estime qu’il est préférable de travailler en profondeur, de manière dite qualitative, sur la base d’un nombre restreint de sujets. Le plus souvent, le chercheur procède alors par une immersion prolongée sur le terrain, ayant recours à diverses méthodes d’observation, dont l’observation participante, sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce chapitre. Le chercheur prête également une attention soutenue aux sujets en tant qu’acteurs et approfondit souvent ses recherches in situ par des entretiens approfondis et le recours à l’analyse de diverses sources documentaires (des cartes, des dessins, des photos). Les outils audio-visuels sont utilisés par l’une ou l’autre école, avec des intensités variant d’un chercheur à l’autre, bien que ces outils aient tendance à accompagner de manière plus récurrente les méthodes qualitatives. Pour notre part, nous avons eu recours systématiquement à des recueils de données audiovisuelles, sous la forme de photographies et vidéos. Nous y reviendrons plus en détail ci-après au chapitre dédié au corpus. Au gré de nos mandats de recherche successifs, nous avons pu développer une familiarité avec ces deux écoles méthodologiques, et procéder autant par passation de questionnaires standardisés auprès de larges échantillons que d’entretiens semi-directifs auprès d’échantillons plus confidentiels. Les démarches in situ que nous avons pu employer au cours de nos recherches incluent quant à elles les micro-trottoirs auprès des passants et l’observation participante. Cette dernière reste notre méthode préférée pour appréhender la marche « en train de se faire »5 . Elle permet de focaliser l’attention sur les comportements tels qu’ils se donnent à voir dans leur immédiateté, et non sur des comptes-rendus de ces comportements, dont la mise à distance par la parole est inévitable. Ceux-ci apportent certes une compréhension étendue des contextes de l’action, mais ils échouent souvent à retranscrire fidèlement ce qui a cours au sein de l’espace public. Observer les usages et surtout les détournements des espaces publics ne se fait jamais aussi bien que par la confrontation directe au réel.
Les méthodologies d’analyse employées dans ce travail
Pour apréhender les terrains dans le cadre de ce travail de thèse nous avons pris le parti de combiner les approches quantitatives et qualitatives. Ces deux manières d’apréhender le phénomène du renouveau de la marche urbaine nous ont semblé complémentaires, raison pour laquelle nous avons opté pour leur combinaison, plutôt inhabituelle au sein d’un même travail de recherche. Il nous semble réducteur de ne faire appel qu’à l’une ou à l’autre alors qu’elles peuvent s’enrichir mutuellement. Nous suivons ici Aaron Cicourel, pour qui « une bonne étude de cas est multidimensionnelle. Elle ne s’enferme pas dans les faux dilemmes du type sociologie qualitative ou quantitative » (Cicourel in Céfaï, 2003, p. 391). Marc Augé et Jean-Paul Colleyn prolongent cette perspective non-duelle lorsqu’ils soulignent qu’opposer les démarches inductives et déductives, c’est ouvrir une mauvaise querelle : « l’anthropologue fait évidement usage de l’une et de l’autre. Il s’immerge dans une réalité locale, observe, participe, décrit, enregistre, filme, etc., jusqu’à ce que se dégage un modèle (c’est l’approche inductive) ; mais il teste aussi constamment des hypothèses théoriques en les corroborant ou en les infirmant par l’observation des faits. » (Augé et Colleyn, 2010, (1ère éd. 2004), p. 109). Pour Daniel Céfaï, les approches multi-méthodes sont aujourd’hui à nouveau à l’honneur, après une nécessaire période d’émancipation des méthodes qualitatives face à la prédominance quasi exclusive des méthodes quantitatives pendant les décennies précédentes. Le plaidoyer en faveur des approches multiméthodes fait valoir que l’enquête qualitative n’est pas incompatible avec le recours à des méthodes quantitatives (Hammersley, 1986 ; Peneff, 1995, cités par Cefaï, 2003, p. 599). Cefaï fait remarquer que les données des recensements ont été, dès les débuts de la sociologie de la 1ère partie du XXe siècle, une matière première de choix pour les chercheurs de la première Ecole de Chicago6 , qui articulaient ces données aux histoires de vie et aux documents personnels pour composer des « artefacts de probation » (Cefaï, 2003, pp. 599-600). Au niveau méthodologique, ce travail de thèse repose donc sur l’analyse de données quantitatives provenant de sources statistiques officielles (pour l’essentiel de microrecensements transports) et de données qualitatives récoltées au gré de nos observations in situ : Au niveau quantitatif, nous nous sommes basés sur les données statistiques décrivant les pratiques de la marche, telles qu’elles sont repertoriées par les études officielles des collectivités locales de Lausanne, Genève et Bilbao, ainsi que les microrecensements sur la mobilité et les transports effectués par des instances gouvernementales aux échelons supérieurs (Canton de Vaud, Canton de Genève, Office Fédéral des Statistiques de la Confédération suisse, Département des Transports de la Communauté Autonome Basque). Au niveau qualitatif, nous avons effectué un travail d’observation multi-terrains. L’analyse des données porte ainsi sur nos propres comptes-rendus d’observation in situ de la marche « en train de se faire », composés pour l’essentiel de notes et de matériaux photographiques. Ces données d’observation ont été par la suite confrontées aux chiffres quantitatifs, pour en dégager les convergences. En d’autres termes, est-ce que les chiffres qui portraitent les pratiques mesurées sur de larges échantillons de la population corroborent bien les résultats de nos observations sur des échantillons de terrain plus restreints ? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre en confrontant ces deux perspectives.
L’observation comme principale entrée pour appréhender le terrain
Il s’agit de regarder tout ce qu’on veut exprimer assez longtemps et avec assez d’attention pour en découvrir un aspect qui n’ait été vu et dit par personne. Guy de Maupassant Pour Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier (2010, 1ère éd. 1999, p. 7), observer est une pratique sociale avant d’être une méthode scientifique. Jean Peneff voit dans l’observation et l’expérience directe l’instrument des idées et des croyances que nous accumulons. Elles sont « la base de tous les apprentissages, le moteur de l’action et le façonnage de nos idées sur le monde, la source de nos habitudes pour agir et penser » (Peneff, 2009, p. 9). Pour cet auteur, l’observation constitue un moment fondamental du raisonnement géographique (Peneff, 2009, p. 34). Il existe une longue tradition de recherche urbaine basée sur l’observation directe du milieu que l’on souhaite saisir. Cette observation porte sur les pratiques sociales qui s’y déploient, qu’elles soient gestuelles ou verbales, mais aussi sur le cadre et ses règles normatives, les ressources que les acteurs mobilisent dans leurs pratiques et le sens qu’ils leur attribuent (Arborio et Fournier, 2010, 1ère éd. 1999, pp. 47-48). Certains de ces courants de recherche se sont consacrés plus spéciquement à l’observation des interactions entre passants anonymes dans des lieux publics (Goffman, 1963 ; Jacobs, 1961 ; Karp, 1980 ; Lofland, 1989 et 1998 ; Duneier, 2001 ; cités par Cefaï, 2003, p. 494). Les praticiens du travail de terrain publient d’abord dans les années 50 des notes méthodologiques qui constituent un corpus d’articles de référence dispersés dans des revues. Par la suite, avec la montée dans les années 60 du champ des études urbaines au sein des universités américaines, ce corpus a été rassemblé dans des livres destinés à l’enseignement (Junker, 1960 ; Bensman et Stein, 1964 ; Habenstein, 1970 ; McCall et Simmons, 1969 ; Filstead, 1970 ; Strauss et Glaser, 1967 ; Denzin, 1970 ; Becker, 1970 ; Lofland, 1971, cités par Cefaï, 2003, p. 505).