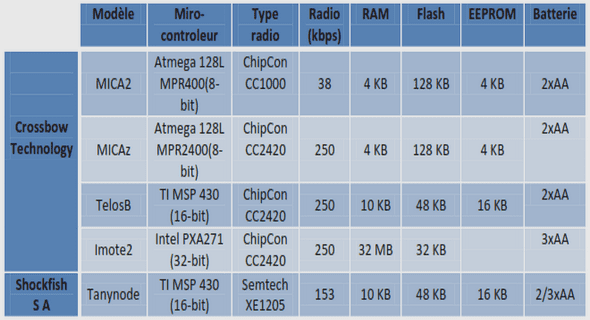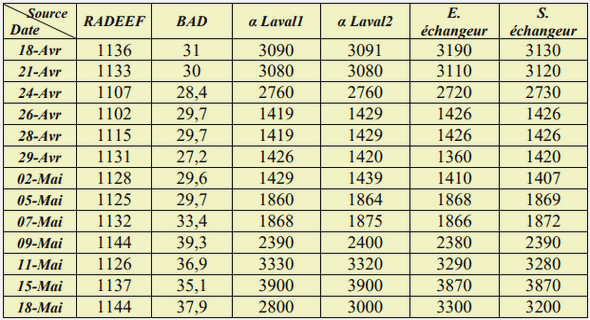Les sexués secondaires
Ce sont des individus, mâles et femelles, qui ne quittent pas la colonie pour former d’autres cités. Elles apparaissent dans les termitières en grand nombre quand les sexués primaires ont disparu.
Chez les termites inférieurs, la disparition du couple royal est généralement suivie de l’apparition de sexués de remplacement néoténiques. Des sexués de remplacements imaginaux ont été décrits par Grassé (1949), ils proviennent des nymphes âgées proches de la mue imaginale au moment de la disparition du couple royal
Chez les termites supérieurs, les sexués de remplacements imaginaux sont plus fréquents. Dans la sous-famille des Macrotermitinae, tous les sexués de remplacement sont de type imaginal. Ces sexués de remplacement sont identiques aux imagos normaux, certains présentent une pigmentation moins complète (Bordereau, 1975)
Les ouvriers
Les ouvriers sont les individus les plus nombreux et les plus petits de la colonie. Ils sont reconnaissables par leur teinte blanchâtre, due à une faible sclérification de l’ensemble du corps, et par un abdomen mou souvent coloré par la cellulose.
Neutres sexuellement, aveugles, jamais ailés, ils sont munis de mandibules broyeuses. Les ouvriers nourrissent toute la colonie et sont les seuls responsables des dégâts.
Leur fonction est de chercher la nourriture à l ’extérieur de l a termitière, circulant en un i ncessant va-et-vient dans des galeries fermées, à l’abri de l’air et de la lumière. Ils digèrent la nourriture, puis l’apportent au nid pour nourrir les individus d’autres castes soit par régurgitation salivaire (trophallaxie), soit par défécation (Velderrain, 1991).
Les soldats
Ils sont en nombre très variables, selon les espèces, la période l’année, la taille et le développement de la termitière. Ils sont facilement reconnaissables par leurs mandibules extrêmement puissantes, issues d’une tête massive, brune et fortement sclérifiée. Sur le front ou « vertex », ils possèdent parfois une glande qui produit un liquide corrosif destiné à combattre leurs ennemis. La caste des soldats, neutre, génétiquement de constitution mâle ou femelle comme chez les ouvriers, assure la sécurité de la termitière. Les soldats gardent à l’abri des attaques de leurs pires ennemis les fourmis, qui sont capables de mettre fin à toute une colonie (Goncalves, 2005).
Ecologie
Rapports des termites avec le climat
Grâce aux « subterfuges » du ni d, les termites parviennent à vivre dans des milieux qui leur sont hostiles, notamment dans le désert où l’eau est rare et la masse alimentaire réduite. Les variations quotidiennes de la température et de l’humidité relative dans le nid, parfois construit dans les lieux très arides, sont très négligeables. Ce qui montre ainsi le rôle d’isolant que joue le nid.
La faune des déserts se compose d’une majorité d’espèces qui ont découvert la niche écologique grâce à laquelle elles échappent aux rigueurs du climat général. Dans les régions à longue et sévère saison sèche (sahel, diverses zones de l’Afrique australe), les termites vont chercher l’eau jusqu’à la nappe phréatique, et de l a sorte, maintiennent leur équilibre hydrique interne et climatisent leur termitière par apport d’eau liquide.
Les termites sont à 99 pourcent des insectes habitant les zones chaudes, voire torrides du gl obe. Quelques genres habitent les pays t empérés : Reticulitermes, diverses Kalotermitidae dont Kalotermes flavicollis que l’on peut considérer comme appartenant a la faune méditerranéenne. Ces insectes, en immense majorité, habitant les pays chauds ont des exigences fonctionnelles et écologiques précises. C’est le cas de Bellicositermes subhyalinus, qui vivent dans les savanes sèches de l’ouest africain. La journée, les ouvriers exploitent du dedans les bois qui jonchent le sol, de préférence plus ou moins enterrés, les excréments d’herbivores et ne s’exposent pas à l’air libre.
Au crépuscule, les colonnes des récoltants sortent du nid et vont fourrager pendant plusieurs heures, découpant les fétus des graminées qu’ils ingèrent et avec lesquels ils élaborent les mylosphères dont ils construisent les meules à champignons.
La double activité des Macrotermitinae (diurne et nocturne) et aussi des Anacanthotermes témoignent d’une bonne adaptation aux conditions climatiques. La cl imatisation du nid par transport d’eau, la recherche, la trouvaille et l’exploitation des nappes souterraines aquifères ne sont pas des pratiques courantes dans le monde animal. Les termites les ont inventées et sont les seuls à les mettre en œuvre avec succès (Grassé, 1986).
Ecologie et distribution spatiale
Le facteur principal délimitant l’aire géographique des termites est le climat général où la température tient le rôle le plus important. Les températures situées entre 18 et 30ºC sont celles qui conviennent le mieux à ces insectes. 18ºC est pour beaucoup, une valeur limite inférieure, même pour les espèces de climat tempéré. Les Reticulitermes n’essaiment que par une température égale ou supérieure à 20ºC (Grassé, 1986).
Le régime des pluies, l’hydrologie souterraine, la nature pétrologique des sols, la qualité et la quantité d’humus, la masse alimentaire contenant de la cellulose … exercent une influence primordiale sur la répartition et la densité des populations termitiques. Chaque espèce de termites a ses préférences ce qui explique, grosso modo, sa localisation et sa densité dans un e space donné.
Nécessité d’un milieu riche en cellulose
Les Isoptères, quelqu’ ils soient, ont le même aliment énergétique, la cellulose qui a toujours une origine végétale. Ils exploitent largement le bois vivant ou mort, les feuilles et herbes sèches ou vertes, l’humus. Ils connaissent rarement la disette. Seuls, les termites désertiques sont exposés à la subir.
En fonction de la source de cellulose dont le termite se nourrit, on distingue les Xylophages stricts qui vivent soit exclusivement dans le bois (Kalotermitidae, Termopsidae), soit dans la terre et le bois (Heterotermitinae, Coptotermitinae). Les Macrotermitinae (Sphaerotermes exclus) mangent le bois, les herbes sèches ou vertes, les feuilles et meules à ch ampignons et constituent une catégorie parfaitement caractérisée. Les Fourrageurs exploitent les herbes, surtout les graminées de la savane et la litière forestière. On en trouve parmi les Hodotermitidae, les Psamotermitinae, les Nasutitermitinae, les Termitinae, les Macrotermitinae. Les Humivores vrais vivent pour la plupart dans la grande forêt et dans les forêts-galeries. Ils mangent de l’humus qui recouvre le sol. Ils sont de grands consommateurs de la cellulose altérée de la matière végétale en cours de décomposition.
Rôle écologique
Les termites font partie de la macrofaune du sol qui a une influence sur l’évolution du sol et la végétation (Arshad, 1982). Leurs actions peuvent faciliter la régénération des sols en augmentant la fertilité. Enbudu et al. , (1992) ont constaté que certains nids de termites ont un gra nd pouvoir fertilisant cité par Sarr (1995). Selon Renoux (1995)), en Afrique intertropicale, les termites représentent la biomasse la plus importante des sols, ont une influence considérable aussi bien écologique qu’économique, par leur régime alimentaire et leur opportunisme, cité par M’bengue (2003). Cette importance dans le processus de décomposition et de recyclage de la matière organique est due à une distribution des espèces dans des biotopes variés qu’elles ont pu coloniser grâce à une diversification de leur régime alimentaire et à leur métabolisme particulier. Chaque groupe trophique a une action particulière sur le sol :
– les Champignonnistes jouent un rôle important sur l’évolution du sol en savane et forêt. En zone humide les Macrotermitinae assurent la remontée en surface de l’argile. En savane, les Odontotermes et Macrotermes ameublissent le sol et l’aèrent par des galeries. Une grande quantité de sol est amenée en surface par les Macrotermitinae. Ces Champignonnistes exercent des effets notables sur la redistribution des éléments minéraux (Boyer, 1971) ;
– les Humivores exercent en forêt une forte action ameublissante des sols et contribuent à détruire la cellulose contenue dans l’humus. En savane, ils jouent le même rôle que les Champignonnistes (ameublissement, aération du sol, etc.) et font apparaître de nouveaux sols riches en matières organiques qui couvrent une partie non né gligeable des grandes dalles latéritiques (Sarr, 1995) ;
– les Lignivores exercent une action peu significative sur le sol. Mais leur consommation de bois vivant sur pied leur permet de réaliser la première étape de la transformation végétale.
– les Fourrageurs ont une action qui se limite à une aération du s ol par leurs galeries de récolte.
Rappel anatomique des termites
Tube digestif
Le tube digestif, bien que sa structure soit d’un type assez général, présente des particularités liées à la xylophagie. Il commence par le cibarium ou étage supérieur de la cavité buccale, limité en haut par le plafond de ladite cavité, en bas par l’hypopharynx. Puis vient l’intestin antérieur issu du stomodeum de l’embryon, invagination ectodermique qui s’insinue entre le tritocérébron (3e segment) et les mandibules (4esegment). Suivent le mésentéron ou intestin moyen d’origine endodermique et l’intestin postérieur qui est le proctodeum ectodermique embryonnaire transformé.
Intestin antérieur
Il dérive tout entier du stomodéum de l’embryon ; ébauche constitué par une invagination de l’ectoderme postoral. Il débute par le pharynx dont le cibarium est considéré comme correspondant à la bouche vraie. L’arrière du pharynx se continue par l’œsophage qui, du poi nt de vue topographique, commence dans la région postérieure de la tête et, situé dans le plan sagittal, traverse le cou puis passe dans le thorax.
Vers l’arrière, l’œsophage agrandit progressivement son diamètre et forme une petite outre, le jabot qui apparaît le plus souvent comme une dilatation latérale du tube digestif. La partie postérieure du jabot s’individualise et devient un organe broyeur d’aliments, le gésier ayant la forme d’un cône renversé. La zone de passage du gésier à l’intestin moyen est désignée sous le nom de valvule oesophagiènne. Cette valvule est une portion du stomodéum, composée exclusivement de cellules d’origine ectodermique, revêtues sur la face limitant la lumière d’une cuticule chitineuse ou intima.