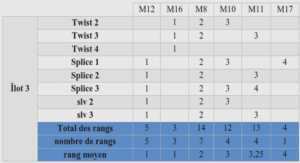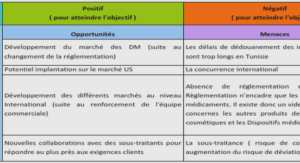“Les impudents”(1943)
Quelque part dans le Quercy, la famille Taneran est déchirée par des tensions qui sont perçues par Maud, jeune fille de vingt ans, aux prises avec sa mère, son frère aîné et son amant. La mère, intelligente mais dépressive, est amoureuse de son fils aîné qui, pervers, joueur et voleur, la ruine, trahit constamment son entourage, tandis qu’elle martyrise son cadet et Maud, qui, dégoûtée, révoltée, faisant de la haine un remède à l’ennui, n’arrive pas à quitter ce cercle familial étouffant. Sa mère la destine à un fils de paysans voisins, mais elle tombe amoureuse d’un intellectuel gentleman-farmer qu’elle guette en secret, la nuit, avant de s’offrir à lui et de goûter la volupté. Bientôt, elle attend un enfant et l’avoue à sa mère qui l’envoie à l’homme qui l’a déshonorée, afin de vivre tranquillement son amour impudique pour son fils.
Commentaire
D’abord intitulé “La famille Taneran”, ce premier roman de Marguerite Duras laissait peu présager ses livres à venir. D’une facture traditionnelle, il présente un « climat » qui se situe du côté de François Mauriac ou de Julien Green, et on a l’impression qu’il a été écrit en les imitant. On y retrouve la propriété du père, les paysages du Lot-et-Garonne, la rivière, le Dropt. Encore englué dans le réalisme, dans la longue description de sensations, il déroule une prose effilochée et lourde, montre un style contourné. Mais il est psychologiquement passionnant car on en retient l’espèce de fascination qu’exerce le héros sur sa sœur. Cette histoire de famille est doublée de l’exposé d’une crise sentimentale dans une âme de jeune fille.
Le roman n’eut que peu de succès, et Marguerite Duras elle-même le jugea «très mauvais». Mais elle avait ainsi exorcisé certaines peurs de la fin de son adolescence. Ayant emménagé dans un appartement au 5 rue Saint-Benoît où elle voisinait avec Sartre, Marguerite Duras vivait dans le bouillonnement créatif de Saint-Germain-des-Prés et était déjà, à l’âge de trente ans, une vedette de l’intelligentsia parisienne. À son retour d’Angleterre, François Mitterand fit entrer dans la Résistance Robert Antelme, Marguerite Duras et Dionys Mascolo. Elle y fit la connaissance, entre autres, du philosophe Edgar Morin. Quand leur groupe tomba dans un guet-apens, elle réussit à se sauver grâce à l’aide de François Mitterand, mais Antelme et sa soeur, Marie-Laure, furent arrêtés puis, le 1 juin 1944, envoyés dans des camps de concentration. Celle-ci y mourut. Marguerite Duras ne cessa pas de chercher où se trouvait son mari, de vouloir savoir s’il était vivant ou mort ; prête à tout pour avoir le moindre petit renseignement sur lui pour cela, elle pratiqua un rôle d’agent double, elle utilisa tous ses atouts, y compris son charme et sa séduction, devint la maîtresse même d’un officier de la Gestapo.
Dans le même temps, elle fit paraître :
“La vie tranquille”(1944)
Vivant dans une ferme avec son frère, le beau Nicolas, et ayant avec lui une relation perverse, Françoise, dite Francou, qui a vingt-six ans, aime se baigner et monter à cru sa jument. Mais, un jour, surgit, comme une apparition, un ami de son frère, un beau garçon appelé Tiène qui lui fait découvrir «le puits de fraîcheur», un amour physique débordant. Cependant, comme elle est dotée d’une méchanceté naturelle, elle provoque directement ou indirectement trois morts.
Commentaire
Ce court et curieux roman paysan est divisé en trois parties correspondant aux trois morts qui le jalonnent. Ce second roman est, lui aussi, assez mauriacien ou greenien, avec son domaine des Bugues (qui ramenait à Platier, aux souvenirs de ce monde rural, aux impressions d’enfance) perdu dans une campagne provinciale, les drames couvant sous la cendre, les violences secrètes et les passions amoureuses qui débouchent finalement sur la mort. Il est quelque peu autobiographique : Francou, c’est Marguerite, et Tiène, c’est Dionys. Francou est bien déjà un personnage de Marguerite Duras. Comme l’héroïne des “Impudents”, elle est soumise à la fascination qu’exerce sur elle son frère. Ses états d’âme sont analysés de façon détaillée. Elle est en proie à l’ennui : «Il reste l’ennui. Rien ne peut plus surprendre que l’ennui. On croit chaque fois en avoir atteint le fond. Mais ce n’est pas vrai. Tout au fond de l’ennui, il y a une source d’un ennui toujours nouveau. On peut vivre d’ennui. Il m’arrive de m’éveiller à l’aurore, d’apercevoir la nuit en fuite désormais impuissante devant les blancheurs trop corrosives du jour qui vient. Avant le cri des oiseaux entre dans la chambre une fraîcheur humide, irradiée par la mer, presque étouffante à force de pureté. Là, on ne peut pas dire. Là, c’est la découverte d’un ennui nouveau. On le découvre venu de plus loin que la veille. Creusé d’un jour. Je m’enfermai dans mon palais de solitude avec l’ennui pour me tenir compagnie.» Ce que Paul Valéry appelait «l’ennui de vivre» et que découvre Francou constituera l’un des thèmes profonds de l’œuvre de Marguerite Duras. Et Francou sait bien, comme le sauront aussi les autres héroïnes de la romancière, que, pour la femme, il n’y a qu’une seule issue à «l’ennui de vivre» : l’amour, cet amour qui la jette vers Tiène, qu’elle aime de tout son être, de tout son corps de femme.
Ce deuxième roman n’eut que peu de succès.Après la fin de la guerre, François Mitterand, qui avait accompagné les Américains à l’ouverture des camps, retrouva Robert Antelme à Dachau et arrangea son retour à Paris. Dionys Mascolo alla le chercher. Marguerite Duras avait déjà l’intention de quitter son époux, mais demeura encore auprès de lui jusqu’à l’année suivante pour le soigner car il était très éprouvé. Il fit le récit de son aventure dans “L’espèce humaine” (1947), livre qui parut dans une indifférence presque générale. Dionys Mascolo, Robert Antelme et Marguerite Duras adhérèrent au Parti communiste français. Se consacrant à des activités de militante, comme la vente de “l’Humanité” et à la vie à trois, pendant plusieurs années, elle ne publia pas. Mais elle fonda, en 1945, avec Robert Antelme, une maison d’édition, “La cité universelle”. Le couple divorça en 1946, et, en 1947, elle eut un fils de Dionys Mascolo, Jean, alias Outa. Cela n’empêcha pas, Marguerite Duras, Robert Antelme et Dionys Mascolo de rester inséparables. Se retrouvaient chez eux des intellectuels intransigeants et chaleureux : Raymond Queneau, Michel Leiris, Maurice Blanchot, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian, Clara Malraux, Jacques Audiberti, Jacques Tati, Edgar Morin, Dominique Desanti, Jacques Lacan, Francis Ponge, Claude Roy, qui lui fit rencontrer Elio Vittorini auquel elle allait emprunter sa technique de la répétition, du retour incantatoire des mots. Devenue journaliste, activité qu’elle n’abandonna jamais complètement, elle y était animée d’un souci de justesse et de justice. Elle consacra alors des textes à l’Indochine.En décembre 1949, sur dénonciation, ils furent exclus du parti communiste ou poussés à s’exclure. En janvier 1950, dans sa lettre de démission, elle, qui avait déjà souffert d’une forme d’exclusion en Indochine, exprima le grand «dégoût» qu’elle éprouvait à l’égard des dirigeants de sa cellule. Marguerite Duras, Robert Antelme et Dionys Mascolo ne cessèrent d’accuser leur camarade de section, Jorge Semprun, qui nia toujours avoir été mêlé à leur exclusion.
L’écoeurement et le désengagement du parti la conduisirent à s’investir davantage dans l’écriture.
Entre 1943 et 1947, elle avait rédigé un journal dans quatre cahiers qu’après sa mort on a retrouvés, serrés dans une large enveloppe de papier kraft, dans « les armoires bleues de Neauphle-le-Château », des placards humides. Certains avaient déjà servis à la rédaction de ‘’La douleur’’ qui n’était qu’un fragment retravaillé. Mais l’ensemble était beaucoup plus vaste. Cela donna, en 2005, la publication par l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine de..
‘’Cahiers de la guerre et autres textes’’
Le premier cahier, soixante-dix pages écrites presque sans rature, d’une coulée et d’une fluidité magiques, est le plus surprenant. On apprend la vérité toute crue sur l’enfance et l’adolescence de Marguerite Donnadieu en Indochine, les douleurs, les humiliations, les violences infligées par une famille qui était laminée par sa honte de la pauvreté sur une concession inexploitable. Âgée de quatorze ans, elle fut littéralement cognée par son grand frère, paresseux, désoeuvré et belle gueule, puis frappée par sa mère. On l’insultait : « fumier », « morpion », « salope », « ordure ». « Je croyais que mon frère allait me tuer », écrit-elle. Au lycée, à Saigon, elle fut prise en grippe. Elle vécut dans un état de culpabilité permanent. Quant à l’« amant » qui, dans le roman de ce titre, est sur le bac entre Sadec et Saï, habillé en tussor de soie grège, porte un diamant et roule dans une Léon Bollée, il n’était pas un Chinois, mais un Annamite « nettement plus laid que l’Annamite moyen ». Lorsque la famille découvrit que ce Léo tournait autour de la jeune fille, elle décida de lui faire cracher de l’argent. Il entretint la famille, « trimbalait » la mère et les deux frères à Saigon « pour faire la bringue». La manière dont Duras raconte le maquereautage de Léo par la famille Donnadieu, la manière dont on la surveille sont époustouflantes de cruauté. Les scènes de danse de tango sous le regard de la famille expliquent l’alternance de désir et d’interdit qui court dans bien des pages. On le laissa la convoiter à l’infini. Ils se frottaient l’un à l’autre, mais il n’était pas question d’aller plus loin. La scène du premier baiser ressembla à un viol : « Tout d’un coup, je sentis un contact humide et frais sur mes lèvres. La répulsion que j’éprouvai est proprement indescriptible. Je bousculai Léo, je crachai, je voulais sauter de l’auto […]. J’avais été embrassée par un foetus, la laideur était rentrée dans ma bouche, j’avais communié avec l’horreur. »
Le deuxième cahier propose un morceau de roman inachevé et tarabiscoté, ‘’Théodora’’, qui fut repris dans ‘’Détruire, dit-elle’’. Les autres pages nous ramènent en avril 1945, alors que, dans une ambiance crépusculaire, alors que Berlin brûle sous le feu russe, Marguerite Duras attendait le retour de son mari en allant chaque jour au centre de tri des déportés d’Orsay, vivait rue Saint-Benoît, entre chien et loup. Elle vit l’apparition spectrale de Robert Antelme réduit à son ombre, puis son miraculeux retour à la santé. Le fait que de Gaulle se soit emparé de la France provoqua sa rage, des jets de haine. Ces passages furent adoucis, voire gommés, dans ‘’La douleur’’. Elle évoque aussi la mort de Hitler, parle de la responsabilité nazie.
Le plus beau des cahiers est sans doute le troisième. On y trouve un texte nu, très, très rude, sur la mort de son enfant : « L’enfant était sorti. Nous n’étions plus ensemble. Il était mort d’une mort séparée. Il y avait une heure, un jour, huit jours, mort à part, mort à une vie que nous avions vécue de neuf mois ensemble et qu’il venait de mourir séparément. Mon ventre était retombé lourdement, floc, sur lui-même, comme un chiffon usé, une loque, un drap mortuaire, une dalle, une porte, un néant que ce ventre. » Puis on lit le récit du premier été d’après-guerre qui fut marqué par des vacances en Italie sur une plage avec Robert Antelme et l’amant Dyonis Mascolo (dont elle aura un fils, Jean), avec aussi le grand écrivain Elio Vittorini et sa femme. Dans une prose tactile, effervescente, une chaîne de phrases parfaites, elle décrivit les bains de mer, les bains de soleil, la beauté alanguie des corps, la lumière, les nuits tièdes, le grand large, les figuiers, les citrons, le pastis, la vie dénouée, épanouie. Ces pages saturées de parfums, vives, ondoyantes, altières sont un chant sensuel, un hymne à la vie. Plus tard, dans ‘’Les petits chevaux de Tarquinia’’, elle reprit le récit de cet été-là.Sous l’appellation ‘’Les autres textes’’, on trouve des notes, essais, fragments, bribes. Le chapitre ‘’L’enfance illimitée’’ est magnifique : « Ma mère a été pour nous une vaste plaine où nous avons marché longtemps sans trouver sa mesure.» La mère est donc, comme chez Proust, la clé de l’œuvre de Marguerite Duras.
Commentaire
On sort abasourdi de la lecture de la coulée de lave en fusion que sont ces cahiers qui dormaient depuis 1947 dans la maison de campagne de Marguerite Duras. On y trouve des révélations biographiques capitales, les sources, parfois sordides, de son oeuvre de l’écrivaine dont on voit l’envol car, en pleine guerre, une inconnue de trente ans trouva et affirma son ton dans ce journal intime, devint la Duras en se délivrant de ce qui la hantait : l’Indochine. On tient la « matrice » d’où sont sortis tous ses grands romans, depuis ‘’Un barrage contre le Pacifique’’ et ‘’Le marin de Gibraltar’’ jusqu’à ‘’L’amant’’. On assiste à la « scène primitive » qu’est le tango où Marguerite fut offerte à Léo. On voit comment, tout au long de son œuvre, elle repassa, rejoua ce couple enlacé surveillé par une famille perverse, mais l’idéalisa. On pénètre dans le secret de la fabrique durassienne, ce ton fait de modulation, d’appel au paroxysme, d’ambiance fin du monde. Absence, cri, pâmoison, solitude : tout y est. On se dit, en se souvenant de ‘’L’amant’’ : quelle puissance de travestissement et d’ennoblissement d’une humiliation primitive.On voit avec quelle économie elle veilla à ce qu’aucune situation ne se perde, pour tout exploiter, explorer, fouiller. Ce qui était une impression, sur sa méthode de travail, est confirmé par l’ouverture de ces armoires bleues. » Reste un mystère. Qu’elle ait gardé pendant plus de quarante ans ces cahiers sans précaution particulière, dans une maison régulièrement inondée, en dit long aussi sur ce perpétuel balancement chez elle entre conservation et destruction, entre mémoire et oubli. Elle dira : «Ça rend sauvage, l’écriture.»