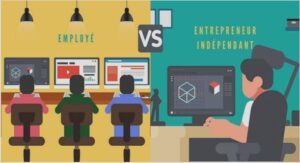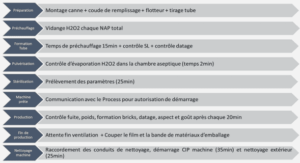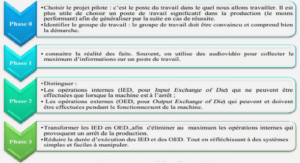Mais surtout, lisez ! : les pratiques de lecture des femmes dans la France du premier XIXe siècle
Idéalité de la lecture des femmes : discours religieux et exemplarité de la lectrice
Dernière « institution » dont nous voudrions soumettre le discours sur la lecture à l’étude, l’Église catholique. La première moitié du XXe siècle porte la trace d’une rhétorique déjà ancienne à l’encontre des mauvaises lectures. Les historiens du religieux et du culturel l’ayant étudiée ont mis en évidence deux phénomènes majeurs qu’il importe de rappeler3 . D’une part, le discours clérical sur ce sujet est marqué par une certaine pérennité, voire fixité dans le temps. Les arguments, par exemple, sur la mauvaise littérature comme « poison » qui contamine la société ne s’éloignent guère de ceux employés, depuis le XVIe siècle au moins, par les théologiens : l’Église catholique s’appuie ici sur la culpabilisation des lecteurs, responsables de leur chute s’ils goûtent au fruit défendu de la littérature. En cela, le XIXe siècle n’apporte rien de nouveau, si ce n’est que l’Église réadapte sa cible : les ouvrages condamnés sont ceux qui proposent une morale « alternative » à la morale catholique, comme ceux des philosophes des Lumières, ou ceux qui alimenteraient la dégradation morale de la société en proposant des exemples du vice, principalement les romans contemporains4. Selon Gisèle Sapiro, l’Église catholique reprend en bloc l’argumentaire contre la littérature sans établir de distinction nette ni entre genres littéraires, ni entre classes de lecteurs5. Les nombreux sermons prononcés par les évêques français dans les années 1840 fustigent d’une même voix l’ensemble des lecteurs incompétents et une partie de la production littéraire. Les littérateurs, fautifs désignés, sont ceux qui inoculent ce poison, coupables d’hypocrisie lorsqu’ils déguisent sous des récits enjolivés des idées contraires à la vertu. Le sermon prononcé par l’évêque de Metz en 1846 en restitue les principaux éléments : De tous les dangers, nos très chers frères, qui menacent la Religion et les mœurs, il n’en est point peut-être de plus, ni par conséquent qu’il soit plus pressant de vous signaler, que les mauvaises .On se reportera notamment aux travaux de Claude Savart, Les Catholiques en France au XIXe siècle, op. cit., de Loïc Artiaga, Des torrents de papier. Catholicisme et lectures populaires au XIXe siècle, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2007 ou encore de Jean-Yves Mollier pour la seconde moitié du XIXe siècle. 4 Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain, op. cit., p. 126-139. 5 Ibid. 130 lectures. Jamais la France n’a été inondée, autant qu’elle l’est de nos jours, d’écrits et de productions littéraires de tout genre, où la foi, la morale, la vérité, le bon sens et le goût sont presqu’également offensés et foulés aux pieds. C’est dans ces sources impures, que, chaque jour, des milliers de lecteurs de tout âge, de tout sexe, de toute condition, boivent avec avidité un poison mortel, qui, pénétrant dans toutes les veines du corps social, devient pour la société entière un principe actif et terrible de destruction, désole les générations présentes, et peut devenir la ruine entière des générations futures6 . Malheur, ruine de la société, perversion des lecteurs, autant d’arguments que l’on retrouve, en 1904, dans la célèbre brochure de l’abbé Bethléem, Romans à lire, romans à proscrire7 . Pour autant, on ne peut reléguer, dans les premières décennies du XIXe siècle, l’action de l’Église catholique dans l’obscurité d’un discours et d’une action réactionnaires. Loïc Artiaga a pertinemment montré comment la condamnation des mauvais livres par l’Église reposait, depuis le début du siècle, sur des mécanismes nouveaux, en s’adaptant, en modernisant, si ce n’est son discours, du moins son action préventive. Évidemment son rôle de censeur et de gardienne des mœurs reste puissant, et son impact sur les comportements des individu·e·s du XIXe siècle, bien qu’il soit délicat à mesurer, sans doute important. Censeurs, les hommes de l’Église catholique ont endossé activement ce rôle au cours du siècle, ainsi que son pendant « positif », celui de prescripteurs des bonnes lectures. Et alors que la reconquête catholique s’appuie en grande partie sur les femmes, celles-ci occupent de ce fait une place inédite dans l’action et le discours de l’Église, ce qui montre la capacité d’adaptation de cette dernière aux transformations culturelles en cours. Dans un premier temps, on pourra mesurer cette modernité en examinant la place accordée aux femmes dans l’Œuvre des bons livres par rapport à la situation des lectrices dans les autres lieux publics de lecture. Puis on verra, à partir d’un corpus peu exploité, celui des biographies pieuses de jeunes filles, quelle figure de lectrice idéale s’y dessine. Ces ouvrages témoignent de l’investissement massif de l’Église dans le domaine éditorial, à la (re)conquête d’un nouveau lectorat, les jeunes filles. 6 Mandement de Monseigneur l’évêque de Metz, pour le carême de l’an de grâce 1846, sur le danger des mauvaises lectures, Metz, impr. Collignon, 1846, p. 1-2. Loïc Artiaga recense une vingtaine d’instructions pastorales, de circulaires épiscopales, entre 1830 et 1860 et ayant pour sujet unique la lecture. Loïc Artiaga, Des torrents de papiers, op. cit., p. Louis Bethléem, Romans à lire, romans à proscrire. Essai de classification au point de vue moral des principaux romans et romanciers de notre époque (1800-1914), Cambrai, O. Masson, 1904. On lira au sujet de cette brochure l’analyse qu’en a faite Jean-Yves Mollier, La Mise au pas des écrivains. L’impossible mission de l’abbé Bethléem au XXe siècle, Paris, Fayard, 2014.
Bonnes et mauvaises lectures dans la pastorale catholique : à la reconquête du lectorat
Cette action s’inscrit dans un contexte précis, celui, à l’heure où les Bourbons retrouvent leur place sur le trône, d’une « réaction cléricale8 » qui tente de restaurer la place centrale qu’occupait la religion dans la société française avant la Révolution. Les femmes ont un rôle prépondérent dans cette mission : en témoignent notamment l’augmentation rapide des congrégations féminines9 mais aussi des initiatives à destination des plus jeunes, comme la création des Enfants de Marie en 1837, association pieuse de jeunes filles laïques que de nombreuses communiantes intègrent. Dans sa lutte proclamée contre la corruption des mœurs, l’Église met alors en place un dispositif efficace sur un terrain où s’affrontent déjà, nous l’avons vu, médecins et pédagogues : celui de la propagation de la « bonne lecture », particulièrement active à partir des années 1820.
Lectrices et espace publique : le projet inédit de l’Œuvre des Bons Livres
L’Œuvre des Bons livres en avance sur la réforme des bibliothèques publiques L’une des initiatives précurseurs en la matière, l’Œuvre des Bons livres, connut un rayonnement et une longévité exceptionnels. Cette association est fondée en 1822 à Bordeaux par l’abbé Barault, à partir d’un projet original et novateur pour l’époque, celui de créer un réseau de bibliothèques paroissiales. Placées sous l’autorité morale de l’évêque et la tutelle du curé, les bibliothèques paroissiales sont en revanche appelées à être gérées par les paroissiens et les paroissiennes. L’Œuvre essaime dans toute la France, celle de Lyon voit le jour en 1827, celle de Paris peu après, et Claude Savart estime qu’en 1848 on trouvait des bibliothèques de l’Œuvre dans la plupart des grandes et moyennes villes de France330. Le projet de l’abbé Barault part d’un constat simple : il faut que l’Église catholique puisse répondre à une demande qui est en train d’émerger tout en accomplissant sa mission séculaire de propagation de la foi et de lutte contre les mauvais livres. L’Église investit un terrain qui pour l’heure ne préoccupe guère l’État. Au même moment, celui-ci concentre son action sur les grandes bibliothèques savantes que fréquente une toute petite élite masculine : cinq cents lecteurs·trices quotidien·ne·s au maximum à la Bibliothèque Royale, une quarantaine à l’Arsenal, spécialisée en littérature, poésie et histoire, entre soixante et quatre-vingts à Sainte-Geneviève, parfois un peu plus à cause de sa vocation plus estudiantine331. Il existe bien dans la plupart des grandes villes françaises un réseau de bibliothèques publiques, fondé pendant la Révolution Française sur les ruines des bibliothèques privées dont les collections alors ont été confisquées, mais leur lectorat se compte parfois sur les doigts d’une main3. Après nombres de balbutiements et de ratés, la véritable impulsion est donnée à la fin de la Restauration et surtout au début de la monarchie de Juillet, sous le ministère de Guizot puis sous son successeur, Salvandy, ministre de l’Instruction publique de 1837 à 1839. Mais là, ce sont les grandes bibliothèques, la Bibliothèque Royale, celle de l’Arsenal ou Sainte-Geneviève, qui sont concernées. Il s’agit pour l’essentiel de donner de la visibilité aux collections détenues dans ces lieux prestigieux et d’étendre les horaires d’ouverture pour permettre à un nouveau lectorat d’y accéder. Les nombreuses lettres adressées au ministère par les conservateurs, ainsi que l’absence de réponses de ceux-ci à l’enquête sur les lecteurs des bibliothèques que lance Guizot en 18, témoignent bien de la réticence des bibliothécaires à changer leurs pratiques. Ainsi dès 18, Charles Nodier et Alexandre Duval, conservateurs de la Bibliothèque de l’Arsenal, suivis par l’ensemble du personnel, proclament leur refus d’élargir les horaires d’ouverture car cela détournerait la fonction principale du lieu, un lieu de savoir destiné aux érudits, en en faisant un lieu assimilable aux autres établissements urbains de loisir fréquentés par des publics « oisifs et légers». De fait, des horaires limités excluaient dans la pratique tout un public potentiel : 330 Claude Savart, Les Catholiques en France au XIXe siècle, op. cit., p. 405. En 1843, on en repère notamment à Toulouse, Cambrai, Lyon, Paris, Nantes, Saint-Omer, Valenciennes, ou encore Vendôme. Les premières statistiques de fréquentation des bibliothèques datent pour leur part de 1857, et la situation ne s’est guère améliorée : quatre établissements sur l’ensemble du pays reçoivent entre 100 et 150 lecteurs par jour ; 105 établissements, aucun lecteur. Cela traduit l’inadéquation des bibliothèques à leur public encore sous le Second Empire. Agnès Marcetteau-Paul, « Les bibliothèques municipales » in Dominique Varry (dir.), tout le monde ouvrier, qui travaille la journée, mais aussi les étudiants. Pourtant, si aucune loi ni règlement n’interdisent aux femmes l’accès à une bibliothèque publique334, on peut affirmer sans trop de risque que le lectorat « savant et érudit », évoqué dans les rares enquêtes sur les bibliothèques, est majoritairement masculin. Car plusieurs obstacles très concrets rendent alors l’accès des bibliothèques difficile aux femmes : difficile d’obtenir la recommandation nécessaire pour emprunter des livres, délivrée généralement par un notable comme le maire de la commune ; ardu également de s’y retrouver dans les rayonnages de la bibliothèque, face à des catalogues souvent incomplets quand ils existent – c’est l’un des objets des réformes des années 1830 – et sans système de classement unifié ; dissuadant, enfin, le regard masculin et réprobateur sur une présence féminine qui, si elle n’est pas illégale, reste en revanche perçue comme illégitime dans ces lieux de savoir, comme en témoigne Sophie Ulliac-Trémadeure dans ses Souvenirs335. La seule représentation iconographique d’une lectrice dans une bibliothèque publique que nous avons pu trouver insiste justement sur cette présence anormale : en 1844, dans sa série sur les « Bas-Bleus » parue dans le journal satirique Le Charivari, Honoré Daumier représente une femme faisant des recherches dans la salle d’une bibliothèque. Ayant accumulé un certain nombre de livres autour d’elle, elle perturbe les autres lecteurs, tous des hommes336 . Homo-sociabilité et lecture : l’exemple des sociétés littéraires En dehors des bibliothèques, peu fréquentées, plusieurs lieux de sociabilité offrent déjà des espaces potentiels de lecture dans la ville du premier XIXe siècle : les cafés et les clubs se multiplient depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, et les sociétés littéraires, de plus en plus nombreuses, répondent à un besoin de prolonger la lecture par le débat337. Mais tous ces lieux . Les seules restrictions concernent généralement l’âge ou l’origine. Dans les principales sources disponibles sur les bibliothèques publiques dans la première moitié du siècle, essentiellement des archives institutionnelles (rapports, circulaires…), il est quasiment impossible de repérer des femmes, celles-ci ne sont pas perçues comme un public potentiel ou, en tout cas, spécifique. Par « société littéraire », nous entendons toute institution qui « consiste en une association volontaire dotée de statuts collectivement approuvés », et dont les membres, moyennant une « souscription annuelle, peuvent emprunter les livres acquis par la société ». Ces sociétés existent déjà au XVIIIe siècle en France et en Europe, sous différentes appellations (par exemple « chambre de lecture », « book club », etc.). Voir Roger Chartier, « Sociétés de lecture et cabinets de lecture en Europe au XVIIIe siècle. Essai de typologie », in Sociétés et cabinets 134 de sociabilité lettrée sont, soit dans l’usage, soit dans les règles, strictement masculins338. Un bon exemple nous en est donné à Lyon et dans sa région connaissent. Dans la décennie 1820, on assiste à une vague de création de sociétés de lecture, à mi-chemin entre les clubs et les bibliothèques. Ces sociétés apparaissent sous l’Empire dans la continuité des chambres de lectures bourgeoises du XVIIIe siècle339. Elles fonctionnent de fait comme une bibliothèque publique, disposant d’un fonds d’ouvrages consultables sur place ou empruntable à domicile, tout en édictant des règles strictes d’adhésion, basées sur une cotisation élevée et une cooptation par les autres membres de la société : à Annonay, les candidats doivent être âgés d’au moins dix-neuf ans, présentés par deux autres membres et ensuite élus à bulletin secret. Une fois élus, ils doivent s’acquitter d’un droit d’entrée ainsi que d’une cotisation annuelle de 20 francs, coût prohibitif pour le lectorat populaire340. De plus, les règlements et statuts de ces nouveaux espaces de lecture posent comme principe implicite la non-mixité. Ainsi, la Société de lecture de Lyon, fondée en 1827, réserve son entrée aux citoyens majeurs, excluant de facto les femmes341 ; celle d’Annonay l’affiche plus ouvertement dans ses statuts. Il y est indiqué qu’« en cas de mort d’un sociétaire, celui de ses fils qui se présentera dans le courant de l’année qui suivra son décès […] prendra lieu et place de son père342 ». Ces règlements en font des lieux élitistes (un droit d’aînesse entre les différents fils d’un membre est même envisagé à Annonay) qui les distinguent des cabinets de lecture, plus populaires et mixtes, qui s’ouvrent en nombre à la même période343. En cela, ils territorialisent les pratiques culturelles d’un point de vue de lecture entre Lumières et romantisme, Actes du colloque organisé à Genève, 20 novembre 1993, Genève, Société de lecture, 1995, p. 43-56. 338 Michel Vernus évoque, pour la Franche-Comté du XVIIIe siècle, deux exemples de sociétés littéraires où, potentiellement, étaient admises des femmes. Nous n’en avons pas trouvé pour notre période. Voir Michel Vernus, « La lecture féminine en Franche-Comté au XVIIIe siècle », Histoire et civilisation du livre, 2011, VII, p. 285- 299. 339 Noé Richter, La Lecture et ses institutions, 1700-1918, Le Mans, Éditions Plein Chant, 1987, p. 84. Le Cercle de la Rotonde, ouvert en 1810, affirme dans une publicité de 1823 avoir été le premier de la capitale. Voir Bibliographie de la France, ou Journal général de l’imprimerie et de la librairie, année 1823, p. 6. 340 A. Alléon, Catalogue des livres de la société de lecture de la ville d’Annonay, précédé d’un historique de la société de lecture, Lyon, Louis Perrin, 1835, p. XXXI-XXXII. 341 Règlement de la Société de lecture de Lyon, fondée en 1827, Lyon, imprimerie de Louis Perrin. 342 A. Alléon, Catalogue des livres de la société de lecture de la ville d’Annonay, op. cit., p. XXVI. Quand elles existent et sont publiées, les listes des membres de ces sociétés confirment cette stricte non-mixité. Noé Richter affirme pour sa part que le Cercle de la Rotonde de Paris a rapidement ouvert « une salle de lecture et de louage pour Dames ». Noé Richter, La Lecture et ses institutions, op. cit., p. 85. 343 Bien que la frontière soit tenue entre les deux institutions, les cabinets de lecture, quant à eux, ont permis à Françoise Parent-Lardeur, du profil social des lecteurs en fonction de leur répartition géographique dans la capitale. Mais cela ne permet pas d’y repérer, avec certitude, les lectrices. Et si les tenanciers des cabinets se trouvaient bien souvent être des tenancières, rien n’indique que ces commerçantes savaient lire. Voir Françoise ParentLardeur, Lire à Paris au temps de Balzac. Les cabinets de lecture à Paris, 1815-1830, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1981. Noé Richter et Graham Falconer repèrent quant à eux trois femmes sur la liste des clients – une douzaine au total – d’un cabinet de lecture de Mulhouse en 1829. Noé Richter et Graham Falconer, « Et les clients des cabinets de lecture ? Deux documents inédits », in Graham Falconer (éd.), Autour d’un cabinet de lecture, Toronto, Centre d’études du XIXe siècle, Joseph-Sablé, 2001, p. 125-151. 135 social et sexuel344. Fait intéressant, en 1827, la municipalité d’Annonay s’associe à la Société de lecture pour créer une bibliothèque publique sans en modifier, apparemment, les statuts. La situation ne connaît une évolution sensible qu’à la fin du siècle345 . Le fonctionnement de l’Œuvre des Bons livres : une reconnaissance des lectrices ? Le projet de l’abbé Barault repose donc sur un tout autre pari. L’Œuvre des Bons livres entend procéder à une véritable reconquête des fidèles par un maillage territorial serré, l’action de ses administrateurs sur le terrain et une hiérarchie stricte entre ses membres. Plus proches à leur début d’une bibliothèque itinérante, présente le dimanche à la sortie de la messe, les bibliothèques paroissiales sont alimentées par un dépôt central qui est en même temps le siège local de l’Œuvre. L’Association de Lyon nous offre un bon exemple de son fonctionnement346 . En 1840, l’abbé Cognet en est le directeur ecclésiastique et responsable du dépôt central, vraisemblablement établi dans le quartier populaire de la Croix-Rousse. Placé sous l’autorité de l’archevêque, il est secondé par un conseil général, rassemblant notamment les différents curés de la ville, et par deux comités : un, composé d’hommes, chargé de la distribution des livres dans les dépôts locaux et du rayonnement de l’Œuvre, et un comité de seize femmes, qui s’activent sur le terrain, à la recherche de nouveaux lecteurs347. L’Œuvre emploie, tant dans le 344 Maurice Agulhon, dans son étude sur les cercles de sociabilité, avait bien mis en avant leur principe de fonctionnement non-mixte, et leur importance dans la définition de l’identité masculine et bourgeoise. D’après les études sur l’espace urbain et le genre au XIXe siècle, l’homo-sociabilité qui règne dans ces différents lieux constitue même un marqueur fort de l’affirmation de la masculinité au XIXe siècle. Voir Maurice Agulhon, Le Cercle de la France bourgeoise. 1810-1848. Étude d’une mutation de sociabilité, Paris, Armand Colin, 1977 et Michelle Perrot, « Le genre de la ville », in Idem, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998, p. 281-295. 345 Nous n’avons pas trouvé de traces de sociétés de lecture féminines avant le début du XXe siècle. L’Association Cent-Une, fondée par l’arrière-petite-fille de Lamartine en 1926, affirme être la première société de femmes bibliophiles. Mais nous sommes là face à un autre rapport à l’objet-livre. 346 Les archives de l’Œuvre de Lyon n’ont pas été conservées au diocèse de Lyon. On trouve néanmoins d’utiles informations dans les divers historiques de l’Œuvre, ainsi que des documents relatifs à son organisation, à la Bibliothèque Municipale de Lyon : la brochure de présentation de l’Association de Lyon et l’Extrait des statuts de l’Association de la propagation des bons livres établie à Lyon, Périsse, 183 ? (BML 436909 et 436909 (2)) ; l’Instruction pastorale sur les mauvais livres, au clergé et aux fidèles de Belgique, suivi de l’historique des Œuvres des bons livres et des bibliothèques paroissiales, et de leur développement en France et en Belgique, Bruxelles, 1843 (BML SJ AK83/108) ; ainsi que le Catalogue de la bibliothèque de l’Œuvre des bons livres de la ville de Lyon, établi en 1870 par la Bibliothèque des Bons livres et précédé d’un aperçu sur l’Œuvre de la Propagation des Bons livres, Lyon, 1870 (BML Chomarat A 5118). 347 « Le second comité, composé de 16 dames, s’assemble tous les quinze jours. Ces dames ont accepté la mission de rechercher les personnes auxquelles on peut procurer utilement de bons livres, de visiter les associés à des époques convenables, d’exciter leur zèle, de travailler à en augmenter le nombre. » Instruction pastorale sur les mauvais livres, op. cit., p. 101. 136 détail de sa structuration que dans sa rhétorique, une sémantique guerrière qui souligne davantage sa mission évangélisatrice : l’organisation est ainsi divisée en « sections » et « centuries », envoyant sur le terrain ses « soldats » devant lutter contre l’influence des mauvais livres. Le fonctionnement de l’Œuvre nous apparaît original sur deux points : outre le fait que son dynamisme témoigne, comme le souligne Loïc Artiaga, de la prise en compte par l’Église catholique d’une forme de « modernité médiatique348 », ancrant son action dans son temps, voire par certains aspects le devançant, elle fait surtout une place aux femmes, à la fois médiatrices et lectrices. Tout d’abord, leur rôle au sein de l’organisation étonne. Le comité de femmes, bien qu’en bas de la hiérarchie et sous l’autorité d’hommes, leur attribue toutefois un rôle non négligeable dans le fonctionnement global de l’Œuvre. L’intelligence de l’Œuvre est d’avoir sollicité chez ses membres féminins un investissement actif associé à un idéal de charité, qui fut, via les associations, l’un des ressorts efficaces de mobilisation des femmes de la bourgeoisie dans l’espace public au XIXe siècle. Au même moment, il demeure impensable d’employer des femmes dans les institutions publiques, et l’intégralité du personnel des bibliothèques est à cette époque exclusivement masculin. La féminisation du métier ne commence que beaucoup plus tardivement, à la fin du siècle349 . L’Œuvre prend donc les choses en marche. En tant que lectrices, les femmes font l’objet d’une politique spécifique de la part de cette association qui les appréhende dès l’origine comme une catégorie potentielle de son public. Certes, les lectrices sont considérées par l’Église comme particulièrement vulnérables, mais leur rôle dans la transmission des valeurs chrétiennes et la mission civilisatrice qui leur est attribuée obligent à ne pas les exclure de ce mouvement. Ainsi, le règlement de la bibliothèque religieuse d’Aix, émanation de l’Œuvre, prévoit une journée, le lundi, strictement réservée aux lectrices350. Surtout, le fonctionnement des bibliothèques paroissiales, qui sont des lieux de dépôt et non de consultation, oblige à mettre en place un système de prêt à domicile efficace qui contourne en conséquence la question de la mixité.
Remerciements |