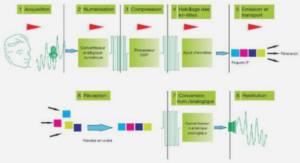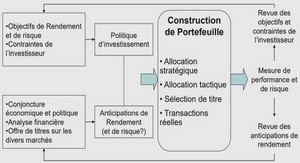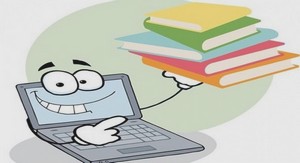L’observation non-participante
Nous avons choisi d’utiliser la méthode de recueil qu’est l’observation non participante, ou observation passive, en raison de la compréhension de la réalité de l’organisation que 172 l’immersion permet. Selon Wacheux (1996), ce type d’observation désigne : « l’autorisation d’être présent dans l’organisation pour regarder la réalité quotidienne, assister aux évènements pour les enregistrer et les analyser » (p. 215). En effet, assister à des échanges formels et informels au sujet de l’égalité professionnelle en dehors de nos sessions d’entretiens nous a permis d’accumuler des données d’un autre ordre. Nous avons eu deux séances d’observation passive, la première lors du groupe de travail organisé avec les partenaires sociaux, le représentant diversité de l’époque et le responsable RH affecté aux relations avec les partenaires sociaux. A cette occasion, ont eu lieu des échanges ayant pour base les rapports de situation comparée (RSC) présentés au niveau national et local.
La seconde séance a eu lieu au sein du service RSE/RH France. Une place spécifique avec un accès à la documentation susmentionnée nous avait été réservée. Méthode de recueil utilisée : le journal de bord Au vu du peu de séances d’observation prévues, nous avons décidé de nous orienter vers la méthode du journal de bord, plutôt que celle de la grille d’observation que préconise Journé (2012). Ainsi, pour mettre en œuvre cette méthode, nous nous sommes appuyés sur la définition que donne Baribeau (2005) : « Le journal de bord est constitué de traces écrites, laissées par un chercheur, dont le contenu concerne la narration d’événements (au sens très large; les événements peuvent concerner des idées, des émotions, des pensées, des décisions, des faits, des citations ou des extraits de lecture, des descriptions de choses vues ou de paroles entendues) contextualisés (le temps, les personnes, les lieux, l’argumentation) dont le but est de se souvenir des événements, d’établir un dialogue entre les données et le chercheur à la fois comme observateur et comme analyste, de se regarder soi-même comme un autre. » (p.108)
Partant de cette définition, nous avons appliqué la méthode dont fait état Giordano dans son ouvrage de 2003 et qui met en évidence 3 types de notes: de terrain, méthodologiques et d’analyse. Alors que les premières concernent la description de ce qu’il se passe lors de la séance en termes d’environnement mais aussi de comportements et de conversation, les secondes, quant à elles, renvoient à la manière dont le chercheur comprend ses relations avec ce qu’il observe et l’impact que cela peut voir sur la prise de note. Enfin, les notes techniques sont les premières constatations et analyses du chercheur par rapport à ce qu’il observe.
Ces séances nous ont donc permis de nous familiariser encore plus avec notre terrain d’étude, assurant une cohérence avec la visée compréhensive et exploratoire de notre démarche ainsi que notre positionnement épistémologique. 173 Ces dernières ont alimenté notre connaissance du contexte de l’entreprise mais aussi, comme nous le verrons dans le chapitre 7 consacré à l’audit égalité, elles nous ont permis de mettre en lumière des écarts entre le discours de l’égalité et la pratique de l’égalité dans l’organisation. Ces séances seront donc abordées dans les sections consacrées à l’asymétrie de pouvoir entre le management et le RH, la présence de sexisme dans l’organisation et l’application des accords négociés avec les organisations syndicales.
Les entretiens exploratoires
Notre terrain d’étude est constitué d’une constellation d’organisations qui entretiennent entreelles des relations complexes. Aussi, afin de comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement de ce dernier et les problématiques à investiguer, nous avons organisé une série de 5 entretiens exploratoires. Ces entretiens nous ont servi de base pour compléter notre revue de littérature et créer notre guide d’entretien. Nous avons donc rencontré 4 fois le directeur RSE France, la chargée d’étude RH France et le relais diversité du site pour des entretiens d’une durée d’1h30 à 2h. En outre, un entretien téléphonique de plus d’une heure a été réalisé avec le relais diversité. Les supports pour l’analyse documentaire nous ont été communiqués rapidement, nous permettant ainsi de poser des questions précises à chaque nouvel entretien.
Ces entretiens exploratoires constituent la première étape empirique de notre recherche
Ils ont été particulièrement utiles dans la compréhension du fonctionnement de l’organisation ainsi que dans la détection de problématiques à creuser lors des entretiens semi-directifs. C’est en nous basant sur les données obtenues de ces 5 entretiens exploratoires, sur la littérature antérieure et postérieure à ces derniers, que nous avons décidé de notre échantillon et que nous avons construit notre guide d’entretien pour nos 52 entretiens semi-directifs.
Les entretiens semi-directifs
Selon Romelaer (2005), il est très courant dans les recherches qualitatives de voir utiliser l’entretien comme méthode de recueil. Faire appel à cette technique permet de co-construire des connaissances avec les interviewés (Gavard-Perret et al., 2012). Comme nous projetons de faire passer des réseaux d’association individuels (exercice spécifique à l’étude des RS) en milieu d’entretien, nous optons pour des entretiens individuels semi-directifs. Nous avons choisi ce mode de recueil qui repose sur un guide d’entretien, car nous souhaitions recueillir les positions des interviewés sur des thèmes identiques en vue d’une analyse thématique (GavardPerret et al., 2012). Nous avons cependant systématiquement laissé la liberté aux interviewés de digresser, afin de ne pas passer à côté d’éléments que nous n’aurions pas anticipés.