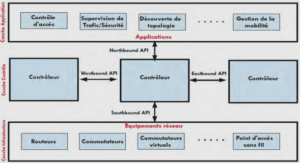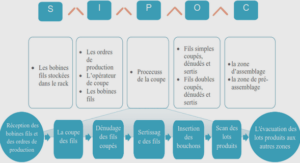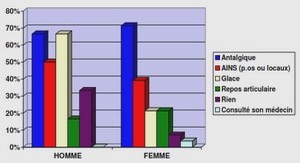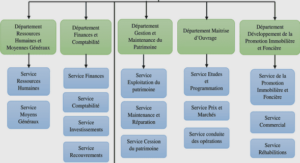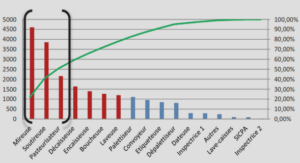Yolande Mukagasana : parler avec les tueurs1…
Rwanda 94, la pièce de Jacques Delcuvellerie, s’ouvre sur une jeune femme assise dans la pénombre. Elle raconte d’une voix étonnamment sereine ce que fut pour elle le mois d’avril 1994. Elle se nomme Yolande Mukagasana et elle ne joue pas. Elle se contente de parler à un public pétrifié de la mort à petit feu de son époux Joseph Murekezi et de leurs trois enfants. Elle dit comment sa petite Nadine a été jetée vivante à treize ans dans une fosse commune. Elle dit comment Sandrine et Christian ont été sauvagement découpés à coups de machette. Dans quels charniers leurs restes ont-ils été éparpillés avec des cris de haine, parmi des dizaines de milliers de corps ? Elle ne le sait même pas. Son témoignage, direct, précis et détaillé, n’en est que plus émouvant.
Devenue célèbre dès la publication en 1997 de La mort ne veut pas de moi2, Yolande Mukagasana est, comme Venuste Kayimahe, Ntaribi Kamanzi et Benjamin Sehene, de ces Rwandais qui refusent de passer par pertes et profits le million de victimes du génocide. Après avoir échappé de justesse à la mort, Yolande Mukagasana s’est inventé plusieurs vies, tendues vers un seul but : faire éclater toute la vérité sur les Cent Jours d’horreur du Rwanda.
Cette lutte, elle ne la mène pas seulement au théâtre. Elle promène aussi une exposition à travers le monde et publie un livre à peu près tous les deux ans. Le second, N’aie pas peur de savoir3, est un remarquable appel à la lucidité et au courage. Partout où se tient un débat sur le sujet, on est presque assuré de l’entendre expliquer, chiffres et faits à l’appui, la voix souvent rageuse, comment un État moderne a entrepris d’exterminer méthodiquement toute une partie de sa population. Ce n’est sûrement pas à cette rescapée que l’on fera croire que les grandes douleurs sont muettes. Elle est un peu la folle qui arrête des inconnus dans la rue pour leur répéter inlassablement : « Moi, Yolande Mukagasana, j’ai perdu les miens dans des conditions abominables pendant le génocide, je sais que vous n’êtes pas au courant mais, quoi que vous en pensiez, cela vous regarde, vous aussi. » La démarche est certes insolite. Elle aurait pourtant dû paraître naturelle à une époque où tant de bonnes âmes se prétendent soucieuses du respect des droits humains. Mais il faut bien croire que ces droits ne sont pas les mêmes pour tous les hommes. Le récit des malheurs de Yolande Mukagasana ne réussit que très rarement à tirer les uns et les autres de leur agréable torpeur.
Si sa croisade contre l’oubli lui a valu quelques attaques haineuses, il lui a fallu bien plus souvent soutenir des regards discrètement ironiques ou agacés. Sans doute le combat de Yolande Mukagasana paraît-il exaspérant à beaucoup. Cette mère de famille a perdu ses enfants ? La belle affaire ! On s’étonne qu’elle en fasse une histoire dans une Afrique où des milliers de gens meurent chaque jour pour toutes sortes de déraisons.
C’est qu’ils sont encore nombreux, ceux pour qui l’assassinat de plus d’un million de Rwandais ne mérite pas tant d’embarras. Dira-t-on que ce sont des négationnistes ? Même pas. Ils ne nient rien. Ils se préoccupent de choses plus sérieuses, c’est tout. Ils auraient du reste été bien en peine de contester des crimes si clairement établis et si spectaculaires. L’Américain Philip Gourevitch n’est pas le seul à avoir été frappé par le manque total d’ambiguïté du génocide rwandais4.
Agissant au grand jour et soutenus par une radio et par tous les moyens civils et militaires de l’État, les génocidaires n’ont jamais fait mystère de leurs intentions. D’autant plus assurés du résultat qu’ils savaient pouvoir compter sur un allié aussi important que François Mitterrand et sur la passivité de la communauté internationale, ils n’ont à aucun moment jugé utile de brouiller les pistes. C’est pourquoi aucun intellectuel sérieux n’a jamais osé mettre en doute l’ampleur et l’atrocité des massacres. Le génocide rwandais n’en a pas moins donné naissance à un négationnisme que l’on peut dire de principe. Celui-ci se fonde davantage sur des préjugés franchement racistes que sur la prise en compte de faits réels et récents, un impératif dont on s’estime d’ailleurs souvent dispensé dès qu’il s’agit de l’Afrique. Personne ne l’exprime mieux que Charles Pasqua qui, fin juin 1994, au plus fort des tueries, n’a pas hésité à déclarer au journal télévisé de 20 heures : « Vous savez, il faut bien comprendre que pour ces gens-là, le caractère horrible de ce qui s’est passé n’a pas du tout la même valeur que pour nous5. »
L’idée qu’au Rwanda chacun a tué à un moment ou à un autre, ramassée en des formules lapidaires par quelques intellectuels et hommes politiques connus, n’est d’ailleurs pas moins répandue parmi les Africains que dans le reste du monde. Elle procède d’une logique récusant à l’avance toute tentative de tracer une ligne de séparation entre des coupables et des innocents. L’image de l’Afrique étant celle d’un continent en proie aux épidémies, aux guerres tribales et aux famines, nier le génocide c’est suggérer que la norme historique ait pu être un accident. En revanche, en souligner la sanglante pagaille revient à faire un constat d’évidence : l’Afrique reste malheureusement égale à elle-même. Il n’y a dès lors aucun risque à en rajouter : on ne dit pas que le génocide n’a pas eu lieu, mais au contraire qu’il a eu lieu deux fois et que chacun y a été tour à tour dans le rôle du bourreau et dans celui de la victime. Le génocide rwandais est sans doute le seul que l’on nie en le dédoublant. Interrogé par exemple après le sommet franco-africain de Biarritz, François Mitterrand n’a pas hésité à retourner sa question à un journaliste en lui lançant : « Le génocide ou les génocides ? Je ne sais plus ce qu’il faut dire ! » Il ne le savait que trop. Dans sa position et compte tenu des relations étroites entre l’État français et les organisateurs du génocide, il était l’une des quatre ou cinq personnalités de la planète les mieux informées sur la situation au Rwanda. Il est surtout étonnant que le président Mitterrand ait trouvé la force de feindre la candeur et de s’amuser avec les mots dans une affaire aussi grave. De même, un ancien secrétaire général de l’Onu – qui s’en est, il est vrai, excusé plus tard – y est allé de son petit soupir désabusé : « Au Rwanda, disait-il, les Hutu tuent les Tutsi et les Tutsi tuent les Hutu. » Ce n’est pas tout. Tel ancien ministre français, de la Coopération bien évidemment, annonce fièrement, dans un ouvrage truffé de grossières inexactitudes et d’une niaiserie presque touchante, son intention de raconter enfin « la vraie histoire des génocides rwandais6 ». Toutes ces déclarations sont l’expression d’une négrophobie si tranquille qu’elle n’arrive même plus à être consciente d’elle-même. Elles ne s’expliquent que par le peu de cas que l’on fait, délibérément ou non, de la vie humaine dans un pays africain pauvre et sous domination étrangère.
Dans cette logique, ceux qui sont morts au Rwanda n’ont juste pas eu le temps de frapper les premiers au cours de ces éternels « massacres interethniques » devenus lassants pour tout le monde. On a ainsi entendu des visiteurs se demander, au terme d’un bref passage à Nyamata, si les corps exposés dans l’église n’avaient pas été transportés là par les nouvelles autorités de Kigali, après le génocide, pour mystifier les étrangers comme eux… Dans d’autres circonstances, pareilles obscénités auraient définitivement jeté le discrédit sur leurs auteurs. Il est courant d’évoquer le contexte économique – en particulier la pression démographique – pour expliquer l’ampleur des massacres. Ce n’est pas acceptable : nulle part la misère ne peut faire dégénérer des êtres humains en hyènes furieuses et irresponsables. Il est du devoir de tout être humain d’essayer de comprendre l’enchaînement des faits ayant conduit à ce drame. Mais cette réflexion doit partir du principe qu’une limite a bel et bien été franchie au Rwanda en 1994. Ne pas l’admettre, c’est laisser entendre que dans certaines parties du monde il n’y a aucune différence entre la vie et la mort. Chaque Africain doit s’interroger : pourquoi partout dans le monde des pères et des mères de famille tout à fait normaux, prêts à verser des larmes pour leurs chiens, s’autorisent-ils une telle désinvolture en face de cadavres d’enfants rwandais ?
On voit bien, en tout cas, ce qui séparera à tout jamais Yolande Mukagasana et Venuste Kayimahe de certains commentateurs un peu trop cool. Ces morts sur lesquels les racistes crachent avec tant de mépris sont tout simplement la chair de leur chair.
Il ne faut certes pas généraliser. En Afrique même, les intellectuels, mal informés ou de plus en plus enclins à l’autodénigrement, ont réagi au génocide par un silence dépité ou par de l’indifférence. Même si on ne peut compter pour rien l’indignation de Nelson Mandela et les rapports du professeur René Degni-Ségui ou de l’OUA, le drame rwandais n’a pas eu sur le continent un impact à la mesure de son incroyable démesure. Rwanda, un génocide français7 de Mehdi Ba, reste à notre connaissance une exception dans l’espace africain francophone.
En dehors des Rwandais eux-mêmes, la réflexion sur la question s’est surtout menée en Europe et en Amérique, grâce, entre autres, aux livres de Jean-Pierre Chrétien8, Gérard Prunier9, François-Xavier Verschave10, Patrick de Saint-Exupéry11 ou Colette Braeckmann12. Le fait que le photographe belge Alain Kazinierakis soit coauteur de ce troisième livre de Yolande Mukagasana montre bien que le caractère universel du génocide n’a pas échappé à tout le monde. Dans de nombreuses autres publications, des intellectuels de tous horizons, des journalistes, des universitaires et des organisations de défense des droits de l’homme donnent la parole aux rescapés. Les récits de ces derniers sont à la fois dépouillés et insoutenables. Les vécus individuels du génocide s’y déploient à partir du même schéma narratif : l’avion du président Habyarimana a été abattu dans la soirée du 6 avril 1994, les premières barrières ont été installées trente minutes plus tard, les leaders politiques hutu modérés ont été liquidés à partir de listes établies à l’avance, puis on a commencé à tuer tous les Tutsi, sans distinction de sexe, d’âge ou d’opinion. Death, Despair, Defiance13 publié à Londres dès mai 1994 par African Rights et Aucun témoin ne doit survivre14 sont des modèles du genre. Les survivants y racontent comment ils ont vu mourir les leurs et on devine aisément qu’au moment où ils parlent ils sont encore sous le choc de violentes émotions, puisque la plupart de ces témoignages ont été recueillis quelques semaines ou même quelques jours après les derniers massacres. Il est facile d’imaginer l’incrédulité et l’indignation de ceux qui ont dû faire ces enquêtes de terrain. Leur statut d’étranger les exposait de surcroît aux risques de distorsion, de malentendus, voire de manipulations, inhérents au simple passage d’une langue à une autre. On peut aussi penser que certains survivants se seraient bien dispensés de rouvrir leurs plaies. Encore marqués par la souffrance, sans doute avaient-ils surtout envie d’oublier ce proche passé pour se tourner tant bien que mal vers l’avenir.
Les travaux des intellectuels rwandais ont surtout été, de manière significative, un effort de rationalisation. José Kagabo, Benjamin Sehene15, Jean-Marie Vianney Rurangwa16, Josias Semunjanga et beaucoup d’autres ont revisité le génocide, chacun selon sa méthode, pour nous aider, par des analyses fondées sur leurs expériences personnelles, à en saisir tous les contours. Mais en comparaison de l’ampleur de la tragédie, les récits directs, recueillis par des Rwandais en direction de l’opinion internationale, restent finalement peu nombreux17.
Le livre de Yolande Mukagasana est une des premières tentatives destinées à combler cette lacune. Chaque témoignage y est soutenu par la photographie du rescapé ou du prisonnier dont les propos sont rapportés. Les images d’Alain Kazineriakis, qui s’est rendu avec Yolande Mukagasana sur les collines et dans les prisons du Rwanda, donnent à l’ouvrage une dimension particulière. Ses clichés saisissants révèlent les blessures des inconnus qui nous parlent et font de chacun d’eux un être humain à part entière. Ils réveillent, malgré nous, notre instinct de voyeur. Pour conjurer le trouble que provoquent ces retours en arrière, le lecteur sera en effet souvent tenté de scruter avec une muette stupéfaction chaque trait de chaque visage. Il s’arrêtera sans doute plus longuement sur ceux des assassins tant peut être grande l’envie – ou l’espoir – de surprendre l’homme dans le regard du génocidaire.
Même s’il y a dans Les Blessures du silence beaucoup de récits de rescapés, on s’aperçoit très rapidement que sa vraie originalité réside dans la prise de parole des tueurs. Les laborieuses justifications des bourreaux s’y croisent, en un fascinant dialogue à distance, avec les souvenirs de leurs victimes.
Parmi ces dernières, Yolande Mukagasana elle-même…
Elle est allée trouver dans leur prison des génocidaires dont la plupart ont décidé de plaider coupable. Le fait qu’elle soit elle-même une rescapée change du tout au tout sa relation avec eux. Le langage qu’elle leur tient – avec, pour une fois, des mots qu’ils comprennent directement – est très simple : « Vous devez admettre que vous êtes une partie du problème et que si vous ne dites pas pourquoi vous avez agi ainsi, personne ne comprendra jamais ce qui est arrivé. » C’est sa façon de les rappeler à leurs devoirs vis-à-vis de l’humanité et de leur dire qu’ils en font encore partie en dépit de leurs crimes.
Les meurtriers et elle se connaissent très bien. Ils se tutoient et Yolande Mukagasana les engueule à l’occasion. Petit à petit, on s’aperçoit que c’est sa propre histoire qui continue. Rien ne l’indique clairement, mais il est possible et même probable que parmi les monstres qu’elle a choisi d’affronter certains aient porté la main sur son mari Joseph ou sur ses enfants. Qu’on en juge par son entretien avec un certain Enos N.
« Vous connaissez Ngenzi Déo ? lui demande Yolande Mukagasana.
– Le sculpteur ? Oui, je le connaissais très bien », répond l’autre.
Yolande Mukagasana lui dit alors paisiblement : « C’était mon père. » Et son interlocuteur de s’écrier, presque épouvanté :
« Votre père ? Mais alors Musoni est votre frère ?
– Oui », fait Yolande.
Après un bref silence, l’assassin s’affole et déclare avec une gravité comique : « Je vous le jure solennellement, madame, je n’ai tué personne de votre famille. »
Au-delà de son humour insupportable, cet échange donne une idée de ce que peut être un pays où la question de savoir qui a tué qui continue à peser si fortement sur les relations humaines les plus banales. On dit souvent que bourreaux et victimes continuent à se croiser en silence sur les collines du Rwanda. Jusqu’ici on pouvait les imaginer en train de se jeter des regards lourds de sens avant de s’en aller chacun de son côté. Dans ce livre tout à fait hors du commun, la rencontre se déroule pour la première fois sous nos yeux et, au lieu de fuir la réalité du génocide, des Rwandais choisissent d’en parler sans haine mais aussi avec une franchise parfois brutale.
Le dialogue que Yolande Mukagasana a réussi à imposer aux génocidaires est vrai et d’une grande profondeur humaine. Il consacre aussi, d’une certaine façon, la revanche des faibles. Pendant le génocide, les tueurs débarquaient chez eux, les abreuvaient de grossièretés et ils suppliaient, en vain, qu’on leur laisse la vie sauve. Comment se parler en effet lorsque, comme dit le dramaturge tchadien Koulsy Lamko, « chantent les machettes » ? Dans Les Blessures du silence, la relation est totalement inversée. Ce sont à présent les bourreaux qui protestent de leur innocence. Certains d’entre eux s’empêtrent dans d’absurdes mensonges et de lâches reniements, mais la plupart de ces repentis sont d’une émouvante sincérité.
La force de Yolande Mukagasana, c’est qu’elle ne joue à aucun moment la comédie de la neutralité scientifique. Comment l’aurait-elle pu, d’ailleurs ? Le Rwanda est son pays et chaque témoignage la renvoie à sa propre douleur. Elle sait ce que cela signifie d’être caché quelque part et d’entendre la mort rôder autour de soi. Elle n’est pas une journaliste arrivée d’un pays lointain et que l’on peut abuser. Yolande Mukagasana ne se contente pas d’écouter, elle n’est pas venue pour prendre des notes à mettre en forme plus tard. Il s’agit moins pour elle d’écrire des phrases bien balancées que de crier des vérités dérangeantes.
Et puisqu’elle en sait sur leurs forfaits autant que les tueurs eux-mêmes, elle n’hésite jamais à les confondre. À Gaspard B. devenu soudain amnésique, elle rappelle, implacable : « C’est toi qui as fait sortir mes enfants de leur cachette. » Et à un certain Marc, elle crache avec colère en mettant fin à leur entretien : « Je n’ai plus la patience d’écouter tes mensonges. Tu m’as menti du début à la fin et cela m’est insupportable. »
La proximité de Yolande Mukagasana avec tous ses interlocuteurs fait de l’ouvrage un grand moment de vérité sur le génocide rwandais. Ils lui font totalement confiance et des choses sont dites dans ce livre qui ne l’ont encore été nulle part. Il ne faut pas oublier que Yolande Mukagasana est sage-femme de métier. Il est vrai qu’elle exerçait cette profession dans une autre vie, dans la vie d’avant. Pourtant, assez patiente pour attendre que l’aveu vienne à son heure, elle sait encore l’art de faire accoucher. Ainsi un génocidaire du nom de Sylvestre lui déclare-t-il tout penaud, au cours de leur deuxième rencontre : « Je t’ai menti la fois passée. » Cette confession faite, un obstacle psychologique est franchi et la relation devient plus saine. Ses interlocuteurs, rescapés ou prisonniers, appartiennent à toutes les couches de la société rwandaise. Des détenus aussi célèbres que Valérie Bameriki, de la sinistre RTLM, côtoient dans ce livre des Rwandais de tous âges et de toutes conditions. Les plus humbles sont d’ailleurs presque toujours les plus enclins à regretter leurs crimes et à demander pardon à leurs victimes.