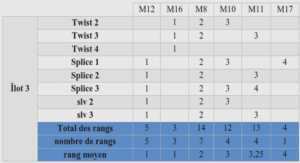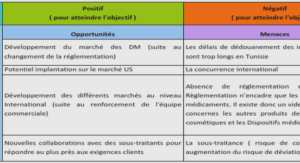L’institutionnalisation de la sécurité et de la sûreté au travers de « crises de contrôles »
La logique du « bastion défensif » ne fut pas exclusive aux gares, mais s’appliquait à l’ensemble des emprises ferroviaires, y compris les lignes et leur exploitation. Là aussi, il fallait protéger le réseau de l’extérieur et gérer les flux internes, non seulement de voyageurs, mais également (et obligatoirement) de trains. Comme nous l’avons déjà vu, la fiabilité technique fut le premier défi à relever pour les compagnies. Cette exigence est à la fois une obligation du service public que leur confie l’État et une condition de leur viabilité économique. Bien sûr, les dirigeants des compagnies n’eurent de cesse de combattre certaines obligations des cahiers des charges et de la législation jugées trop contraignantes. Contrairement à la question du vol de marchandises – qui fut le vecteur par lequel les compagnies puis la SNCF s’approprièrent les questions de sûreté, et ce surtout après la Première Guerre mondiale – la sécurité de l’exploitation ferroviaire (la SEF) fut immédiatement prise en charge en tant que telle. Rien d’étonnant à cela puisqu’elle constitue en effet la condition sine qua non de l’activité de ces entreprises. Aussi, il n’y eut pas un corps de métier spécifiquement responsable de la sécurité : chaque corps de métier contribuait à la sécurité de l’ensemble du système ferroviaire. L’exigence de sécurité était ainsi beaucoup plus distribuée que le ne fut la lutte contre les vols. C’est pourquoi il n’est pas possible de ne suivre qu’un seul service (comme nous l’avons fait pour la Surveillance Générale). Pour saisir la problématisation de la sécurité ferroviaire, il faut regarder un ensemble de métiers plus vaste (les conducteurs, les mainteneurs des installations, les régulateurs, les aiguilleurs, etc.).
On ne prétend pas ici retracer exhaustivement l’histoire de toutes ces professions. Il s’agit plutôt de montrer comment le problème de la sécurité s’est institutionnalisé dans l’organisation même du travail, au travers d’une succession de « crises de contrôle » – alors que la sûreté est demeurée la chasse gardée d’une profession cheminote particulière, et surtout celle des forces de police officielle. Nous empruntons le concept de « crise de contrôle » à James R. Beniger, historien et sociologue de l’information. Dans son histoire socio-technique de la société d’information, il montre comment cette dernière est une conséquence de la révolution industrielle et plus précisément des réponses apportées aux bouleversements engendrés par la révolution industrielle dans la production, la distribution (transport) et la consommation de biens (Beniger, 1986). Ces bouleversements constituent ce qu’il appelle une « crise de contrôle », soit « une période dans laquelle les innovations du traitement de l’information et de la communication sont à la traine par rapport à celles concernant l’énergie et ses applications à la production et au transport » (Beniger, 1986, p. vii)120. Au-delà de l’intérêt du concept pour l’histoire sociotechnique de la modernité que propose Beniger, il nous semble que chaque crise de contrôle (suivi d’une révolution du contrôle) peut s’interpréter comme une nouvelle vague de problématisation d’un enjeu particulier. À chaque crise de contrôle, c’est une nouvelle définition d’un problème qui apparaît, car la révolution du contrôle qui règle la crise s’accompagne en général d’une recomposition des groupes professionnels propriétaires du problème.
Son concept de crise de contrôle nous intéresse d’autant plus que l’un des cas d’application est le monde des transports. L’introduction de la vapeur comme force motrice dans le transport ferroviaire et maritime a conduit à une augmentation de la vitesse de transport des hommes et des marchandises sans précédent. C’est ainsi la première fois qu’il est nécessaire de contrôler une production (la vapeur étant également utilisée dans ce secteur) et une distribution de cette production à des vitesses qui dépassent la force éolienne, hydraulique ou animale (Beniger, 1986, p. 208 et suiv.). Rappelons en effet que jusque-là, le cheval constituait la principale force motrice que ce soit sur routes, sur canaux ou sur les chemins de fer. Cette augmentation rapide, en volume et en vitesse, des flux de matières et de marchandises provoqua une crise de contrôle, dans la mesure où les capacités informationnelles et communicationnelles n’étaient pas suffisantes pour les maîtriser. D’où la multiplication des accidents, pannes et dysfonctionnements d’exploitation constatés au début du chemin de fer.
L’histoire technique de Beniger apparaît ainsi en accord avec les histoires sociales, économiques et organisationnelles des chemins de fer abordées dans le chapitre 1. Pour endiguer cette crise, les ingénieurs et managers durent développer un faisceau d’innovations dans le traitement de l’information et de la communication – innovations qui mènent donc à une « révolution du contrôle ». Ces innovations constituent également des moyens de surveillance et de contrôle afin de maîtriser le risque ferroviaire. Beniger analyse alors plusieurs crises affectant le milieu ferroviaire : dans la sécurité stricto sensu, dans le rendement et dans la maintenance. Selon nous, il serait possible d’analyser l’électrification et la grande vitesse comme de nouvelles crises de contrôle. Bien sûr, les crises successives ne sont pas de la même intensité. L’accidentologie ferroviaire permettrait de défendre l’idée que la sécurité est quelque chose de maîtrisé et que l’on n’assistera plus à des crises de contrôle. Nous défendrons plutôt l’argument que la succession des crises de contrôle a permis l’institutionnalisation de la sécurité au sein de l’industrie ferroviaire. La sécurité est un problème d’entreprise, rarement remis en cause dans l’histoire du secteur ferroviaire (encadré 5), les évolutions ou conflits à son sujet portant sur les modalités qui permettent de l’assurer (1).