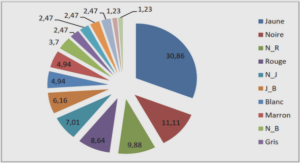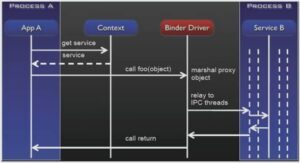Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Le nécessaire impact des représentations et inexpérience de l’observateur
Avec du recul, certains éléments de notre pratique ont pu avoir un effet contreproductif vis-à-vis du nouveau comportement de l’élève. Des pratiques qu’il faudrait certainement considérer au regard de nos représentations le concernant.
Avant notre prise de poste, nous avions naturellement recueilli les témoignages de nos collègues. Les récits de ses excès de colère, la violence et l’incontrôle dont il pouvait faire preuve10 et sa propension à s’enfuir subitement de l’espace de classe avaient nécessairement induit notre jugement à son égard. Durant les premiers jours, nous avons été bien plus attentifs à lui qu’à ses autres camarades. Nous avions également le réflexe de lui donner la parole à chaque fois qu’il la sollicitait ou presque, dans l’idée de le mettre en confiance ; qu’il se sente positivement considéré par l’adulte. Quand nous passions dans les rangs, notre attention s’appesantissait naturellement sur lui. Et il est tout à fait probable qu’il ait été conscient de ce « traitement différencié ». S’il est impossible de connaître véritablement les effets qu’a pu avoir cette prise de conscience chez lui, le sentiment d’ostracisation est rarement bien vécu, d’autant plus chez l’enfant. D’ailleurs, sa situation dans l’espace de classe a certainement pu étayer son ressenti (nous y reviendrons). Ces représentations initiales à son sujet n’ont-elles pas, d’emblée, faussé le relationnel que nous aurions pu construire avec lui ?
Le manque d’expérience des deux professeurs stagiaires a certainement eu un rôle important dans cette première approche. Déjà, par le crédit total que nous avons pu accorder aux avis des collègues, que nous n’avons à aucun moment questionné. Nous avons totalement fondé notre approche de l’élève à partir de ces témoignages, sans se laisser l’occasion de construire objectivement notre propre image. Là où Egron et Sarazin mettaient justement en garde : « il y a lieu d’être vigilant quant à ce regard [celui porté par nos collègues et prédécesseurs], rarement positif, qui enferme [l’élève] dans un rôle dont il aura du mal à sortir. »11
Ce manque d’expérience a également pu nous porter préjudice lors de nos observations. Nous n’avions ni grille d’analyse, ni point de comparaison. Alors que les mêmes chercheurs avancent l’importance d’ « établir un document d’observation » basé sur des entrées clairement définies12, afin de « mettre à distance les comportements observés ».
Malgré son manque d’appui scientifique, notre observation aura confirmé l’idée d’un profil spécifique d’élève, que nous pouvions déjà qualifier, considérant les traits saillants de cette même observation, d’« élève à besoins particuliers », dans la mesure où il nécessitait de notre part une pratique en tout point différenciée. La différenciation ayant ici pour but de placer l’élève dans des dispositions permettant sa réussite, tant dans les apprentissages que dans son positionnement d’élève au sein d’un groupe de pairs. Sauf que, là encore, nous nous sommes confrontés aux limites de notre inexpérience. Conscients de cet état de fait, nous avons été confrontés à un lourd questionnement : les observations que nous avions menées depuis le début de l’année étaient-elles suffisamment fiables pour que nous puissions adapter notre pratique d’après elles? Ou bien, partant du principe contraire, était-il préférable de vouer notre confiance aux observations menées au préalable par nos collègues ?
Premiers éléments de différenciation a. Anticipation versus adaptation
C’est cette balance entre adaptation (aux situations vécues) et anticipation (face à celles déjà connues) qui a conditionné la différenciation que nous avons mis en place au profit de cet élève dans les premiers temps. Et si les deux démarches ne sont pas incompatibles dans les faits – bien au contraire !, l’autre problématique qui s’est posée à nous a été de savoir quelle part accorder à l’une et à l’autre. Quoi qu’il en soit, l’anticipation semblait bien être un corolaire à la réussite de cette inclusion, comme le soulignent Krotenberg et Lambert13.
Finalement, une scission s’est spontanément mise en place. Nos « pratiques adaptatives » se sont principalement exprimées lorsque les problématiques de l’élève étaient liées à sa posture dans le travail ; nos « pratiques anticipatives » lorsque ses problématiques étaient liées à sa posture « générale », comportementale. Par exemple, s’il était soumis aux mêmes exigences que ses camarades concernant le travail à fournir en classe, nous nous sommes montrés beaucoup moins exigeant avec lui concernant la précision de sa graphie et le soin qu’il y portait, supposant que cela nécessitait pour lui un effort difficilement surmontable et que la crispation de ses membres y faisait barrage.
En lien à ces mêmes tensions, certaines autorisations tacites lui étaient accordées. Lorsque certaines modalités l’imposaient, nous pouvions demander aux élèves de stopper toute manipulation et de ne rien garder dans les mains. Mais puisque ces manipulations, quasi constantes, semblaient lui permettre « d’extérioriser » certaines tensions, elles lui étaient exceptionnellement permises. De la même manière, nous ne nous opposions pas au fait qu’il dessine durant une activité – tant qu’il s’agissait d’un support adapté – sans autorisation préalable. Ce réflexe survenait généralement sur les temps oraux longs, souvent difficiles à appréhender pour lui et générateurs d’excitation et de débordements.
Ces temps oraux étaient justement parmi les instants qui appelaient spécialement à l’anticipation. Pour prévenir tout « glissement » hors du cadre, nous avions développé le réflexe de venir nous positionner près de lui. À ces occasions (ou mêmes à d’autres), lorsque nous sentions que l’excitation le gagnait tout de même et pouvait potentiellement déboucher sur une sortie du cadre, nous lui proposions de prendre quelques minutes pour aller extérioriser dans la cour et revenir lorsqu’il serait calmé. Une pratique préconisée par Duquette et Légault pour « désamorcer une situation potentiellement explosive. »14
De la même manière, lorsqu’il entrait très excité après la pause méridienne, par crainte qu’il ne se laisse déborder malgré la mise au travail, nous lui proposions de prendre quelques minutes supplémentaires dans la cour (désertée) pour se calmer.
La démarche anticipative la plus notoire que nous ayons engagée reste d’avoir sciemment fait évoluer le plan de classe, avant même la fin de la première semaine de classe15, dans l’idée première de repositionner l’élève en question (la position de l’élève – par rapport au tableau, à l’adulte et à ses camarades – étant un questionnement fondamental selon Egron et Sarazin, pouvant « s’envisager dans une démarche évolutive »)16. Initialement en fond de classe, proche de la porte et sans voisin direct (son agitation corporelle pouvant être hautement parasitante), ma collègue a jugé préférable de l’éloigner de la porte pour prévenir ses éventuelles fuites. Une discussion s’est engagée : l’un favorisant l’anticipation, l’autre prônant au contraire la continuité, face à un comportement jusque-là principalement positif de l’élève. Je percevais pour ma part cet isolement relatif comme un moyen de limiter les sources de perturbation pour l’élève. Le changement de place fut finalement acté et il sembla bien que le fait d’être maintenant entouré de camarades17 ait généré un regain d’excitation chez lui difficilement contrôlable. Le dilemme entre adaptation et anticipation n’en fut donc que renforcé. Et la pertinence de baser sa pratique sur des faits ne relevant pas de cette année scolaire n’en fut que plus questionnée. D’autant que ces aménagements soulevaient une autre question, non moins facile à appréhender : celle d’une éventuelle stigmatisation de l’élève.
Éviter la stigmatisation
Pour avoir jusque-là mené leur scolarité à son contact, les vingt-trois élèves de la classe étaient conscients de la situation de leur camarade. Et malgré la violence et la répétition de ses états de crise l’année précédente, il était parfaitement intégré au groupe-classe : très apprécié même. Notre premier travail a donc été de faire comprendre au groupe que cette différence, qu’il acceptait naturellement chez leur camarade, devrait donner lieu cette année à des traitements différenciés ; qu’ils devaient également comprendre et accepter. D’autant qu’au-delà de ces simples aspects, ce travail, d’après les auteurs de Scolarité et troubles du comportement. Des solutions pour enseigner !, permettait « de prendre de la distance au regard des événements rencontrés au quotidien et d’élaborer des règles de vie communes fondées sur le principe de l’acceptation de la différence. »18 Et d’en tirer donc des bénéfices plus généraux et moins stigmatisant pour un seul élève.
C’était là toute la difficulté : que ces dispositifs ne soient perçus comme stigmatisants par aucun élève. Une volonté qui rendit d’autant plus compliquée toute démarche anticipative. N’y a-t-il pas quelque chose d’inégal et d’explicite dans le fait que l’attention, les positionnements de l’enseignant soient visiblement et presque systématiquement orientés vers vous alors que vous êtes parfaitement dans votre posture d’élève ? Comment appréhender, pour l’élève, le poids de l’auto-détermination ? Alors que, précisément, « leur expérience de rejets et/ou de renvois négatifs sur leurs comportements ont altéré à la fois l’estime et la confiance qu’ils placent en eux », rappellent Egron et Sarazin19. Quant à l’explicitation de sa différence, il fallait veiller à l’exprimer à l’échelle du groupe et non celle de l’individu. Chacun étant différent et, malgré cela, chacun faisant partie intégrante de la classe. Pour autant, il nous était impossible de ne pas pointer les comportements déviants de leur camarade lorsqu’ils portaient atteinte au groupe ; ses actes de violences notamment. Cela nécessitait des temps de discussion et de sensibilisation, afin de renforcer son appartenance au groupe. Mais l’effet inverse aurait également pu être à craindre, sans les précautions nécessaires et, quoi que nous puissions en dire, les dispositions de ses camarades dans leur réception de la situation. Il fallait donc nous montrer subtils et discrets dans nos attentions différenciées et construire, pour le bien-fondé de notre pratique, une frontière nette entre différenciation et iniquité. Une approche différenciée qui s’est révélée particulièrement indispensable lorsque la présence enseignante en classe fut réduite à un seul professeur.
De la co-responsabilité à la responsabilité unique : premiers sentiments d’impuissance
Sur les derniers temps, l’enseignant « ressource » avait pris l’habitude de rester au côté de l’élève pour soulager son collègue. Il fallut repenser notre approche.
Je fus le premier à assumer cette première période de responsabilité unique. J’eus rapidement le sentiment d’être confronté à une double mission : mener et cadrer la classe d’une part ; mener et cadrer l’élève, individuellement, d’autre part. Un sentiment schizophrénique et largement énergivore. Le contact physique semblait en mesure de l’apaiser, mais il était impossible en continu, puisque ma disponibilité était à partager entre tous. Dès lors, le sentiment de se sentir dépassé, incapable de gérer la situation devint rapidement vertigineux.
À plus forte raison en situation de crise. La première à laquelle nous avions assistée avait été gérée à deux et la question ne s’était pas posée : j’avais évacué l’élève de l’espace de classe et avais accompagné son retour au calme pendant que ma collègue gardait la main sur le groupe. Après cela, il a fallu appréhender ces situations seul, sans qu’elles n’aient été
anticipées. Lorsque l’élève « débordait », le premier réflexe était de le faire sortir de la classe : à la fois pour qu’il prenne conscience que ce type de comportement ne pouvait y être accueilli, mais également pour le préserver du regard de ses camarades (qu’il peut vivre comme une « menace », d’après certains auteurs20) et de les préserver eux-mêmes d’une potentielle explosion violente. J’envoyais un élève prévenir le directeur, afin qu’il puisse assurer la surveillance hors-classe. Mais l’élève en crise partait immédiatement en chasse de son camarade pour nuire à sa mission. Il fallait alors le contenir physiquement ; au moins lui faire opposition. D’autres fois, lui courir après à travers la cour pour l’intercepter. Pendant ce temps, la classe était livrée à elle-même. Le « bon » réflexe aurait été de solliciter ma collègue de la classe voisine. Mais deux éléments y faisaient barrage : la soudaineté et la violence de certaines crises me poussaient à parer au plus pressé. D’autre part, ma retenue, en tant que débutant, à « déranger » une collègue, qui plus est en charge d’élèves de cours préparatoire (donc peu autonomes) et de témoigner ainsi de mon incapacité à gérer le groupe.
D’autres fois, les crises étaient d’une telle violence qu’une contrainte physique continue était nécessaire pour éviter que l’élève ne se blesse ou ne blesse un camarade. La classe était livrée à elle-même jusqu’à l’arrivée du directeur. Un directeur que ses obligations amenaient parfois à quitter l’établissement. Seul – si le débordement n’avait pas encore abouti en « crise », j’optais pour une position mitoyenne : sur le seuil de la porte, je tentais de faire avancer la séance tout en gardant un œil sur l’élève dans la cour. Un élève qui escaladait régulièrement les rebords de fenêtres, hauts de deux mètres, pour maintenir son lien à la classe, se mettant alors en danger réel. Il fallait alors intervenir, au détriment de l’activité de classe.
Plus largement, la propension de cet élève à perturber les temps d’apprentissage amène à se questionner sur leur bien-fondé. N’est-ce pas dû à un défaut d’organisation ? Des modalités plus adaptées auraient-elles pu éviter cette situation ? Le contenu didactique proposé manque-t-il d’intérêt ? Le professionnel se questionne sur sa capacité de gestion de classe, mais aussi sur ses pratiques pédagogiques. Il est alors difficile de se départir de son rôle, au détriment de sa personne. Là où une mise à distance serait nécessaire, voire salvatrice, d’après certains21.
Un criant manque d’anticipation est à pointer, assurément. À l’échelle de la classe, des travaux d’autonomie auraient dû être pensés et fournis aux élèves. À l’échelle de l’école, un protocole de crise aurait dû être élaboré (nous y reviendrons).
CONSTRUIRE UN CADRE PROPICE
Quels que soient les manquements organisationnels initiaux quant à l’accueil de cet enfant, il a bien fallu « bricoler », au sein même de la classe, pour endiguer au mieux ses excès comportementaux et établir un cadre propice aux apprentissages. Comme le suggèrent Egron et Sarazin, fallait-il encore identifier les éléments « perçus comme angoissants chez le jeune » pour « les limiter, diminuant d’autant ses mécanismes de défense. »22
Les possibilités inhérentes à la classe a. Une régulation « physique »
Avant même de s’attaquer aux problèmes de fond, j’ai pensé essentiel et pressant d’essayer d’apporter de la sérénité à cet enfant. Nous avions remarqué que ses crises étaient rendues inévitables par l’état de surexcitation dans lequel il évoluait – dû à un sentiment permanent de menace, d’après Mark Lemessurier23. Il a fallu donc envisager une régulation physique.
La décision fut prise de le repositionner « en tête de bus », à une table isolée. L’enseignant étant amené à principalement évoluer dans cette zone, il était naturellement à portée de l’élève. Celui-ci se sentait donc soutenu en toute occasion : soit la stratégie « du contrôle par la proximité », théorisée par Duquette et Légault24. Dès que je le pouvais, je tentais d’apaiser l’élève par le contact : une main posée sur son bras, sa main, son épaule… Contrairement à certains camarades, un regard n’était pas suffisant à le rassurer. L’aider à se repositionner sur sa chaise était également l’occasion d’un contact apaisant.
Cette régulation passait également par des « sas de décompression » mis à sa disposition; la cour en premier lieu. Lorsque les tensions semblaient sur le point de déborder, l’élève pouvait sortir quelques minutes ; la classe jouxtant l’espace de cour. Un accord avait été établi et l’élève pouvait s’en saisir spontanément. Parfois, cela nécessitait une suggestion de l’adulte (saisie ou non). Dans le cas d’une excitation plus mesurée, des espaces avaient été aménagés en fond de classe : un banc, faisant face au tableau, et une chaise, plus isolée, tournée vers le mur du fond. Des espaces qu’il pouvait mobiliser sur les mêmes bases que la cour, sans se sentir « ni marginalisé ni sanctionné »25, puisqu’ils pouvaient également être saisis par tous. La superficie de la classe ne permettait pas d’espace-lecture, généralement fort propice (comme le soulignent Egron et Sarazin26). Tout comme les temps d’E.P.S.. Ils permettaient de démontrer à l’élève que ses tensions pouvaient être relâchées de manière constructive et plaisante ; dont il pourrait tirer profit. Il fallait expliciter le fait que cette excitation n’était pas le problème: c’est la manière dont il l’exprimait. Et il était parfaitement possible de l’exprimer « sainement », plutôt que de trop vouloir la refreiner : au risque qu’elle n’explose.
Pour contrevenir à l’excitation générée par la pause méridienne, nous avons décidé de mettre en place un « Silence, je lis ! »27. L’excitation étant collégiale, il profiterait à tous. Mais particulièrement à notre élève. Si ses camarades arrivaient sans trop de problème à se canaliser, c’était presque impossible pour lui ; d’autant plus après une dispute. Comme l’anticipaient Egron et Sarazin, il lui était alors impossible de « se mettre émotionnellement en accord avec les attentes du lieu et de l’activité. »28 L’agitation augmentait au cours de l’après-midi et il terminait rarement ses journées avec nous. Puisque, même là, l’élève avait le plus grand mal à se recentrer sur lui-même, nous avons différencié le dispositif en lui laissant l’opportunité de mener cette activité sur un banc à l’extérieur de la classe, tout près de la porte. Il s’est spontanément emparé de cette proposition : cette manière de s’extraire du collectif lui faisait généralement le plus grand bien. Mesurant les bienfaits de ce rituel, il fut étendu aux retours des récréations d’après-midi. Il s’agissait cette fois d’un temps de lecture offerte29. La même différenciation était appliquée : s’il préférait s’isoler, nous lui fournissions un exemplaire de l’œuvre, en précisant la limite à ne pas dépasser. Cela renforçait par la même occasion le sentiment de connivence et de confiance mutuelle.
Le « contrôle par la proximité » passait également par le regard. Lorsque l’élève voulait intervenir à l’oral, la gestion de la frustration (due au fait qu’un camarade soit interrogé avant lui) était très délicate et pouvait entrainer des excès de colère. Il pouvait refuser l’idée que la réponse soit apportée par un camarade alors qu’il était en mesure de la fournir. Ou bien vivait-il cet épisode comme un manque de considération : « S’il ne m’interroge pas, c’est qu’il ne me regarde pas. S’il ne me regarde pas, c’est qu’il ne me considère pas ». Le fait de le lui adresser un regard entendu (accompagné d’un hochement de tête) faisait passer un tout autre message : « Je t’ai vu, je sais que tu sais, mais tout le monde doit pouvoir s’exprimer. » Quitte à le renvoyer aux règles de classe s’il prenait la parole sans y avoir été autorisé.
Le grand défi restait les temps de crise. Il fallait à la fois empêcher qu’il ne blesse quiconque (lui-même ou un camarade) et l’aider à revenir au calme, par des gestes rassurants. D’autant que, à en croire certains spécialistes, cette quête de proximité avec l’adulte serait l’un des motifs psychologiques à ce genre de crise. « Dans ces moments de vive tension, le message envoyé par l’enfant est le suivant : « Montre-moi que tu m’aimes, que tu t’intéresses à moi. Je ne sais pas le manifester autrement que comme ça, en provoquant quelque chose. » »30 « Les crises vont donc survenir, car elles sont un moyen par lequel l’enfant ou l’ado cherche à se rassurer quant à l’intérêt que lui porte l’adulte.»31
Cette construction relationnelle étant certainement la principale mission à mener auprès de lui.
Établir une relation de confiance
D’après certains chercheurs spécialisés, ces temps de crise sont à la fois un moyen pour l’enfant de créer une relation privilégiée avec l’adulte mais également un moyen d’éprouver cette relation. Les enfants répondant à ce profil « peuvent mettre à mal inconsciemment le lien avec l’enseignant, afin de vérifier la solidité de celui-ci : « Bien que je t’attaque, tu ne me rejettes pas, je peux toujours compter sur toi. » »32 Malgré la violence parfois extrême de ses crises, l’enfant ne rejetait jamais le contact physique (voulu apaisant par l’adulte) : au contraire, il semblait l’accueillir positivement, diminuant presque automatiquement l’amplitude et la brusquerie de ses gestes.
En toute occasion, il fallut se montrer soutenant à son égard. Le rassurer, premièrement, sur ses capacités ; réelles qui plus est, pertinent et pétri de connaissances qu’il était. Seulement, il ne semblait pas retenir les situations de réussite : il ne se focalisait que sur les situations de difficulté, voire d’échec. Un important travail sur le statut de l’erreur a dû être mené. Une crainte quasi phobique hautement nuisible pour l’élève et ses apprentissages. Face à elle, il avait développé deux types de réflexes. Le plus souvent, il recourait à des stratégies d’évitement, telles qu’ont pu les répertorier les auteurs précédemment cités, « en bravant, provoquant, défiant ou s’isolant. Pour ne pas courir le risque de l’échec, l’élève peut, par exemple, choisir de ne pas entrer dans l’activité. » Seulement, rattacher ces réactions à une peur de l’échec n’a pas été évident. Conscient de ses capacités, je ne m’imaginais pas que l’enfant puisse à ce point douter de lui-même (je mettais alors ça sur le compte d’un manque d’intérêt, d’un « caprice » ou d’une volonté de défiance pure). En début d’activité, j’allais systématiquement vers lui pour le rassurer à travers un échange discret (« Je sais que tu en es capable. ») ; en le renvoyant par exemple à ses réussites antérieures (« C’est quelque chose sur lequel nous avons déjà travaillé et tu avais très bien réussi, rappelle-toi. ») D’autant plus lorsqu’il s’agissait de tâches écrites. La recherche nous aura aidé à comprendre pourquoi. D’après Egron et Sarazin, c’est une réaction caractéristique que de montrer « des difficultés à laisser une trace émanant de soi, pouvant aller jusqu’au refus d’écrire. Par ce refus, il ne montre pas à voir de lui quelque chose qui pourrait être négatif. »33
Dépassé ce stade du refus pur et simple, l’enfant était souvent confronté à un autre type de difficulté : celui de faire des choix (entre deux réponses potentielles, par exemple). Et ce, « car il y voit le renoncement à une partie plutôt que l’accession à un possible. De même, lui demander d’exprimer un désir peut être compliqué », argumentent les mêmes34.
Les problématiques liées à l’oral étaient autres. S’il était parfois confronté aux mêmes freins, il s’y engageait tout de même plus facilement. Car l’oral ne laisse pas de trace ? C’est ce que nous pourrions déduire des analyses invoquées jusque-là. Mais les situations « d’échec » étaient alors plus frontales. En cas de « réponse à côté », il fallait être très attentif au message et éviter un « non » franc. Mais même en soulignant la pertinence du raisonnement, l’approximation de sa « bonne réponse » (« presque ; pas loin »), le sentiment d’échec prenait le dessus. Il exprimait sa frustration par un jet d’objet (la première chose qui lui tombait sous la main) ou en repoussant violemment sa table. Il se renfermait, la tête dans les bras, parfois en pleurs. Je ne le reprenais jamais « à chaud » sur sa réaction. Mais pour lui signifier ma considération vis-à-vis de la situation, je sollicitais le groupe pour réaffirmer le fondamental droit à l’erreur (« A-t-on le droit de se tromper ? Est-ce que c’est grave ? Pourquoi est-ce même important de se tromper parfois ? »). L’erreur est une des voies d’accès à l’apprentissage mais il était difficile pour cet élève de le concevoir. Quelques minutes après sa réaction, je ne manquais pas de revenir discrètement vers lui, d’avoir un geste empathique et de verbaliser autour de cette idée. Je le renvoyais à tout ce qu’il savait déjà (en m’appuyant sur des temps de classe concrets) et au fait que personne ne pouvait tout savoir (« Le maître aussi se trompe parfois. Tout le monde se trompe. »). Que c’est en se trompant qu’on apprend. Et de réfuter fermement l’idée qu’il avançait parfois : « Je suis bête. »
Pour combler ce manque criant de confiance en lui, je m’évertuais à souligner chacun de ses « bons » comportements et ses interventions judicieuses (comme le préconisent Duquette et Légault35). Sauf que ce manque de confiance n’avait pas qu’à voir avec l’élève, mais avec l’enfant. Certains observateurs mettent en garde contre cette séparation « entre le cognitif et l’affectif, entre l’élève et l’enfant, comme si celui-ci pouvait laisser « à la porte ses conflits, ses angoisses et ses difficultés »36. »37 « La constitution du sujet extrascolaire en élève passe par la reconstitution, au moins provisoire, de son identité d’enfant. »38 Il fallait veiller à étendre le principe de bienveillance – prôné par Egron et Sarazin39 – à l’enfant. Qu’il se sente compris et soutenu dans sa personne et pas seulement dans son rôle d’élève. C’est pour l’adule une manière d’affirmer qu’il ne se montre pas seulement soutenant par mission, mais parce qu’il s’intéresse à lui, au-delà du simple cadre scolaire. Cela a été favorisé par des échanges « sur les conditions de vie du jeune dans l’établissement scolaire et en dehors », le fait d’interroger et « d’entendre ses ressentis »40. Chaque matin, je l’interrogeais sur son état de forme, sur ses activités de la veille ; intéressé et connivent. Les temps post-crise étaient généralement très riches en la matière. Après être revenu au calme, aidé par mes interrogations, il se livrait sans retenue (ce qui peut nourrir la théorie de Krotenberg et Lambert : voir page 16). De même, les temps de sorties scolaires permettaient de développer un relationnel plus « intime ». J’ai souvent explicité auprès de lui qu’il était un garçon intéressant, pétri de qualités (en référant à des arguments concrets): ce dont il doutait lui-même. Cette relation de confiance passait par le soutien (moral et émotionnel) que je pouvais lui apporter et par l’image positive que je devais lui renvoyer de lui-même, afin de l’aider « à développer une bonne image [de lui-même]. »41
Des dispositifs (trop) différenciés ?
Les besoins spécifiques de cet élève ne pouvaient a priori pas se passer d’une relation privilégiée avec l’adulte. Un soutien qui se matérialisait aussi à travers des aménagements pédagogiques ; certains ont déjà été évoqués. La différenciation pédagogique42 est l’un des principes fondamentaux de l’école inclusive43 et dans le cas présent, elle semblait indispensable. Les modalités de cette différenciation ont également été très questionnantes pour le professionnel. Les « sas de décompression » offerts à l’élève étaient-ils toujours mobilisés à raison ? Ce droit avait été discuté avec lui et il en connaissait les modalités.
« Lorsque l’excitation était trop importante » était l’un des facteurs. Rapidement, j’eus l’impression qu’il « simulait » ou qu’il exagérait son état pour pouvoir échapper aux temps de classe. De la même manière, lorsqu’il perturbait notoirement la classe et ne montrait aucune volonté de faire autrement, il devait passer un certain temps auprès du directeur, jusqu’à retrouver de bonnes dispositions. Il acceptait très mal cette mesure et entrait en crise. Mais après quelques semaines, il n’y montrait presque plus jamais de réticence et pouvait s’y rendre spontanément (escorté d’un camarade) et sans accroc. Le directeur et moi avons alors partagé la même réflexion : l’élève n’est-il pas conscient du traitement spécifique dont il jouit et n’en joue-t-il pas ?
Nous nous sommes également questionnés sur un potentiel changement d’attitude. Les situations conflictuelles étaient jusque-là dues à son incapacité à répondre aux attentes de l’école. Il semblait « subir » sa situation : les troubles du comportement – supposés, nous le rappelons – étant bien d’ordre pathologique. À partir de la deuxième période44, il se montrait régulièrement provoquant : ses adresses déviantes ne semblaient plus incontrôlées mais conscientes, souvent accompagnées d’un sourire. Comme s’il cherchait sciemment à faire exploser le cadre. Si la quête d’une relation privilégiée à l’adulte était bel et bien son moteur inconscient, ce nouveau comportement s’explique : ses débordements étant des moments où toute l’attention de l’adulte était tournée vers lui. Cela vaut également pour les temps qu’il passait avec le directeur. De la même manière, ses prises de parole non-autorisées étaient tellement régulières qu’elles n’étaient pas toujours verbalement reprises (je privilégiais souvent une pause dans le discours et un regard appuyé. Un contre-parti nécessaire, à en croire les auteurs de Scolarité et troubles du comportement. Des solutions pour enseigner !45). Il put en tirer un sentiment de relative impunité. Comme en ce qui concerne ses déplacements non-autorisés. Ces dispositifs, pensés pour l’aider à retrouver une certaine norme scolaire, ne produisaient-ils pas ici des contre-effets, en le confortant dans une différence admise et acceptée ? Or, nous le rappellent Krotenberg et Lambert, « chacun doit bien le comprendre […] : il ne s’agit pas d’instaurer un régime de faveurs à destination d’un élève, mais bien de penser en terme d’adaptations pour permettre à un enfant de surmonter des difficultés spécifiques. […] Ce dernier doit percevoir l’attitude de l’adulte non pas comme une faiblesse, mais comme une attitude bienveillante, réfléchie et maîtrisée. »46
Se pose la question de la réception de ses camarades vis-à-vis de cette différenciation. Malgré la verbalisation régulière de notre démarche pédagogique concernant leur camarade47, certains éléments ont pu s’engouffrer dans ses « passe-droits » : en cherchant le dialogue avec lui ou en y répondant sans retenue, alors que les modalités ne s’y prêtaient pas. Des parents nous ont fait remonter une recrudescence de comportements insolents à la maison, « normalement » non-coutumiers de leur enfant. À l’inverse, certains élèves ont pu se sentir lésés vis-à-vis de ce rapport omnipotent entre l’élève concerné et l’adulte. Il était alors difficile de dégager du temps pour un rapport individuel avec chacun, tant leur camarade mobilisait l’attention et les efforts. Là encore, la tentative d’homogénéisation du groupe aurait été contre-productive.
Le fruit du travail entrepris avec l’enfant s’est manifesté par un contrôle accru de lui-même. Les crises sont devenues de plus en plus rares. Mais les comportements déviants n’ont pas diminués : au contraire, presque. Comment articuler attentes différenciées et attentes rigoureuses ? Comment interpréter correctement les changements de posture de l’élève ? Il a fallu commencer à avouer que ces problématiques étaient trop complexes à résoudre seuls.
Mobiliser les aides extérieures
Faut-il le rappeler : dans un établissement scolaire, l’instruction et la sécurité des enfants sont la responsabilité de tous. Puisqu’il est élève d’une école et non d’une classe, le travail visant à « normaliser » ses conduites est à entreprendre à tous les niveaux. Certains auteurs nous le rappellent : « l’établissement scolaire peut lui aussi, en tant que structure, participer à apaiser le climat » et à offrir à l’enfant le « cadre contenant » dont il a besoin48.
Savoir solliciter l’aide des autres membres de l’équipe éducative
Cela suppose un travail collaboratif entre tous les membres de l’équipe éducative – c’est un point sur lequel s’accordent tous les chercheurs que nous avons pu consulter. Seulement, comme le notent Lambert et Krotenberg, « dans notre système, s’il est beaucoup dans le discours, le travail en équipe est loin d’être la règle. Trop souvent encore l’enseignant se considère comme seul responsable de sa classe et s’intéresse assez peu à ce qui se passe dans la classe voisine… »49 Cet état de fait se vérifie dans l’établissement concerné. En début d’année, nos collègues nous avaient briefés sur cet élève : à chacun son anecdote, mais aucune recommandation à son sujet. Durant l’année, ils ont régulièrement fait preuve de sollicitude, en nous questionnant sur ses dispositions du moment et sur notre état moral personnel (ils ont été, à cet égard, d’un soulagement bénéfique). Mais je n’ai pas le souvenir que l’un d’eux se soit proposé d’accueillir ponctuellement l’élève en question pour nous soulager quelque peu. Tôt dans l’année, la situation avait été évoquée en conseil des maîtres : l’idée d’un planning d’accueil de l’élève avait été évoquée en cas de débordement. Cela n’avait pas dépassé le stade des discussions. Lorsqu’un tel protocole fut finalement mis en place (voir « Mobiliser les dispositifs spécifiques : le recours à R’École »), certains se sont opposés à y prendre part – son professeur de l’année précédente notamment.
Ponctuellement, nous avons reçu l’appui de notre collègue Professeur de la Ville de Paris. Menant ses cours de sport dans la cour, il était régulièrement témoin des débordements de l’enfant et de ses « sorties de classe ». Il me proposait alors de garder un œil sur lui, voire de l’intégrer à sa séance – l’élève ayant une claire appétence pour le sport. Il m’aida quelques fois à l’escorter chez le directeur – ce dernier s’agrippant à tout ce qu’il pouvait pour y échapper ; abandonnant lui-même temporairement ses élèves.
Table des matières
I. INTRODUCTION
II. OBSERVER POUR MIEUX S’ADAPTER
1) La posture de l’observateur
a. L’observation « passive »
2) Premiers éléments de différenciation
a. Anticipation versus adaptation
III. CONSTRUIRE UN CADRE PROPICE
1) Les possibilités inhérentes à la classe
a. Une régulation « physique »
2) Mobiliser les aides extérieures
a. Savoir solliciter l’aide des autres membres de l’équipe éducative
IV. L’INÉVITABLE BALANCE ENTRE MAINTIEN ET RENOUVELLEMENT DES DISPOSITIFS
1) Une réception peu évidente de la part de l’élève
a. Perception et acceptation de ses besoin particuliers
2) Tenir le cap en acceptant les « détours »
a. La difficulté à maintenir l’engagement de tous
V. CONCLUSION
VI. RÉFÉRENCES
● Bibliographie
● Webographie
VII. ANNEXES
● Annexe 1
● Annexe 2
● Annexe 3
● Annexe 4