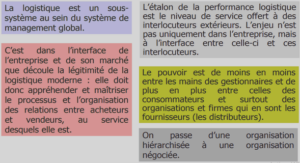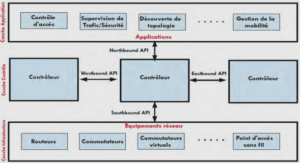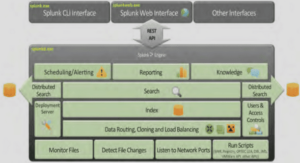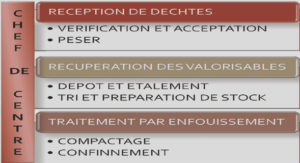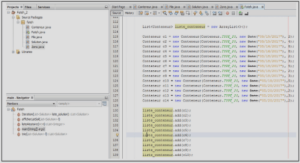Mémoires et contre-mémoires : élargissement de la notion de victime
Les processus d’articulation et de transformation du cadre interprétatif de la guerre civile guatémaltèque apparaissent timidement dans le discours de mi-parcours de la CEH. Pourtant, ils sont incontournables dans les deux rapports finaux des deux commissions de vérité guatémaltèques ; ce n’est qu’à la lumière des éléments qu’elles avaient recueillis que les commissions pouvaient produire une contre-mémoire crédible et performative.
Dans leurs rapports respectifs, les commissions sont principalement intervenues sur trois traits caractérisant les discours autour des victimes qui avaient été élaborés par les différents régimes autoritaires : la déshumanisation, la criminalisation et la militarisation des victimes. Les commissions ont ainsi rappelé, qu’au-delà de leur caractère victimaire, les personnes affectées par le conflit étaient avant tout des êtres humains. Elles ont procédé, de la sorte, à une modification du cadre discréditant les victimes et justifiant leur condition victimaire façonnée par les différents régimes du passé :
Par le biais de discours et sermons, et à travers la sélection des victimes, se transmettait le message que celui qui n’appuyait pas l’Armée était un criminel qui méritait la pire des morts, sans avoir le droit à un enterrement décent. La criminalisation et la déshumanisation des victimes faisaient partie des opérations. Le fait de ne pas voir le droit d’enterrer les victimes augmentait encore plus la terreur, car dans plusieurs cas les cadavres demeuraient à vue et la population a eu à observer comment les animaux les dévoraient509.
Ce faisant, les commissions ont pu conférer un nouveau sens à l’expérience des victimes et relégitimiser l’existence même de ces personnes. Aussi, l’un des chevaux de bataille des commissions fut de démontrer, à l’aide des faits recueillis, que les victimes étaient innocentes et non combattantes, participant à consolider ce nouveau sens duquel le vécu victimaire était investi.
Cependant, l’innocence fut appréhendée de manière très large par les commissions de vérité, avant d’être érigée en thème central de leurs discours dans le but de favoriser le vivre ensemble.
Les modifications apportées aux schémas explicatifs du conflit ont également amené les commissions de vérité guatémaltèques à dénoncer la militarisation de la société civile. Partant d’une stratégie d’alignement, les commissions ont ici bifurqué et procédé à une transformation de cadre. En effet, le recadrage d’éléments autrefois connus, comme l’enrôlement forcé, mais désormais explicités et publicisés, permettait de former un nouveau récit qui correspondait davantage aux réalités de la guerre civile. La guerre ayant duré près de trente ans, certains individus ont été tour à tour victimes et agresseurs, notamment par leur participation aux PAC et par le recrutement effectué par les groupes insurgés tel que l’a remarqué la CEH510 :
Les commissaires militaires ainsi que les PAC ont mis en évidence le haut degré de militarisation subi par la société. La création d’une figure protégée par l’Armée, qui détenait des fonctions militaires, signifiait l’introduction de valeurs autoritaristes dans la population guatémaltèque et la participation armée d’un nombre considérable de personnes qui étaient initialement des civiles. Ainsi, le réalignement des éléments structurant la mémoire collective et les transformations de cadre qui en découlent ont entraîné des répercussions tant pour les victimes que pour les agresseurs. Puisque les victimes sont au cœur de cette étude, nous insisterons davantage dans les pages qui suivent sur les significations qu’a alors prises la notion de victime au regard de ces changements de discours ainsi que sur les implications pour les personnes détenant ce statut.
La construction d’une contre-mémoire entreprise par les commissions de vérité s’est heurtée au refus de certains acteurs gouvernementaux de reconnaître leur part de responsabilité (dans les disparitions forcées par exemple511), tout comme aux dissonances mémorielles très fortes qui existaient au sujet même de la délimitation de la catégorie de victimes. Afin de permettre l’instauration d’un vivre ensemble, les commissions ont adopté une définition très large des victimes, allant même jusqu’à inclure, aux côtés des victimes de la guerre, « les victimes de la paix ». Ce terme désigne ceux qui ont perdu des privilèges avec la pacification et le retour de la démocratie :
Ces derniers temps, des inconnus ont placé une grenade devant le Congrès par des inconnus et divers attentats se sont produits, y compris une attaque présumée à la résidence de Ríos Montt, lequel a accusé l’armée. Il se produit ainsi une espèce d’approche des victimes de la paix (finqueros512 menacés, militaires accusés, politiciens rejetés), dont le meilleur exemple est le cas du général Quilo Ayuso avec l’homme d’affaires Anzueto Vielman […]513.
Ce n’est pas ici l’endroit pour évaluer les retombées des commissions de vérité ou encore la persistance des autres récits mémoriels concurrents et cooccurrents. De même, nous limitant à la période d’existence des commissions de vérité, nous n’avons étudié ni la réception de ces modifications par les groupes de défenses de droits et de victimes ni le succès rencontré par la transformation de cadre au sein de la société guatémaltèque. Cependant, nous nous sommes attardés sur les manières par lesquelles la CEH et le REMHI ont dépassé les rapports dichotomiques surgissant habituellement lorsqu’il est fait allusion aux groupes de victimes et d’agresseurs. Ces commissions de vérité sont alors venues à la conclusion que toute une génération de Guatémaltèques — incluant les agresseurs — a été victimes du conflit. Ce dénouement, qui apparaissait au départ comme non intuitif, demeure cependant cohérent avec les grands principes sous-tendant la justice transitionnelle et par conséquent les commissions de vérité : la non-récurrence du conflit et la réconciliation.
Victimisation et juxtaposition des catégories discursives
Variations sur l’innocence
D’anciens ennemis d’État à victimes dignifiées
La mémoire collective est formée, selon le REMHI, de la multitude d’expériences distinctes de chacun des membres de la société guatémaltèque514. Cet amalgame de vécus individuels, désigné comme étant l’histoire par cette commission de vérité, est un récit qui ne doit pas sombrer dans l’oubli, au risque de voir le conflit se répéter. Une vision que partageait également l’équipe de la CEH : « [u]ne fois que nous reconnaissons les erreurs et les lacunes du passé, il devrait être possible de développer des stratégies pour ne pas répéter ce qui est arrivé.*515 » Certes, l’histoire telle que narrée par les commissions de vérité est centrée autour des victimes, mais son fil conducteur réside en un questionnement : comment le Guatemala a-t-il pu sombrer dans cette spirale de violence ? Car déjà, en 1976, la CEG avait conscience de ce qui devait constituer la trame du conflit durant encore une vingtaine d’années : à l’oppression répondait la subversion, et à la subversion répondait l’oppression, menant le pays à un bain de sang516.
Pour que le « plus jamais cela » espéré par un grand nombre d’activistes sociaux et de victimes puisse s’enraciner au Guatemala, les commissions de vérité ne se sont pas contentées de passer en revue le passé : elles ont rigoureusement analysé l’argumentaire des parties prenantes au conflit. À partir de cette investigation, ces institutions ont érigé une trame historique pouvant se dresser face aux visions idéologisées du passé qui avait été véhiculées tant par le gouvernement et l’armée, que par les groupes insurgés.
Notons que les parties belligérantes avaient adopté des cadres interprétatifs de leurs actions en cohérence avec le contexte de la guerre froide durant laquelle le conflit civil guatémaltèque a eu lieu. Ainsi, en faisant état de la stratégie des groupes de guérilleros, la CEH a mis en relief les prétentions idéologiques dont les groupes insurgés revêtaient leurs actions517. S’inspirant du marxisme et véhiculant une vision anti-impérialiste, les insurgés formant l’URGN annonçaient vouloir combattre, entre autres, la « […] domination économique et politique des riches nationaux ou étrangers les plus répressifs qui gouvernaient le Guatemala518 ». Ils se sont en outre érigés en tant que défenseurs des autochtones guatémaltèques qu’ils décrivaient comme « […] les victimes de l’exploitation économique et de l’oppression culturelle de la part de tous les secteurs de pouvoir du pays*519. » Or, si les commissions se sont attardées aux relations entre les groupes rebelles et les autochtones, c’est essentiellement l’histoire telle que l’avaient construite les acteurs au pouvoir, et à laquelle elles étaient toujours confrontées, qu’elles ont tenté de contrer.
« La démocratie ou le communiste520 », tel était le faux dilemme auquel les régimes autoritaires disaient avoir été confrontés et qui est exprimé en quelques mots par le général Mejía Víctores. Les ennemis du gouvernement et de l’armée étaient historiquement les membres des groupes révolutionnaires. Dépeints dans les discours politiques comme étant des agents agitateurs et des communistes, ces « ennemis publics » ne furent pas les seuls à figurer dans la catégorie « d’ennemis de la nation » construite par les régimes autoritaires successifs. Toutes les personnes qui contestaient leurs méthodes autoritaires ont été déclarées subversives et désignées comme ennemis à vaincre.
Plus qu’un discours populiste, cette rhétorique donnait sens à la stratégie militaire de l’armée et des groupes paramilitaires au cours de la guerre civile. Dans leurs rapports finaux respectifs, le REMHI et la CEH en donnent différents exemples, mais celui est cité ci-dessous, extrait du Manual de guerra contrasubversiva, est évocateur :
Les ennemis internes sont tous les individus, groupes ou organisations qui par le moyen d’actions illégales tentent de briser l’ordre établi, qui sont représentés par des éléments suivant les consignes du communisme international, incitant la guerre dite révolutionnaire et la subversion dans le pays. [Est aussi (sic)] considéré comme ennemi interne les individus, les groupes ou les organisations qui sans être communistes tentent de rompre avec l’ordre établi.*521
Les commissions de vérité du Guatemala ont également montré que la lutte contre le communisme avait été évoquée pour légitimer divers actes et décisions commandés par des décideurs politiques522. Ainsi, la CEH rapporte que d’être ou d’avoir été soupçonné d’être « subversif », « communiste », « guerrillero » étaient les justificatifs auxquels avaient recours les perprétrateurs lorsqu’ils exerçaient leurs violences : « [d]e retour à La Llorona, les femmes continuèrent à être victimes d’abus commis par les comisionados militares du village voisin d’El Bongo. Selon plusieurs sources, ces attaques, ils les frappaient en les accusant d’être des épouses de communistes et de guerrilleros.*523 »
Cette propagande, tout comme les actions posées en son nom, avait pour dessein de faciliter le contrôle de la population. En répandant la croyance que seuls les criminels étaient passibles d’être réprimés et que, par conséquent, les individus ayant subi de la violence l’avaient méritée, les acteurs du pouvoir réduisaient à néant toute forme de résistance populaire. Dans Guatemala : memoria del silencio, la CEH soulève que ce discours était en effet un obstacle à une quelconque opposition au pouvoir, puisqu’il créait une adéquation entre les acteurs sociaux et les criminels à punir :
Être militant d’un parti politique de l’opposition ou un dirigeant communautaire, syndical ou étudiant était synonyme de communiste ou de guérillero, deux termes qui étaient aussi synonymes de terroriste. La répétition constante de ce discours a provoqué non seulement la désertion des organisations sociales, mais aussi la perte de confiance populaire dans les leaders.*524
Il participait également à discréditer les personnes souffrant de la violence, dissolvant les liens communautaires dans les communautés autochtones, comme le note le REMHI dans son rapport : Cela a généré une confusion parmi les habitants, parce que c’étaient précisément des personnes respectées, valorisées et considérées comme des guides de la communauté, qui furent les premières à être assassinées par l’armée parce qu’elle les considérait comme coupables (pêcheurs) en les accusant d’être des guerrilleros et des communistes.*525
Tandis qu’être communiste équivalait à être antipatriotique526, et que les mesures politiques et militaires visant l’éradication du communisme s’enchaînaient, la guerre de contre-insurrection est peu à peu devenue une forme de « limpieza social527 » (ou nettoyage social) dénoncée par les commissions dans leurs rapports. En révélant des exécutions publiques faites par les PAC dans le département du Quiché en 1982, la CEH indique que : « [l]es chefs de patrouille se sont dirigés vers la population en explication que leur travail constituait à effectuer un nettoyage dans la communauté, et que pour cette raison, les quatre personnes [amenées] ont été présentées comme des agents de contamination en raison de leurs idées communistes.*528 » Les enquêtes du REMHI et de la CEH ont ainsi démontré que la violence exercée par les militaires et les paramilitaires dépassaient le désir de protéger l’État de la « menace rouge » et ont plutôt conduit à des massacres de masse.
Ce qui avait été le schème d’interprétation des violences durant plus de trente ans était évidemment profondément enraciné dans l’espace public et les insurgés, toujours présentés comme des « subversifs » continuaient à susciter beaucoup de méfiance. La transition politique exigeait donc des commissions de vérité de dissiper la croyance selon laquelle les victimes avaient été des malfaiteurs. En plus de déconstruire le discours politique des dernières années, il fallait que les commissions de vérité le réarticulent en explicitant de quelles manières les victimes avaient été discréditées, puis criminalisées. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur ce qui était la source première du rétablissement des faits qu’elles avaient entrepris : les témoignages des victimes. C’est de cet effort de la CEH dont témoigne le passage suivant :
Le simple fait de promouvoir des activités de développement communautaire, d’occuper un poste de représentant ou de promouvoir la prise de conscience des situations d’injustices était quelques-unes des raisons invoquées pour réprimer un grand nombre de personnes. Cette forme de délégitimisation est un élément central dans les témoignages.* 529
Convaincre une population endoctrinée nécessitait toutefois plus que des explications théoriques. Les commissions de vérité guatémaltèques ont alors appuyé leurs propos sur des exemples faisant sens pour l’ensemble des Guatémaltèques. Nous avons constaté que parmi ces illustrations la CEH a retenu un témoignage mettant en relation la situation de victimes guatémaltèques avec celles d’autres violences politiques s’étant déroulée en Argentine :
Soudainement, on nous appelait communistes, subversives, ennemies de l’État, nous, les femmes qui étaient auparavant des travailleuses, des mères de famille et qui souffraient, qui étaient victimes de la violence… Mejía Víctores nous disait : « Regardez mesdames, savez-vous ce que vous faites ? Vous faites ce la même chose que ce qu’on fait qu’en Argentine les mères de la Place de Mai, vous savez : elles sont de la guérira… vous allez ruiner l’État du Guatemala…»530
Plus qu’une façon de réfuter le discours politique encore en vigueur à la fin des années 1990, il nous apparaît que le choix de faire ressortir ce récit plutôt qu’un autre visait à créer une communauté de destin dépassant le contexte guatémaltèque.
De surcroît, le REMHI et la CEH se sont principalement appuyés sur les témoignages des victimes531, de proches532 ainsi que de témoins533 attestant de l’innocence des victimes directement affectées par différentes violations de leurs droits fondamentaux. Elles emploient alors un champ lexical relatif à cette condition pour qualifier les illustrations qu’elles mettent en évidence : « population civile », « sans défense », « désarmée », « inoffensive » et « vulnérable »534. De fait, les références aux « hypervictimes » sont nombreuses dans les deux rapports des commissions535. En revanche, la décriminalisation de la figure victimaire imposait aux commissions le recours à des exemples irréfutables ; à cette fin, il n’y a pas d’image plus forte que celle d’un bébé naissant : « [c]es faits constituent un acte délibéré, dirigé pour massacrer des êtres absolument sans défense, comme des enfants, et qui ne présentent aucun avantage au plan militaire. Un enfant nouveau-né ne peut être ni un combattant ni un collaborateur de la guerrilla.*536 »