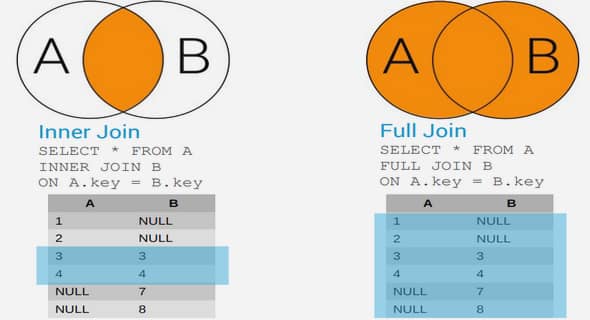Le régime de responsabilité issu de la Directive européenne n°85-374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux n’en finit pas de susciter de réelles difficultés.
Ces difficultés tiennent le plus souvent à l’articulation du régime spécial avec d’autres
régimes de responsabilité. Ce régime spécial a en effet été transposé en Droit français par une Loi n° 98-389 du 19 mai 1998, après une première condamnation de la France en manquement à ses obligations communautaires en raison du retard de transposition, aux articles 1245 à 1245-7 du Code civil. La France fut ensuite condamnée une deuxième fois pour transposition imparfaite de la Directive ayant voulu en étendre son champ d’application et prévoir pour le fournisseur du produit, une responsabilité similaire à celle qui pèse sur le producteur alors qu’il n’est tenu en principe qu’à une responsabilité subsidiaire. En réalité, ce régime spécial ne marque pas l’entrée en Droit français de l’idée selon laquelle celui qui par le défaut de son produit cause un dommage à autrui doit réparation. Avant la transposition, le Droit français connaissait déjà des mécanismes propres à indemniser les victimes des défauts d’un produit. Sur le terrain délictuel, la victime pouvait invoquer divers fondements au titre desquels la faute délictuelle ou la responsabilité du fait des choses en désignant comme responsable le gardien et en faisant jouer la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement tandis que sur le terrain contractuel, la victime pouvait invoquer la garantie des vices cachés vis à vis du vendeur ou l’obligation de sécurité de résultat que la Cour de cassation faisait peser à la fois sur le fabricant et sur le vendeur professionnel. Les éléments du régime spécial défavorables aux victimes tels que la prescription, la franchise applicable aux dommages aux biens d’un montant non négligeable de 500 euros ou encore la fameuse cause d’exonération que constitue le risque de développement pourraient les pousser à préférer les régimes de droit commun. Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue conférer un véritable monopole aux dispositions issues de la Directive en jugeant que le régime de responsabilité institué par la directive n’interdit pas l’application d’autres régimes de responsabilité mais à une condition, la condition que ces régimes reposent sur un fondement différent de celui de la Directive, qu’ils ne reposent donc pas sur le fondement du défaut de sécurité. Une des difficultés suscitée par ce régime est donc de déterminer quel régime de droit commun repose sur un fondement identique ou différent.
D’autres difficultés tiennent au contenu même du régime, plus particulièrement aux conditions centrales de la responsabilité du fait des produits défectueux que sont le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. C’est à la victime demanderesse qu’incombe la totalité de la charge de la preuve lorsqu’elle agit contre le producteur pour demander réparation du dommage qu’elle impute à un défaut du produit qu’il a fabriqué et mis en circulation. L’article 1386-9 désormais article 1245-8 du Code civil reprend presque mot pour mot l’article 4 de la Directive et dispose en effet que « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
La preuve de ces conditions a pu se révéler difficile s’agissant de certains produits, en particuliers les médicaments et les vaccins. Concernant le défaut, l’article du Code civil dispose qu’ « un produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Pour un médicament ou un vaccin, on ne peut s’attendre à ce qu’il ne présente aucun effet indésirable et souvent, les plus actifs et donc les plus utiles sont ceux qui présentent les effets indésirables les plus graves. La méthode qui semble avoir été adoptée pour déterminer si un médicament ou vaccin est défectueux est le test bénéfice-risques. Le produit serait alors défectueux lorsque le rapport bénéfice-risques n’est plus favorable. Pour établir ce caractère défavorable, le demandeur va devoir se référer aux études scientifiques mais lorsque celles-ci ne sont pas unanimes quant à l’existence de tel ou tel effet, la victime aura beaucoup de mal à convaincre le juge.
L’IMPUTABILITE, NOTION INCERTAINE
Cette notion prétorienne apparue dans un arrêt du 27 février 2007 qui reprenait la solution des arrêts du 23 septembre 2003 précités par lesquels la Cour de cassation avait refusé l’établissement d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques en raison de l’incertitude sur l’étiologie de la sclérose en plaques, avait ceci de particulier qu’aux trois conditions classiques de la responsabilité du fait des produits que sont le dommage, le défaut et le lien de causalité, une quatrième condition était invoquée, celle de l’imputabilité du dommage au produit. Certains auteurs avaient alors défini la notion, apparue dans ce contexte, comme « l’aptitude générale (scientifique) du produit à causer le dommage » .
Dans d’autres arrêts, la Cour de cassation semblait au contraire se référer à l’imputabilité comme synonyme de causalité, notamment dans une des espèces semble t-il rendues en 2008, le même jour que la Cour de cassation avait, par ailleurs, admis la possibilité pour les demandeurs d’établir in specie le lien de causalité entre produit et dommage, même en cas d’incertitude scientifique, par l’utilisation de présomptions de fait. Cette position de la Cour de cassation admettant que le lien de causalité puisse être établi par l’utilisation de présomptions de l’homme semblait s’opposer à ce que l’imputabilité, qui continuait à être invoquée, soit désormais regardée comme « l’aptitude générale du produit à provoquer le dommage ». Certains auteurs voient ainsi dans cette notion, un synonyme de causalité.
L’IMPUTABILITE COMME « APTITUDE GENERALE DU PRODUIT A CAUSER LE DOMMAGE »
En 2003, la Cour de cassation refusait d’admettre qu’un lien de causalité puisse être établi entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques alors que scientifiquement, un tel lien n’était pas prouvé. En 2007, elle réitérait sa solution mais invoquait une nouvelle notion, celle de l’imputabilité du dommage au produit.
Le Professeur Borghetti avait alors expliqué que la Cour de cassation semblait vouloir distinguer entre causalité générale et causalité spécifique. La causalité générale, ici appelée imputabilité du dommage au produit, correspondrait à la possibilité que le médicament incriminé provoque la pathologie dont souffre le demandeur. La causalité spécifique correspondrait quant à elle à l’exigence légale du lien de causalité entre défaut et produit, au lien causal établi entre la prise du médicament par le demandeur et la survenance de sa pathologie.
Cette approche entre causalité générale et causalité spéciale est semblable à celle qui prévaut en Droit anglo-saxon, du point de vue des toxic torts. Les réflexions causales portent alors sur le lien causal général et le lien causal spécifique. Le lien causal général se référant à l’accréditation qu’une substance est en mesure de produire le dommage dont la réparation est demandée et ce n’est qu’une fois que la preuve de la causalité abstraite a été vérifiée qu’il faut envisager si cette substance a effectivement ou pas causé le dommage dont l’indemnisation est demandée, se prononcer ainsi sur la causalité particulière.
Le Professeur Brun avait rebaptisée cette notion d’imputabilité comme aptitude générale du produit à causer le dommage dont se plaint la victime. Il dit en ce sens que la Cour de cassation impose « la preuve préalable de l’aptitude du produit considéré à occasionner le type de dommage dont il est demandé réparation ». Tandis que cette même notion était appelée par d’autres « causabilité » .
Dans leur esprit, cette notion se distingue de la causalité classique, juridique. Elle consisterait au contraire, en une causalité générale et nécessairement scientifique qui ne serait que la preuve scientifique de la possibilité que le produit puisse causer le dommage.
Imputabilité ne voudrait donc pas dire causalité. Ce n’est pas parce qu’il est prouvé que le produit peut provoquer le dommage scientifiquement qu’il l’a réellement causé en l’espèce. A titre d’illustration, dans l’espèce récente de l’arrêt du 27 juin 2018 précité, l’exploitant d’un local commercial, détruit à la suite d’un incendie, avait assigné le producteur du coffret de commande et de régulation des chambres froides installé dans le local sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. La cour d’appel de Bastia avait fait droit à la demande en jugeant que les constatations de l’expert situaient le départ du feu dans le coffre de commande et que l’origine du feu pouvait se situer soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret, soit sur une borne de raccordement de service ou d’alimentation installée par une société. Dans une telle hypothèse, l’imputabilité ne fait aucun doute. Le coffret a pu causer le dommage. Mais cette « simple » imputabilité ne suffit pas pour autant à établir « le défaut » ou « le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Autrement dit, même si le coffret a pu causer le dommage, il n’est pas avéré que le coffret était défectueux et que le défaut ait causé le dommage.
Introduction |