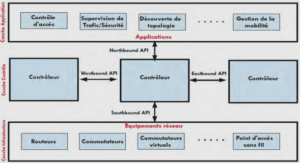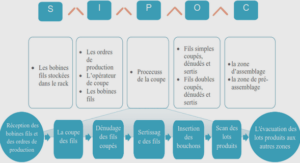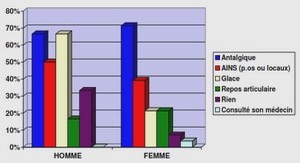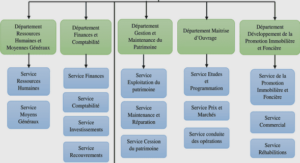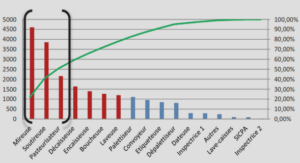L’imamat ou la direction de la communauté
L’imam intermédiaire entre Dieu et les hommes Avec toutes les ambiguïtés que développait la propagande abbaside la « révolution » à laquelle est parvenue la nouvelle dynastie (le terme « révolution » ne fait que reprendre l’historiographie de l’époque3 ), peut, dans l’immédiat, apparaître comme un moment rare où l’umma se retrouve réunie sous la conduite de son imam. Selon Ṭabarī, la couleur noire de la Maison du Prophète est arborée à Kūfa et al-Saffāḥ, dans la grande mosquée de la ville où il vient de recevoir le serment d’allégeance (ar. bay`a) de la population, remercie Dieu, de qui il tient son mandat. Après avoir toléré l’emprise des usurpateurs omeyyades, Celui-ci a
en effet voulu que la direction de l’umma revienne à la descendance de Hāšim, le bisaïeul du Prophète, un ancêtre que partagent ainsi Alides, Abbasides et Hachémites5. Al-Saffāḥ n’exerce que brièvement sa fonction, dès 754, son demi-frère, qu’il a désigné comme successeur, accède au califat sous le nom d’al-Manṣūr. C’est par conséquent ce dernier qui était le destinataire de l’Épître aux Compagnons, qu’Ibn al-Muqaffa` compose certainement entre 754 et 756, date probable de la mort du polygraphe
L’Épître aux Compagnons (Risāla fī l-Ṣaḥāba)
Le titre du texte (ci-après Épître ou Risāla) ne lui a pas été donné par l’auteur mais par les exégètes en raison des nombreux passages se rapportant à l’entourage direct du calife, à ses « compagnons ». D’une structure lâche mais néanmoins identifiable malgré de nombreuses digressions, le texte ambitionne, non à conseiller le prince, ce qui serait faire preuve d’outrecuidance, mais « à lui communiquer spontanément des informations quand on a le sentiment que personne d’autre ne s’en est chargé, ou à lui rappeler des faits déjà portés à sa connaissance .»8 On peut toutefois suivre Pellat quand il suggère qu’il est possible que la Risāla ait été écrite à l’instigation du protecteur d’Ibn al-Muqaffa` et de ses proches qui n’osaient peut-être pas s’adresser directement au calife. Ce qui est certain, nous y reviendrons, c’est que la liberté de ton qu’adopte à plusieurs reprises le texte a pu être la cause, ou l’une des causes, de la fin tragique que connaît son auteur. De la longue missive en forme de mémorandum10, on retiendra les développements portant sur les prérogatives de l’imam en matière de religion, ainsi que ceux consacrés à l’armée, à l’impôt et à l’entourage du prince.
C’est dans le cadre d’une véritable théorie du théologico-politique que l’auteur déploie une réflexion tendant à identifier les hypothèses dans lesquelles obéissance est due à l’imam. Sont écartées, dans un premier temps, toutes interférences du Commandeur des Croyants dans des domaines où Dieu a lui-même défini les obligations et les sanctions. L’imam ne saurait ainsi prohiber la prière, le jeûne ou le pèlerinage ou encore interdire la mise en œuvre des peines canoniques ou, inversement, autoriser des actes que Dieu a déclarés illicites. A ces matières où Dieu a révélé sa Loi, Ibn al-Muqaffa` oppose celles où obéissance est due à l’imam et à lui seul, matières dans lesquelles par conséquent nul autre « n’a le droit d’émettre des ordres ». Il en va ainsi du déclenchement de la guerre, de la nomination ou de la révocation des fonctionnaires ou bien encore de la perception des tributs ou des butins. Viennent en troisième lieu les domaines où, à défaut de Loi révélée, la raison a vocation à s’exercer : ce champ d’action Dieu l’a toutefois réservé à « l’opinion personnelle » (ar. ra`y) « des seuls détenteurs du pouvoir », c’est-à-dire à l’imam13. C’est dans ce cadre que la Risāla aborde les questions liées à l’armée, nous y reviendrons, avant de s’intéresser aux problématiques religieuses et juridiques : elle relève en ce domaine des disparités dans les décisions rendues dans les ressorts de Kūfa et Baṣra dans des matières aussi sensibles que les condamnations à mort ou les délits sexuels. Ces disparités, est-il observé, trouvent leur origine dans l’existence d’écoles qui, toutes se croient supérieures aux autres, en des cadis qui baptisent sunna des traditions qui n’en sont pas, se fondent sur des ra`y qui leur sont propres, ou encore sur des raisonnements analogiques (ar. qiyās) qui,« en matière de religion et de justice » peuvent conduire à des absurdités14. L’auteursuggère en conséquence que les dossiers se rapportant à ces décisions juridiques divergentes soient apportés au Commandeur des Croyants, afin que sur chaque affaire celuici formule « l’avis que Dieu lui inspirerait ». Les cadis se verraient interdire de s’écarter du corpus ainsi constitué, seul un imam ultérieur étant habilité à faire évoluer ce code « unique et juste ». Quelques décennies après la Risāla, la situation n’avait pas évolué et al-Rašīd,invitait, en cas de doute, ses gouverneurs à consulter les `ulamā`. Ainsi, si l’on en croit Balāḏurī (m. 892), cité par Sourdel, la question soulevée par Ibn al-Muqaffa` se posait en les mêmes termes, deux éminents juristes y apportaient des réponses diamétralement opposées :
Abū Yūsuf est d’avis que, s’il existe dans un pays une coutume non arabe que l’Islam n’a ni modifiée ni abolie et si le peuple se plaint au calife que cette ancienne coutume soit dure pour lui, le calife n’est pas en droit de la modifier ; mais Mālik […] est d’avis qu’il peut la modifier, même si elle est ancienne, parce qu’il devrait [dans des circonstances analogues] supprimer toute coutume valide introduite par un musulman, sans parler de celles qui ont été introduites par des incroyants.