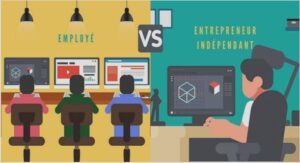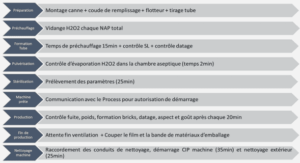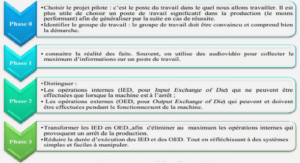Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Une industrie culturelle : L’École de Francfort
Le fait que le cinéma soit une industrie culturelle lui a valu de nombreuses critiques qui, depuis l’École de Francfort ont mis l’accent sur ses insuffisances artistiques et critiques. Adorno et Horkheimer dans « La production industrielle des biens culturels » s’emploient à refuser au cinéma, le statut d’art et à lui reprocher sa dépendance au marché qui en dénaturerait les productions. Ils dénoncent dans cet article les effets négatifs du cinéma sur les masses. Selon eux, l’industrie cinématographique, pervertit les fonctions sociales de l’art. Ils écrivent : « Le film et la radio n’ont plus besoin de se faire passer pour de l’art. Ils ne sont que business : c’est là leur vérité et leur idéologie qu’ils utilisent pour légitimer la camelote qu’ils produisent délibérément. Ils le définissent eux-mêmes comme une industrie et, en publiant le montant des revenus de leurs Directeurs Généraux, ils font taire tous les doutes sur la nécessité sociale de leurs produits. »1 En plus d’être des produits conçus dans le but exclusif de faire des recettes, les films sont uniformes et répondraient à un standard susceptible de séduire le public le plus large possible. « Le fait qu’elle s’adresse à des millions de personnes impose des méthodes de reproduction qui, à leur tour, fournissent en tous lieux des biens standardisés pour satisfaire aux nombreuses demandes identiques. »1 Face à ce type d’œuvres, le spectateur n’aurait aucun effort d’imagination à fournir, recevrait les images de manière détachée ce qui, en définitive, le ferait sombrer dans l’ennui. Avec pour résultat un effet de violence exercé contre le spectateur qui subit passivement, celle représentée l’écran. De plus, face à des situations toujours différées et à cause de l’incapacité des films à apporter des solutions concrètes à des problèmes réels, ceux-ci entretiennent un climat de frustration dont le spectateur est la victime consciente. « Le principe impose de lui présenter tous ces besoins comme des besoins pouvant être satisfaits par l’industrie culturelle, mais d’organiser d’autre part ces besoins de telle sorte qu’au départ il se voit uniquement en éternel consommateur, objet de l’industrie culturelle. »2
Ils concluent à la formation d’une masse profondément abêtie par ces productions qui ne peut que se soumettre à l’acceptation d’un état de fait qui est, celui-même, auquel le cinéma les adapte. « Dans les dessins animés, Donald Duck reçoit sa ration de coups comme les malheureux dans la réalité, afin que les spectateurs s’habituent à ceux qu’ils reçoivent eux-mêmes. »3 Ou : « Les masses démoralisées par une vie soumise sans cesse aux pressions du système, dont le seul signe de civilisation est un comportement d’automate susceptible de rares sursauts de colère et de rébellion, doivent être incitées à la discipline devant le spectacle de la vie inexorable et du comportement exemplaire des victimes. »4 Dans cette optique, les films conditionnent le spectateur à l’obéissance et à la soumission, les mêmes dont il doit faire preuve dans sa vie pour être intégré dans sa société. « À l’ère du capitalisme avancé, la vie est un rite permanent d’initiation. Chacun doit montrer qu’il s’identifie sans réserve avec le pouvoir qui ne lui fait grâce d’aucun coup. »5 Le cinéma ne serait en définitive qu’un instrument d’intégration qui soumettrait le public à l’acceptation passive de son sort en se conformant aux valeurs véhiculées par les personnages principaux. Les auteurs de cet article critiquent sans nuance les productions de la culture de masse qu’ils assimilent toutes à des marchandises radicalement opposées à l’œuvre d’art. Ce texte cependant, comme le remarque J.-P. Esquenazi doit être considéré en fonction des conditions de sa conception. « C’est un texte violent, écrit sous le coup d’une double indignation. Les auteurs, encore ahuris par la violence nazie, réfugiés aux États-Unis, supportent cependant difficilement la vie et la culture américaines. »1 Il n’empêche que la teneur de ces critiques a inspiré durablement la sociologie de la culture de masse et du cinéma2.
Une adaptation au réel : Walter Benjamin
C’est dans une toute autre perspective que W. Benjamin s’est intéressé au cinéma. Dans « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », il s’intéresse à sa signification sociale liée à son aspect destructeur, c’est-à-dire « la liquidation de la valeur traditionnelle de l’héritage culturel »3. C’est sur cette base qu’il développe son analyse du cinéma et de son avènement qu’il associe, aux changements de l’expérience et de la perception dus à des bouleversements socio-économiques. Ceux-ci ont entraîné, selon lui, l’importance croissante des masses, de laquelle a découlé le déclin de l’aura de l’œuvre d’art. Il explique ce déclin par deux circonstances liées à l’apparition des masses. « Car rendre les choses spatialement et humainement « plus proches » de soi, c’est chez les masses d’aujourd’hui un désir tout aussi passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen d’une réception de sa reproduction. »4 L. Moholy-Nagy qui a inspiré Benjamin écrit : « La curiosité qui pousse l’homme à vouloir découvrir la totalité du monde s’est augmentée du sentiment d’y être engagé à chaque instant, dans chaque situation. »1 Ce qui rendrait légitime le rôle privilégié que doit jouer « le procédé de figuration mécanique aux possibilités de développement encore incommensurables »2. En raison de cette proximité acquise par des moyens techniques, Benjamin voit se mettre en place un nouveau rapport au réel qu’il comprend comme déclin de la valeur de culte que remplace la valeur d’exposition. La mise en exposition du monde génère une mise à disposition de celui-ci qui entretient la puissance d’un lien fondé sur sa mise en spectacle. Pour Benjamin, de cette proximité potentielle avec le réel en résulte un phénomène d’une importance considérable : « Ainsi se manifeste, dans le domaine de l’intuition, quelque chose d’analogue à ce qu’on observe dans le domaine théorique avec l’importance croissante de la statistique. L’alignement de la réalité sur les masses et des masses sur la réalité est un processus d’immense portée, tant pour la pensée que pour l’intuition. »3 La réalité agit sur les masses et réciproquement, ce qui renforce les liens qui les unit. Voir de près l’événement reproduit devient le mode de contact et d’accès à l’objet naturel et à l’œuvre artistique. Ils perdent ainsi de leur mystère et sont libérés de leur magie. Ce phénomène correspond à des aspirations précises de la masse. Celle-ci a pour particularité d’un côté que les choses se « rapprochent » de soi et ce, notamment, dans leur reproduction. Et d’un autre, elle veut que soit réduite l’unicité de chaque situation, de chaque objet par la médiation de leur reproduction. Il en résulte ce qu’il identifie comme le déclin de l’aura de l’œuvre d’art qui, une fois soumise à la reproduction, cesse d’être inapprochable. Elle perd les caractères qui faisaient d’elle jusqu’alors une image au service d’un culte, qu’il soit magique, religieux ou jusqu’au culte de la beauté. « Tous ces caractères se résument dans la notion d’aura, et on pourrait dire : à l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura. »1 L’aura étant définie comme : « L’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il. »2 Lointaine et unique, l’œuvre d’art préserve sa fonction cultuelle en étant inapprochable. Définie comme unique apparition d’un lointain, l’aura ne peut plus être le contenu d’expériences d’une technique dont la caractéristique est la reproduction en série et l’accessibilité de ce qui est ainsi reproduit. L’appréciation désintéressée de l’œuvre d’art ne suffit plus à combler une conscience pour laquelle la maîtrise du réel devient une nécessité. La technique qui rend possible une appropriation collective du réel « dans l’image ou plutôt dans la reproduction », le banalise, le popularise ou le démocratise et coïncide avec les besoins d’une perception qui veut nouer un lien cognitif avec le réel. Le résultat en est une perception hyper-réceptive aux sensations immédiates, toujours renouvelées, du fait de l’accélération des rythmes de vie. L’aura de l’œuvre d’art promet un plaisir toujours différé, une aspiration continuée. La beauté moderne est une évidence, directe, fascinante d’immédiateté, reproductible, sans mystère, énigmatique. La perte de l’aura permet au public de s’adapter au réel par la médiation d’un appareillage technique et lui fait éprouver la sensation de la modernité.
Avec le cinéma, c’est à un changement de paradigme artistique auquel on assiste. Le regard se porte face à soi, face à un monde dont le support sur lequel il se reflète n’a pour unique profondeur que sa propre surface. Mais Benjamin veut montrer comment la technique cinématographique va compenser certaines de ses insuffisances par rapport à la création artistique, ce qu’Adorno et Horkheimer n’ont pas voulu reconnaître. Afin de nouer avec le réel un lien structurel, l’homme crée de nouvelles connexions avec lui, qu’il scrute, qu’il sonde, qu’il fouille et qu’il rapproche de soi. L’intrusion de la technique et de l’appareil dans la texture du visible a permis de circonscrire un réel rendu par là même, plus apparent, délivré du voile du mystère et de l’inaccessible. Le progrès matériel de cet appareillage accomplit un équivalent sans précédent entre l’œil et le temps qui coïncident en un instant pour se conserver pour un temps illimité. L’événement réside dans cette précision et dans ce pouvoir de maîtriser la durée dans l’immédiateté. Sur la base d’une expérience tactile, « une pression du doigt », une expérience prend forme, « conserver l’événement pour un temps illimité »1. Tel est le décalage extrême que permet l’appareil qui ne nécessite aucun effort pour un résultat maximal. Cette absence d’effort explique pourquoi ces appareils s’imposent comme conquête essentielle « d’une société dans laquelle la place de l’exercice se réduit sans cesse »2. Cette rapidité d’exécution liée à un enregistrement immédiat permet de satisfaire les aspirations de la masse qui veut pouvoir accéder à la visibilité du monde, à ce qu’on la lui restitue. Tout ce qui se donne à voir est enregistré par l’appareil qui peut alors le restituer à un nombre illimité de personnes. Ce gain de rapidité, de précision et de diffusion massive contribue à ancrer la masse dans son milieu d’existence et la met en phase avec de nouvelles obligations qui l’attendent aux tournants de l’histoire. Cette nouvelle expérience tactile et visuelle s’harmonise à la perception d’une nouvelle réalité sociale qui permet à l’homme de « répondre à des tâches nouvelles », « Car des tâches qui s’imposent à la perception humaine aux grands tournants de l’histoire il n’est guère possible de s’acquitter par des moyens purement visuels, autrement dit, par la contemplation. »3 Dans ce nouveau milieu d’existence, de nouvelles expériences se font jour qui légitiment le fait que, pour Benjamin, le cinéma se présente comme une solution cognitive face à ces différents changements de rythme et de conditions de vie. En mettant en évidence la nouveauté radicale des pouvoirs de cet appareillage, il rend explicite le passage que celui-ci a permis de franchir et qui accorde désormais une suprématie à la valeur d’exposition et finalise ce que G. Debord appelle « la société du spectacle »4.
Dès lors que le réel est saisi par l’objectif, objectivé, il cesse d’être éloigné de soi, il perd tout caractère inapprochable. Benjamin remarque : « Bientôt, en effet, les progrès de l’optique fournirent des instruments qui supprimèrent entièrement l’obscurité et reflétèrent le visible avec la fidélité d’un miroir. »1 Mais la précision ne préjuge en rien de l’authenticité de ce qui est ainsi reflété. La caméra rapproche de soi ce qui n’appartient pas nécessairement à notre champ de vision. Elle rend opératoire cette expérience tactile qui crée la sensation de toucher le monde des yeux. Le monde semble perdre de sa distance. Ce qui a pour effet immédiat, de rapprocher ce qui est filmé du spectateur qui s’habitue à la miniaturisation du monde. Ầ travers l’écran, le regard ne perd rien d’une totalité concentrée sur une surface minimale.
Grâce au gros plan, c’est l’espace qui s’élargit »2. La masse, face à ces innovations techniques, s’habitue à la représentation du visible de manière aussi immédiate et directe que le permet la presse avec les nouvelles. Ses attentes seraient également motivées par un besoin d’objectivité car « son importance augmente à mesure que le caractère subjectif de l’information fournie par la peinture et les arts graphiques font de plus en plus problème par rapport à la nouvelle réalité sociale et technique. »3 Le cinéma assouvit donc des aspirations contradictoires, entre sensations et informations, stimulations et connaissances, objectivité et visibilité, identité et égalité. Il devient selon Benjamin le mode d’expression le mieux à même, dans ce contexte, de s’harmoniser à ce processus d’accélération et d’intensification des sensations.
Le cinéma accompagne l’adaptation des masses aux automatismes et aux mécanismes auxquels les individus sont parallèlement soumis dans leur vie quotidienne. Il n’a fait que précipiter un mouvement en marche. Si le cinéma a pu s’imposer c’est que l’expérience du choc structure la conscience moderne. Ceci entraîne la perte du lien à la tradition au profit du culte de l’événement à travers la suprématie accordée à l’instantanéité de l’information. Le cinéma est alors pensé par Benjamin comme le médium à même de contenir et de refléter les nouvelles expériences qui conditionnent la vie de masses de plus en plus nombreuses, perçues comme à l’origine de nombreux changements. « La masse est une matrice d’où sort à l’heure actuelle tout un ensemble d’attitudes nouvelles à l’égard de l’œuvre d’art. »1 Les aspirations de la masse résulteraient des nombreux chocs et stimuli que le rythme de vie leur impose. L’expérience du choc génère de nouveaux comportements et de nouvelles perceptions. Dans ce contexte, le cinéma s’impose comme un miroir qui sidère le regard, qui réfléchit et reflète les ombres et les lumières d’un monde en mouvement. Il se définit comme surface sur laquelle l’événement vient s’inscrire mais duquel n’émane nulle relation de réciprocité ni d’échange. Pur produit d’un procédé technique, le cinéma apparaît comme l’emblème d’une crise de la perception dont les répercussions vont s’étendre jusqu’aux transformations du lien social. Cette intériorisation du changement, vécue par les individus confrontés à la foule, agit sur leur psychisme et leur comportement. L’anonymat ressenti par l’individu au contact de la foule déclenche, en retour, un désir d’incorporation un tout qui le dépasse. Le choc subi par celui que plus rien ne protège, fait surgir selon Benjamin, ce qu’il reconnaît déjà comme, « l’idéal profond, secret et paradoxal de Baudelaire : être porté, être protégé par la grandeur »2. P. Michon remarque que « Benjamin consacre ainsi l’essentiel de cet essai à observer comment les rythmes des appareils s’articulent dialectiquement à la production de l’individuation psychique et collective et, notamment à l’apparition des « masses »»3. De nouvelles attitudes en découlent, basées sur l’exigence d’une attention soutenue aux chocs provoqués par le changement de rythme de vie dans la rue, sur les chaînes d’usine, par la propagation des nouvelles et des modes. Benjamin prend l’exemple du texte de Poe, L’homme des foules », pour rendre compte des mimiques, des gestes mécaniques qui ne seraient que des réponses à des chocs traumatiques dans le flot de la circulation urbaine. Cet homme des foules est pour Benjamin, « une préfiguration du citoyen de nos jours quotidiennement bousculé par les nouvelles des journaux et de la TSF. Et exposé à une suite de chocs qui atteignent parfois les assises de son existence même. »1 R. Tiedemann le résume ainsi : « Dans « l’importance croissante des masses dans la vie actuelle », Benjamin découvre la détermination sociale spécifique d’un phénomène historique général. »2 Dans ce contexte, la photographie puis le cinéma vont s’imposer comme des procédés qui concentrent en eux, tout ce que les hommes attendent de la technique : rapidité, facilité, précision, fiabilité, ponctualité. En eux se révèlent, se déposent et se précipitent toutes les aspirations que renferme l’idée de progrès.
Le cinéma renvoie au regard un monde devenu objet de spectacle qui se révèle à travers les éléments qui le constitue, que le spectateur peut à loisir observer. Le cinéma se présente alors, comme la pratique artistique la mieux même de réaliser les aspirations d’une masse dont la perception s’est transformée. Les automatismes que les individus incorporent leur permettent de s’adapter dans un milieu d’existence qui propose des expériences inédites. Le choc se traduit par un sentiment d’insécurité qu’il faut surmonter, que la conscience maîtrise par une perception du temps réduit à une suite d’instants, par une actualité structurée par des événements sensationnels mais datables. Tous ces changements dus à des conditionnements sociaux et des facteurs techniques se sont développés de manière simultanée. Les informations transmettent le pur en-soi de l’événement dans sa matérialité brute. L’événement est réduit à une répétition d’expériences livrées sous la forme du choc qui, à peine assimilé par la conscience, est remplacé par un événement tout aussi sensationnel. Benjamin écrit : « La presse rassemble une profusion d’informations dont l’effet excitant est d’autant plus fort que celles-ci ne font l’effet d’aucune exploitation. » 1 La vitesse et l’intensité des informations transforment le sensorium humain. Il n’y a plus aucune corrélation entre les nouvelles prises une à une, ce qui crée un sentiment de dispersion, de manque d’unité et de totalité. Le cinéma participe et contribue avec le presse à exploiter ce qui apparaît remarquable, sensationnel ou spectaculaire, doté d’un fort pouvoir d’attraction. La nouvelle sensationnelle est reçue dans l’instant, agit sur l’individu de manière immédiate, brutale et sans préparation face à son caractère imprévisible. La caméra peut capturer l’événement, le retrancher de l’écoulement temporel et le sauver. Elle fait elle-même l’événement et le recueille. Elle apparaît donc comme un moyen efficace d’obtenir du réel, des matériaux comme autant de fenêtres qui s’ouvrent sur un horizon lointain devenu accessible à tous. En réduisant la distance entre soi et le monde le cinéma, par le choc de l’image, prolonge et valide le travail de la presse qui s’appuie sur le choc de l’événement. Mais ce choc reçu de l’extérieur, interrompt le processus de la transmission d’une expérience par son caractère imprévisible, inouï. Comme l’a noté J.-L. Déotte : « L’information ne permet pas de penser parce qu’elle stérilise l’enchaînement. Cette missive (l’événement médiatique) que je reçois est un missile contre lequel la paroi de l’appareil psychique peut seulement se protéger et doit être constamment restaurée. »2 L’expérience urbaine se confond avec l’évolution technique qui soumet « le sensorium humain à un entraînement complexe »3. Le cinéma adapte l’homme à un milieu d’existence dans lequel l’adaptation aux mécanismes devient une condition préalable à toute action. L’expérience cinématographique initie l’homme aux mécanismes, l’adapte aux multiples expériences tactiles et optiques qu’exige l’appareil. Elle s’annonce comme schème d’intelligibilité d’une modernité qui, pour se ressaisir elle-même, trouve dans le cadrage opérée par la caméra, les nouveaux angles d’attaque de sa réalité immédiate dominée par l’industrie et le progrès.
Table des matières
Introduction
A – Présentation
B – L’imaginaire de la menace
C – La méthode
D – Le plan de la thèse
Première Partie : SOCIOLOGIE DU CINÉMA
Chapitre I – Différentes analyses du cinéma
A – Une industrie culturelle : L’École de Francfort
B – Une adaptation au réel : Walter Benjamin
C – La mentalité d’une nation : Siegfried Kracauer
D – La participation affective : Edgar Morin
E – Une hypervision : Gilles Lipovetsky, Jean Serroy
F – Un cinéma de la menace : Jean-Michel Valantin
G – Proposition de synthèse
Chapitre II – L’imaginaire cinématographique
A – Fiction et participation : un rapport esthétique au monde
B – Des discours aux images : la construction de la menace
Deuxième Partie : LES IMAGINAIRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LA MENACE
Résumé des films
Chapitre III – La mise en spectacle de la menace
A – Introduction
B – De hier à aujourd’hui : les nouvelles menaces
Chapitre IV – La mise en spectacle des menaces naturelles
A – De l’homme à l’animal : les expérimentations sur le vivant
B – Du changement climatique à la fin du monde : les catastrophes naturelles
C – Le mépris des lois du vivant : des mécanismes de défense
D – Entre gaspillage et pillage : destruction de la biodiversité
E – La dangerosité de la nature : monstruosité et empoisonnement
Chapitre V – La mise en spectacle des menaces technologiques
A – L’intelligence artificielle : la suprématie des machines
B – Un corps instrumentalisé : le clonage
C – Contrôle et sécurité : la vidéosurveillance
Chapitre VI – La mise en spectacle des menaces sociales
A – Les ennemis venus d’ailleurs : guerre d’invasion et terrorisme
B – Un exercice de la violence légitime : la tyrannie
C – La peur de l’autre : racisme et discrimination
Chapitre VII – Le héros face à la menace
A – L’homme et la nature : se protéger de la nature
B – Le héros, révélateur de la crise écologique
C – L’homme et la seconde nature d’origine technique : résister face aux machines
D – L’homme et l’homme : surmonter la séparation
E – La nouvelle figure du héros
Troisième Partie : DE LA RÉCEPTION À L’INTERPRÉTATION
Chapitre VIII – La réception filmique
A – Un public de lycéens : la réception des films
B – La perception des menaces
C – Deux films préférés : Avatar et Invictus
Chapitre IX – Des films aux menaces : l’interprétation
A – Les imaginaires de la catastrophe
B – De l’effondrement au renouvellement
C – L’accélération et la mondialisation de la menace
D – Un climat mental
CONCLUSION
Bibliographie
Annexe
Affiches
Classement des risques
Télécharger le rapport complet