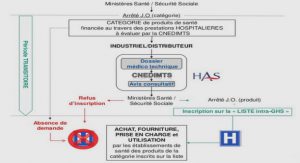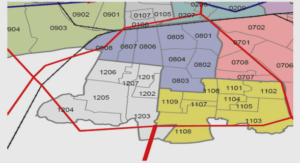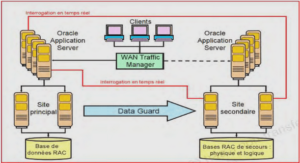L’identité de la gestion en tant que projet scientifique
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons souligné les problèmes d’identité des travaux B&S et développé différentes limites qui nous semblent poser la question du statut gestionnaire de ces travaux. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous allons introduire et définir la notion de modèle de pilotage, qui constitue un concept central pour la suite de ce travail. Nous procèderons de la manière suivante : nous reviendrons tout d’abord sur différents travaux abordant la question du projet scientifique gestionnaire et proposerons de définir son objet comme l’étude du pilotage de l’action collective et de ses rationalisations (A). Nous présenterons ensuite la notion de modèle de pilotage comme une combinaison de trois éléments : un modèle de performance, des objets d’action et un ensemble de dispositifs et d’expertises associées (B). Enfin nous discuterons de la portée d’un tel concept pour l’étude des rationalisations en cours en matière de management du développement durable et de la RSE (C). Nous avons largement évoqué la difficulté du champ B&S à identifier ou revendiquer un cœur théorique et une identité propre. Cette situation, si elle peut sembler exacerbée au sein de cette discipline émergente, apparaît représentative d’un débat plus général qui traverse les sciences de gestion depuis plusieurs décennies. En effet, la gestion ne s’est pas constituée autour d’un cœur scientifique propre. Elle se construit autour d’un objet, l’entreprise, constituant pour de nombreux chercheurs un terrain d’application privilégié de théories sociologiques, psychologiques ou économiques. Souvent présentées comme une discipline carrefour, emprunteuse et dépourvues de projet et de cœur théorique autonome, les sciences de gestion apparaissent, à l’image du champ B&S, en déficit d’identité (David, Hatchuel et Laufer, 2000). Ce questionnement identitaire s’est traduit par la multiplication de débats concernant l’existence de fondements communs des sciences de gestion, les effets pervers de leur fragmentation et de leur absence d’unité dans la compétition pour les ressources (Pfeffer, 1993), l’évaluation de la qualité de la recherche en gestion (McKelvey, 2006) et son utilité sociale (Hambrick, 1994). Ces questions nous semblent cruciales dans la mesure où elles renvoient à la nature des objets de recherche et aux modalités de production et d’évaluation des connaissances produites. Avancer sur l’identité d’un projet scientifique gestionnaire constitue aussi un pré requis indispensable pour situer la pertinence de notre objet de recherche.
L’objet des sciences de gestion : de l’étude de l’entreprise à un projet scientifique plus général
Pour avancer dans l’analyse, il est utile de revenir sur les éléments historiques de constitution de la gestion en tant que discipline. A ce titre, la gestion suit une trajectoire originale. Comme le souligne Armand Hatchuel (2000), la gestion, par contraste avec l’économie (centrée sur les phénomènes économiques) ou la sociologie (centrée sur l’étude de la construction de collectifs humains), ne se constitue pas à travers une opération de restriction de l’analyse sur une classe de phénomènes particuliers. Initialement pensée comme un projet éducatif, la gestion n’a été confrontée à la question de sa portée, de ses L’identité de la gestion en tant que projet scientifique fondements épistémologiques, de l’identité de son projet scientifique et de ses propres frontières que dans un second temps de son histoire (Hatchuel, 2000). La dynamique de construction de la gestion se situe ainsi à rebours d’autres sciences humaines telles que la sociologie, l’anthropologie ou l’économie : la gestion, à l’inverse de ses consoeurs, semble avoir émergé sans « cœur scientifique ». S’il apparaît difficile de définir l’objet de la gestion par une classe particulière de phénomènes, elle s’est constituée autour d’un objet de prédilection : l’entreprise. L’entreprise et son administration cristallisent en effet des difficultés inédites en matière d’action collective. L’entreprise apparaît ainsi, historiquement, comme un lieu intense de rationalisations et de transformations. Comme le souligne Armand Hatchuel, cette dimension transformative s’inscrit dans la nature même de l’entreprise : « l’entreprise n’est […] pas un collectif naturellement isolable et la révision permanente de ses frontières (physiques, légales, humaines, commerciales, etc.) est une condition de son existence » (2000 :16). Parmi l’ensemble des institutions sociales, l’entreprise apparaît ainsi comme disposant de la propriété unique de se refonder et de se transformer en permanence. Elle apparaît ainsi comme un lieu d’exacerbation de la « nature artefactuelle de l’action collective » (2000 :17). Toutefois, l’histoire met en évidence une extension progressive de la gestion au-delà des entreprises, comme en témoigne l’introduction de logiques gestionnaires dans d’autres domaines que ceux de l’entreprise (l’Etat, l’individu à travers la gestion de soi, les associations, etc.). Dans ce cadre, il apparaît possible de définir l’objet de la recherche en gestion, au-delà des entreprises, comme l’étude des processus de rationalisation de l’action collective et de leur pilotage (Hatchuel et Weil, 1992; Hatchuel, 1997, 2000, 2001c). Pour Hatchuel (2001 : S36), « l’essence des sciences de gestion réside dans la compréhension, l’invention et la critique de modèles d’action collective ». Ces premiers éléments apparaissent déterminants pour avancer sur le statut des connaissances gestionnaires (2) et sur le potentiel scientifique d’un tel questionnement (3).
La nature des connaissances gestionnaires et la question de l’actionnabilité
Si l’objet de recherche de la gestion apparaît défini de manière plus précise, la gestion semble aussi se distinguer des autres sciences humaines par la nature des connaissances qu’elle vise à produire. La gestion, en tant qu’enseignement et que discipline, s’est développée au contact de mouvements de rationalisation des entreprises et de leur environnement social, technologique et concurrentiel. Le projet des « pères fondateurs » de la gestion (Taylor, 1911; Fayol, 1916) peut donc être relu comme un effort réflexif de formalisation, d’accompagnement et de structuration de l’action, dans un tel contexte de transformation. Une telle approche permet d’éclairer la nature des connaissances produites en gestion : pour différents auteurs, la recherche en gestion vise à produire des connaissances appliquées à un contexte et orientées vers l’action (Tranfield et Starkey, 1998). Dans cette perspective, il est possible de considérer la gestion comme une discipline centrée sur la question de la conception, dans laquelle l’analyse et la description de processus d’action est indissociable de la production de dispositifs et de cadres permettant d’agir sur les phénomènes étudiés (Hatchuel, 2001c; 2001b). A l’image de l’ingénierie (Chanal, Lesca et Martinet, 1997), l’architecture ou la médecine (Tranfield et Starkey, 1998), les sciences de gestion ne se cantonnent pas à prédire des phénomènes, mais cherchent à produire des catégories, des cadres et des concepts permettant de structurer les processus d’action collective. Si les connaissances gestionnaires peuvent s’apparenter à des sciences de la conception orientées vers l’action, comment caractériser la nature de ces connaissances de manière plus précise ? Partant souvent d’un constat critique de cloisonnement et de déconnexion entre les théories académiques et pratiques (Rynes, Bartunek et Daft, 2001; Starkey et Madan, 2001), le concept d’actionnabilité vise à mieux qualifier de telles connaissances. Il renvoie notamment à la capacité des chercheurs en gestion à produire des connaissances pertinentes pour l’action. Si de nombreux acteurs s’accordent à considérer l’objectif de la recherche en gestion comme la production de savoirs actionnables (Argyris et Schön, 1978; Argyris, 1995; Martinet, 2000; Hatchuel, 2005), sa caractérisation plus précise ne fait pas consensus. Cette question peut ainsi être abordée suivant des angles multiples. Après avoir recensé trois acceptions dominantes de la notion (sections a), b), et c)), nous définirons l’actionnabilité comme la capacité de connaissances gestionnaires à ouvrir de nouvelles capacités d’action collective (d). a) L’actionnabilité comme simplification – transfert des savoirs académiques La première perspective consiste à considérer que les savoirs actionnables sont des connaissances prêtes à l’emploi et directement mobilisables pour l’action. Ainsi, Cross et Sproull (Cross et Spoul, 2004) qui étudient la manière dont les managers échangent des connaissances pour résoudre des problèmes complexes, définissent l’actionnabilité comme les caractéristiques « d’un savoir débouchant sur des progrès immédiats sur un projet donné ou dans le cadre d’une fonction précise » (p.446). Ici, l’approche repose sur la capacité des acteurs à identifier et utiliser une information utile dans un contexte organisationnel donné ou face à un problème précis. Dans ce contexte, une connaissance actionnable est un savoir dont la complexité a été réduite pour le rendre transférable, accessible et appropriable par les praticiens. Cette perspective du transfert, qui repose sur une distinction implicite entre recherche fondamentale et recherche appliquée84, concentre l’attention sur les modalités de valorisation de la recherche. Entendu de cette manière, le savoir est actionnable si une chaîne de « dissémination des connaissances » (Starkey et Madan, 2001) est maintenue afin de combler le fossé entre théories et pratiques. L’actionnabilité renvoie au travail de mise en forme, de calibrage, de traduction ou de réduction de la complexité des connaissances produites par les recherches fondamentales afin que ces dernières soient appropriables par les acteurs du terrain. Il s’agit alors de disséminer une connaissance appliquée et utile aux les managers permettant d’améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise et de ses processus de décision (Davenport et Prusak, 1999; Starkey et Madan, 2001). Une des solutions envisagées est alors de développer des lieux et des acteurs de valorisation (des ‘knowledge brokers’) qui permettent de porter à la connaissance des praticiens l’existence de recherches pertinentes et actionnables.