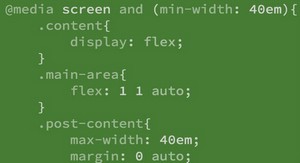Le dispositif d’analyse des discours mis en place
Une fois les discours des répondants collectés, nous avons développé deux angles d’analyse, horizontal et vertical.
Sous l’angle horizontal, il s’agissait de prendre l’ensemble des discours des chargés de mission comme constitutif, au moment de l’étude, du discours d’A.L.E.X.I.S. sur ses pratiques. Pour ce faire, nous avons agrégé les discours pour les soumettre à des analyses textuelles à l’aide du logiciel TROPES. Cet agrégat textuel ne peut donc être directement interprété comme la représentation partagée d’A.L.E.X.I.S.. Ce n’est qu’à l’aide du traitement lexicologique, en identifiant les références et les relations fréquentes qu’on espère esquisser ce qui constitue au moins le cœur de la représentation collective d’A.L.E.X.I.S. sur l’accompagnement des porteurs de projet issus de l’immigration.
Cette représentation est ensuite confrontée à celle d’autres intervenants, en particulier celle d’Africum-Vitae200.
Africum-Vitae a été créée en septembre 1998 par des ressortissants africains et des français sensibles aux problèmes du développement et de l’intégration socio-économique et culturelle. Elle oeuvre « pour le mélange des cultures, la valorisation des compétences de chacun et l’échange des savoirs entre continents » et accompagne des porteurs de projet majoritairement africains ayant un projet de création d’entreprise sur leur continent d’origine.
Nous avons également utilisé le discours d’Africum-Vitae pour y étalonner les discours individuels des chargés de mission d’A.L.E.X.I.S. C’était là l’un des objets de l’analyse verticale.
200 En confrontant la représentation discursive d’A.L.E.X.I.S. à celle d’Africum-Vitae identifiée par les réponses de son président à nos questionnements, il s’agissait de mettre en opposition le discours d’un organisme d’accompagnement de type générique (A.L.E.X.I.S.) et celui d’un organisme d’accompagnement ultra-spécialisé (Africum-Vitae).
Sous l’angle vertical, il s’agissait, en effet, d’identifier l’existence de différences de stratégies et de représentations selon les chargés de mission au sein de la structure.
Par la suite, ces stratégies individuelles étaient positionnées par rapport au discours d’Africum-Vitae et par rapport au discours collectif résultant de l’analyse horizontale. Ce positionnement cartographique tient lieu d’analyse transversale ou diagonale.
Pour les analyses horizontales et verticales, différentes méthodes d’analyse de discours ont été utilisées avec des visées différentes, comme le résume le tableau 6.1. Il s’agit des méthodes lexicologiques et logico-syntaxiques classiques qui ont été employées dans les deux perspectives, d’une méthode d’analyse discursive par recodage qui a été appliquée aux discours individuels et enfin, d’une analyse des distorsions cognitives. Ces deux dernières méthodes s’apparentent à l’analyse thématique à la nuance près que nous avions défini les thèmes préalablement au travail d’analyse201.
Les résultats de l’analyse horizontale
Dans un premier temps, l’analyse horizontale vise, à l’aide du logiciel TROPES, à identifier quels traits se dégagent du discours agrégé des chargés de mission d’A.L.E.X.I.S. (6.1.3.1.). Puis, ces résultats seront comparés au discours du Président d’Africum-Vitae (6.3.1.2), la comparaison permettant d’esquisser une carte des stratégies d’accompagnement sur laquelle seront ensuite positionnées les stratégies individuelles issues de l’analyse verticale.
Une conscience pro-active forte et un prisme sur les difficultés linguistiques.
Du fait de notre double questionnement adressé aux conseillers d’A.L.E.X.I.S., nous disposions finalement de deux discours agrégés, l’un, positif (comment faire pour qu’un accompagnement de porteurs issus de l’immigration réussisse ?) et l’autre qui traitait la même problématique par la négative. Cela devait nous permettre d’apprécier la robustesse de nos observations.
Nous avons, en effet, appliqué une analyse lexicologique et une analyse logico-syntaxique sommaire sur les deux discours.
Sur le premier discours, il fût avéré que la prise en charge par le locuteur était très forte. Celle-ci se matérialisait par des formulations très actives comme [« Considérer que les chances de voir aboutir un projet sont pas liées à son origine géographique »] ou encore [« lui expliquer…. »]. Ce phénomène n’était vérifié ni dans le discours par la négative, ni
dans le discours d’Africum-Vitae. Si l’on en croit les travaux de CASTEL et LACASSAGNE (1993) et CASTEL (1999) déjà cités, c’est une confirmation supplémentaire et rassurante de l’absence de discours raciste à A.L.E.X.I.S..
Mais l’essentiel des résultats pour notre travail tenait à la nature des références utilisées. Le logiciel TROPES identifiant les mots ou associations de mots revenant plus de deux fois dans l’ensemble du discours, l’identification des références utilisées dans le discours agrégé permettait de pointer les aspects sur lesquels, collectivement, l’équipe d’A.L.E.X.I.S. était la plus sensible concernant l’accompagnement de porteurs de projet issus de l’immigration. Dans le premier discours, quatre références furent ainsi recensées :
-la langue (5 fois) avec une référence récurrente aux « problèmes de langue » ou à la nécessité d’ «avoir un traducteur » ;
-la création (4 fois) : [« faire comme pour chaque créateur » ; « dérouler la méthodologie de la création comme à un autre créateur » ; etc.] ;
-la cognition (4 fois) : [« lui montrer de la compréhension » ; « s’adapter à son niveau de compréhension » ; « identifier ses capacités » ; « transmettre le savoir-faire entrepreneurial »] ;
-la personne (4 fois) : [« avoir le même comportement que pour une personne lambda » ; « mettre la personne en confiance » ; « respecter la personne » ; « l’accueillir comme une personne non issue de l’immigration »].
Ces observations soulignant que la représentation collective des difficultés d’accompagnement de porteurs de projet issus de l’immigration mettait l’accent sur les problèmes linguistiques furent confirmés par l’étude du deuxième discours dans lequel six références émergèrent de l’analyse: le comportement (10 fois)202, le problème (9 fois)203, la langue (5 fois)204, la personne (3 fois), l’immigration (3 fois) et l’information (3 fois).
Seule une relation émergea de notre analyse et elle vint confirmer les observations précédentes. TROPES identifia une relation205 entre [Problème] et [langue]. [« Barrage de la langue »] fut mis en relation avec [ « (…) que son origine va être un frein à la création d’entreprise (par exemple par le biais de sa difficulté de manier la langue) »].
Mis à part le prisme sur les problèmes linguistiques, ces analyses démontraient aussi l’implication que les chargés de mission se reconnaissaient dans la définition des conditions de réussite ou d’échec de l’accompagnement de publics spécifiques. Mais cette implication n’était pas univoque puisqu’elle devait implicitement générer un retour. La manifestation de compréhension à l’égard d’autrui, l’adaptation à son niveau de compréhension, appellent en effet une réaction de sa part et induisent implicitement un processus interactif. L’attitude pro-active qui en découle confirme notre postulat initial. On ne peut modéliser l’accompagnement des porteurs uniquement dans les termes statiques d’une offre et d’une demande. La relation qui s’y joue est un processus cognitif complexe. C’est d’ailleurs cette complexité cognitive qui justifie l’existence de dispositifs très différents. Si cette thèse est vraie, le discours d’Africum-Vitae diffèrera fortement de celui d’A.L.E.X.I.S..
Deux conventions pour l’action et sa justification
Du fait de sa taille plus réduite, le discours d’Africum-Vitae fut moins porteur pour l’analyse textuelle. Trois références en émergèrent, mais il ne fut pas possible de lui appliquer une analyse logico-syntaxique significative par le biais du logiciel. En reprenant les propositions remarquables que le logiciel identifiait du discours, nous avons donc opéré une comparaison logico-syntaxique manuelle.
[L’entreprise] (7 fois), [le projet] (7 fois) furent des références guère surprenantes du discours d’Africum-Vitae. [La vie] (7 fois) constituait la troisième référence émergente. Elle renvoyait bien au-delà du projet entrepreneurial comme l’illustrent les trois citations associées :
-« (….) qu’il est le seul maître à bord et de son destin» ;
-« trouver les réponses appropriées aux problèmes détectés dans le parcours de sa vie » ;
-« qu’il parvienne à maîtriser les différents aspects de la vie de l’entreprise » .
Ces références étaient renforcées par la proposition remarquable suivante : « bien cerner le projet personnel qui motive le projet d’entreprise ».
Les autres propositions remarquables portaient davantage sur l’expertise et la technique de l’accompagnement (par exemple : « lui assurer une formation adaptée »).
La contextualisation du discours est évidente. Comme le GRDR, Africum-Vitae accompagne nombre de porteurs de projet qui envisagent un retour au pays, que ce retour soit voulu dans une optique de co-développement ou qu’il soit subi. Le projet marque pour son porteur un tournant radical de vie obligeant les conseillers de l’association à un travail plus marqué sur le parcours de vie. D’ailleurs, on peut penser, à la suite de GALLIOT (2000), que le projet de retour au pays n’est pas sans analogie avec le projet de création d’activité. Les motivations sont parfois proches. Aussi, lorsque les deux se conjuguent, la difficulté technique et psychologique est décuplée. Tout comme nos travaux ont souligné que la création par des porteurs issus de l’immigration était parfois une issue par dépit à une situation sociale défavorable, d’autres fois une issue à une situation irrégulière206 et d’autres fois encore, une réponse altruiste à des besoins familiaux207, D. GALLIOT (op. cit., p. 73) notait que « le retour est le plus souvent envisagé par dépit » chez des migrants, las de ne pas parvenir à s’insérer dans la société française208. Elle ajoutait ensuite (p.74) qu’il était aussi la conséquence fréquente d’une situation irrégulière que celle-ci ait donné lieu ou non à une mesure d’expulsion et qu’il pouvait également répondre à des raisons familiales (p.76)209.
Une association spécialisée dans la migration et confrontée à la problématique du retour est donc tout particulièrement apte à l’étude des parcours de vie. Sans doute cet axe du discours d’Africum-Vitae devrait-il constituer une interpellation managériale pour des travaux ultérieurs et pour l’équipe d’A.L.E.X.I.S., puisqu’il pourrait faire écho aux difficultés observées au sein de cette structure dans l’accompagnement de projets tournés vers le Sud210 et à la proposition GP 12 bis que nous avons formulée au chapitre précédent et que nous rappelons avant de formuler une nouvelle proposition pour l’action, la proposition GP 14.
Rappel de la Proposition GP 12 Bis: L’accompagnement générique proposé par A.L.E.X.I.S. serait moins efficace (au sens des propositions précédentes) pour des projets (initialement) tournés vers le Sud.
Proposition GP 14: Un dispositif comme A.L.E.X.I.S. pourrait gagner en efficacité pour des projets tournés vers le Sud en adoptant une stratégie d’accompagnement beaucoup plus ancrée sur l’histoire de vie de l’individu.
Une telle perspective serait toutefois particulièrement coûteuse en temps et sans doute en formation pour les chargés de mission. Un partenariat avec des organismes tel qu’Africum-Vitae, le GRDR ou le Collectif des Femmes de Louvain sur de tels projets serait peut-être tout aussi bienvenu.
206 C’est le cas de Jean-Marie S. (Cas 28) qui a créé sa société alors qu’il était en situation de fin de séjour au niveau administratif, suite à l’obtention de son doctorat. Son objectif premier était « d’éviter les tracasseries administratives ». Jean-Marie S. a su monter un projet suffisamment attractif pour lui valoir l’obtention de la carte de « commerçant étranger » (distribution de cartes téléphoniques aux particuliers). Comme le notent LANOUX, LEVY, NKAKLEU (2004, p. 20), « En quelque sorte, son entreprise est devenue son visa ».
En revanche, l’association Africum-Vitae n’est pas confrontée aux mêmes difficultés linguistiques qu’A.L.E.X.I.S. dans l’accompagnement.
Ces éléments contextuels étant posés et neutralisés, la différence fondamentale entre les deux discours porte sur la légitimation de l’action d’accompagnement.
N’ayant pas à justifier de sa capacité de compréhension et d’ouverture à l’interculturel, le Président d’Africum-Vitae n’en fait pas mention dans son discours et opte, au contraire, pour un recentrage sur le potentiel technique qu’il déploie lors de l’accompagnement. On a pu identifier dix propositions remarquables s’y rapportant. Au contraire, le discours d’A.L.E.X.I.S. est peu disert sur cet aspect211 et se focalise sur la dimension interculturelle de l’accompagnement. L’étude logico-syntaxique des adjectifs utilisés révèle ainsi que les deux qui sont récurrents dans le discours sont [technique] et [culturel]. Le premier est exclusivement utilisé négativement en évoquant le fait que la technique est naturelle et implicite chez les conseillers (« être trop vite technique » ; « utiliser un jargon trop technique »). Le second semble évoquer la vigilance que se doit de conserver le conseiller d’A.L.E.X.I.S. en cours d’accompagnement (« l’erreur serait de ne pas tenir compte de leurs particularités culturelles » ; « éviter le blocage culturel » ; « faire attention à l’incompréhension culturelle »). Ces éléments discursifs rappellent la référence à « la personne » qui était récurrente dans les deux discours agrégés d’A.L.E.X.I.S. et autorisent l’énoncé d’une proposition d’étape permettant de décrire l’accompagnement des porteurs de projet issus de l’immigration à A.L.E.X.I.S. en dépassant l’approche basique en termes d’offre et de demande. Cette proposition n’est, pour l’heure, fondée que sur le discours agrégé que nous avons analysé.
Proposition GP 15 : De manière collective, les Chargés de mission réalisent (plus ou moins suivant les individus) un travail d’accommodation au cours de l’accompagnement de porteurs issus de l’immigration en réalisant un double passage du porteur de projet à la personne, cette dernière étant définie par son histoire et par son héritage culturel, et de la simple logique de la compétence à celle de la confiance.
Moins anodine qu’il n’y parait, cette proposition fait écho à nos constats précédents qui, à première vue, débouchent sur deux modes de justification d’une action identique, l’accompagnement de porteurs de projet, et pourraient sembler paradoxaux.
L’organisme spécialisé (Africum-Vitae) véhicule un discours de justification plutôt « technique », l’étude des parcours de vie semblant s’inscrire par nécessité dans l’étude technique des projets. Au contraire, contre toute attente, l’organisme générique (A.L.E.X.I.S.) véhicule un discours de légitimation centré sur « la personne ».
En suivant les travaux de BOLTANSKI et THEVENOT (1987, 1991) et conformément à nos propos dans ce travail, ces deux discours de légitimation s’assimilent aisément alors à la convention industrielle pour la première et à la convention domestique pour la seconde. L’accompagnement est apprécié à l’aune de standards techniques dans la première, comme
« une formation bien adaptée », dans le discours d’Africum-Vitae, selon une logique de compétence. Il est apprécié à l’aune de la confiance dans la seconde, comme le montre THEVENOT (1989, p. 184 et suivantes).
Nous disposons bien de deux conventions alternatives pour guider les chargés de mission dans leur action d’accompagnement. Il est temps de voir comment individuellement, à partir de leurs discours, ils se positionnent.
L’identification de stratégies individuelles différenciées
Afin de voir comment les acteurs, sur le terrain et dans leur discours, s’approprient ou aménagent ces deux conventions, nous avons d’abord identifié six attitudes possibles qui nous ont permis de recoder les discours. A partir de ce travail présenté dans le premier paragraphe (6.1.4.1), quatre profils d’accompagnants ont pu être identifiés. Pour les valider, nous avons cherché à voir si ces profils sous-tendaient des distorsions cognitives différentes de la part de leur porteur (6.1.4.2), puis nous avons croisé ces profils avec les résultats d’analyses lexicologiques et logico-syntaxiques classiques (6.1.4.3). Le dernier paragraphe de la section (6.1.4.4) confronte les résultats obtenus avec ceux issus de l’analyse horizontale, présentés à la section précédente.