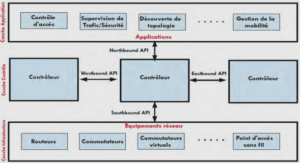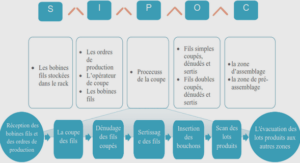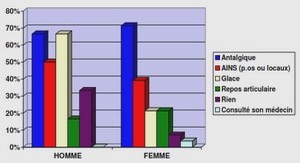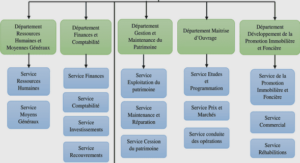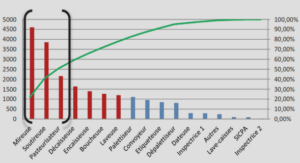La route qui rejoint Ubud est particulièrement belle. Je ne l’avais pas réalisé à l’aller, préoccupé que j’étais par le souci de trouver mon chemin. Très sinueuse, elle traverse par endroits de petits champs bordés de bananiers sauvages, entrecoupés çà et là par un ruisseau. Cette région vallonnée du centre de l’île est en permanence soumise à des alternances de soleil et de pluie, une pluie chaude qui exalte les odeurs de la nature. Ce climat est propice à l’explosion d’une végétation tropicale luxuriante.
Au détour d’un virage, je vis trois Balinais au bord d’un champ, à quelques mètres de la route. Ils devaient avoir entre vingt et trente ans, le corps svelte, et… entièrement nus. J’étais très surpris de leur apparition inattendue. Je n’avais d’ailleurs pas connaissance d’une absence de pudeur dans la culture balinaise. Venaient-ils de se baigner après une journée de labeur dans les champs ? Ils se déplaçaient sereinement, marchant côte à côte. Nos regards se croisèrent lorsque j’arrivai à leur hauteur. Je n’ai pas réussi à interpréter l’expression bizarre que j’y ai lue. Étaient-ils confus de me croiser sur cette route peu fréquentée ? Avaient-ils perçu ma surprise devant leur nudité ?
Ma route continuait et, à l’approche dUhud, traversait des petits villages. L’habitat révélait une certaine pauvreté, et pourtant les rues étaient toujours soignées, propres et très fleuries. Devant chaque porte, on voyait en permanence, déposées sur le sol, des offrandes constituées de fleurs ou de quelques mets recueillis sur des fragments de feuilles de bananiers entrelacés. Ces offrandes étaient régulièrement renouvelées tout au long de la journée.
Les Balinais vivent dans le sacré. Leur religion ne repose pas sur une pratique codifiée heure fixe, ou certains jours de la semaine. Non, eux sont en contact direct avec les dieux. Ils semblent imbibés de leur foi, habités par elle en permanence. Toujours calmes, doux, souriants, ils sont sans doute, avec les Mauriciens, le peuple le plus gentil de la terre. D’humeur constante, on a l’impression que rien ne peut les déstabiliser. Ils accueillent avec la même sérénité tout ce qui leur arrive.
Bali fait immanquablement songer au paradis à tous ses visiteurs, et ceux-ci seraient sans doute surpris d’apprendre que ce mot n’existe pas en balinais. Le paradis est l’élément naturel des Balinais, et ils n’ont pas plus de mot pour le désigner que les poissons ne doivent en avoir pour désigner l’eau qui les entoure.
Je repensais à ma rencontre avec le guérisseur, et je me sentais encore envoûté par notre échange. Cet homme avait une aura particulière, une énergie qui émanait naturellement de sa personne. J’étais assez excité par ce qu’il m’avait fait découvrir, même si ses propos m’avaient parfois décontenancé. Et je n’avais jamais imaginé que je me retrouverais un jour à l’autre bout du monde, écoutant un vieux sage balinais me commenter les seins et les fesses de Nicole Kidman.
A la sortie d’Ubud, je bifurquai vers l’est pour rentrer chez moi. La journée avait été riche en émotions et j’éprouvais le besoin de rester un peu seul pour laisser décanter tout ce que j’avais découvert. Il me faudrait moins d’une heure pour arriver dans ce petit village de pêcheurs de la côte est où j’avais loué un bungalow posé en bordure d’une jolie plage sauvage de sable gris. Par bonheur, les touristes préféraient les étendues de sable blanc du sud de l’île, si bien que très rares étaient ceux que je croisais sur « ma » plage. Seul un couple de Hollandais avait élu résidence un peu à l’écart. Ils n’étaient pas désagréables, et je les croisais rarement. Mon bungalow appartenait à une famille qui habitait plus loin dans les terres. Je l’avais loué pendant un mois pour une somme très acceptable pour moi, très profitable pour eux : j’aime les situations où tout le monde est gagnant. La plage restait déserte le matin, puis quelques enfants du village venaient y jouer l’après-midi. Les seuls passages étaient ceux des pêcheurs, que j’entendais parfois sortir en mer dans leurs pirogues à cinq heures du matin. Je les avais accompagnés une fois, même si, ne parlant pas balinais, il m’avait été difficile de me faire comprendre et donc d’obtenir leur accord.
Cela restait l’un de mes plus beaux souvenirs de Bali. Nous étions partis avant l’aube, et je ne m’étais guère senti rassuré à bord de cette pirogue instable, assis au ras de l’eau, ne voyant pratiquement rien dans le noir d’une nuit sans lune. Mais les pêcheurs connaissaient leur métier, et j’avais ce jour-là expérimenté ce qu’était la confiance, une confiance aveugle en l’occurrence. Le clapotis de l’eau et la fraîche brise effleurant mon visage étaient presque les seuls éléments que mes sens en éveil pouvaient capter. Trois quarts d’heure plus tard, j’avais vu le soleil apparaître lentement à l’horizon, comme un projecteur qui illuminerait une scène au ras du sol, faisant d’un seul coup exister un décor grandiose, immense, magique. Je découvrais tout à la fois la démesure de la mer, le gigantisme du ciel, et la petitesse de la pirogue qui semblait flotter par magie au-dessus d’un abîme sans fond, telle une allumette posée sur l’océan. Je découvrais aussi les sourires des pêcheurs, et m’étais soudain senti heureux sans savoir pourquoi.
Sur le trajet du retour, nous avions vu quelques dauphins à proximité de la pirogue, et j’avais manifesté le désir de plonger à leur côté, avec le réflexe idiot de l’Occidental qui a visité trop de parcs d’attractions. Les Balinais m’en avaient empêché, me faisant comprendre tant bien que mal que des dauphins nageant en surface pouvaient être suivis en profondeur par des requins à la poursuite du même banc de poissons. L’argument avait suffi à me convaincre, et je m’étais contenté d’admirer visuellement ces beautés de la nature, libres de leurs mouvements, libres de leurs destinations, libres de leurs vies.
Je m’arrêtai sur la route pour manger un nasigoreng dans une échoppe, plat typique à base de riz, comme pratiquement tous les plats balinais. Au bout de quatre semaines, la seule vision du riz suffisait presque à me faire perdre l’appétit. J’arrivai à mon bungalow à la tombée de la nuit, moment idéal pour aller marcher sur la plage sans croiser âme qui vive. Je me mis pieds nus et m’y rendis directement. Comme prévu, la plage était déserte et je me promenai longuement au bord de l’eau. le pantalon retroussé.
Rapidement, mon esprit vagabond revint sur ma rencontre avec le guérisseur, et je repensai à tout ce qu’il m’avait fait découvrir. Ainsi, nous autres humains avions développé des croyances sur nous-mêmes en raison de l’influence de personnes de notre entourage ou de conclusions inconsciemment tirées de notre vécu. Je voulais bien l’admettre, mais, dans ce cas, jusqu’où s’étendaient ces croyances ? Nous avions vu que l’on pouvait se croire beau ou laid, intelligent ou stupide, intéressant ou ennuyeux. On pouvait croire en sa capacité d’influence ou, au contraire, se croire incapable d’obtenir quoi que ce soit des autres. Dans quels autres domaines pouvait-on développer des croyances ? Je comprenais que l’on puisse croire en un certain nombre de choses, et que ces croyances aient ensuite un effet sur notre vie. Mais jusqu’où ? Je me demandais en quoi mes propres croyances avaient influencé le cours de mon existence, et en quoi, en fonction du hasard des rencontres et de mes expériences, j’aurais pu croire d’autres choses qui auraient ensuite donné une direction différente à ma vie.
Mes interrogations avaient pour seule réponse le bruissement de l’eau sous mes pieds, qui éclaboussait le silence de la plage déserte. Les palmiers qui la bordaient étaient parfaitement immobiles ; aucun vent ne soufflait dans leurs branches délicates. J’avais pris l’habitude de me baigner tous les soirs. Je quittai mon pantalon et mon tee-shirt, et me laissai glisser dans l’eau tiède de la mer. Je nageai longuement sans plus penser à rien, sous le regard bienveillant de la lune naissante.
Je me réveillai après un sommeil particulièrement profond et découvris que le soleil était déjà haut dans le ciel. Je pris quelques fruits en guise de petit déjeuner tardif et m’en allai pour une promenade matinale dans le petit bois qui s’étend derrière la plage. En arrivant à proximité du bungalow de Hans et Claudia, le couple de Hollandais, je reconnus leurs voix.
– Le déjeuner n’est pas encore prêt ? dit Hans, assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux.
Il avait les cheveux gris foncé, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces.
– Bientôt, mon chéri, bientôt.
Claudia était une femme douce et gentille, la quarantaine, le visage tout en rondeurs encadré de jolies boucles blondes.
Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d’un barbecue.
– Tu utilises trop de charbon de bois, ça sert à rien, c’est gâché.
Il disait cela sans réaliser que c’était un reproche. Pour lui, c’était un fait, c’est tout.
– Mais sinon, ça cuit trop lentement, se justifiait-elle.
La dernière fois que je les avais croisés. Claudia nettoyait le bungalow pendant que Hans lisait son fichu livre. Je me demandais ce qui pouvait amener une femme à accepter d’endosser le rôle de la ménagère au XXIème siècle. Hans n’était pas un macho au sens où on l’imagine. Pour lui, c’était probablement juste « normal» que sa femme s’occupe de cela. La question n’avait sans doute même pas été débattue entre eux. C’était ainsi.
– Tiens, Julian, quel plaisir de te voir ! me dit-elle en m’apercevant.
– Bonjour, Julian, dit Hans.
– Bonjour.
– Voudrais-tu partager un poisson avec nous ? proposa-t-elle. Hans haussa imperceptiblement un sourcil.
– Non, merci, je viens de prendre mon petit déjeuner…
– Tu viens seulement de te lever ? demanda Hans. Nous, on a déjà fait deux visites, ce matin : le temple de Tanah Lot et le musée Subak, à Tabanan.
– C’est bien, félicitations.
Il ne saisit même pas l’ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutent les mots, mais ne décodent ni le ton de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce.
– Tu visites peu de choses, j’ai l’impression. Cela ne t’intéresse pas ?
– Si, mais j’aime surtout ressentir les ambiances, me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place et de sentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi.
– Julian aime découvrir la culture de l’intérieur; toi, chéri, tu préfères comprendre la culture dans les livres, dit Claudia.
– Oui, c’est plus rapide, on gagne du temps, renchérit Hans.
J’acquiesçai. À quoi bon argumenter ? À chacun sa façon de voir les choses.
- Friday
- April 25th, 2025
- Ajouter un cours