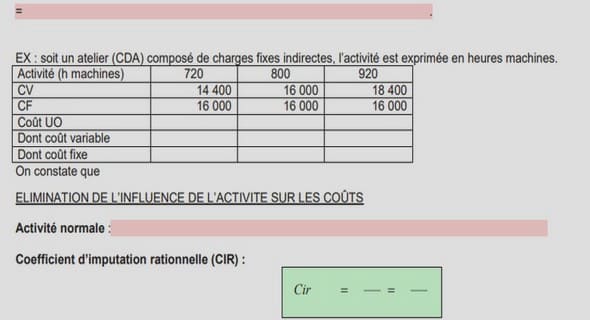L’homme qui désirait de l’or
Bansir, le fabricant de chars de la ville de Babylone, était complètement découragé. Assis sur la muraille qui entourait sa propriété, il regardait tristement sa modeste maison et son atelier dans lequel se trouvait un char inachevé.
Sa femme se rendait souvent à la porte. Elle jetait un regard furtif dans sa direction, lui rappelant qu’il ne leur restait presque plus de nourriture et qu’il devrait plutôt être en train de finir le char, c’est-à-dire de clouer, tailler, polir et peindre, d’étirer le cuir sur la roue, préparant ainsi le char pour la livraison afin d’être payé par son riche client.
Cependant, son corps gras et musclé restait immobile, appuyé contre la muraille. Son esprit lent se butait à un problème auquel il ne trouvait aucune solution. Le chaud soleil tropical, si typique de la vallée de l’Euphrate, s’abattait sur lui sans merci. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et tombaient sur sa poitrine velue.
L’HOMME LE PLUS RICHE DE BABYLONE
En arrière-plan, sa maison était dominée par les hauts murs en terrasses qui entouraient le palais royal. Tout près de là, la tour peinte du Temple de Bêl se découpait dans le bleu du ciel. Dans l’ombre d’une telle majesté se dessinaient sa modeste maison et plusieurs autres, beaucoup moins propres et soignées.
Telle était Babylone : un mélange pêle-mêle de somptuosité et de simplicité, d’éblouissante richesse et de terrible pauvreté, à l’intérieur de ses murs.
S’il avait pris la peine de se retourner, Bansir aurait remarqué les bruyants chars des riches qui bousculaient et repoussaient les commerçants en sandales aussi bien que les mendiants aux pieds nus. Même les riches étaient forcés de marcher dans les rigoles pour libérer le chemin aux longues lignées d’esclaves et de porteurs d’eau « au service du roi». Chaque esclave transportait une lourde peau de chèvre remplie d’eau qu’il versait sur les jardins suspendus.
Bansir était trop absorbé par son propre problème pour entendre ou prêter attention au vacarme confus de la ville achalandée. Ce furent les sons familiers d’une lyre qui le tirèrent de sa rêverie. Il se retourna et vit la figure expressive et souriante de son meilleur ami – Kobbi, le musicien.
« Puissent les dieux te bénir avec une grande générosité, mon bon ami, dit Kobbi en faisant un grand salut. Mais il me semble qu’ils aient été si généreux que tu n’aies plus besoin de travailler. Je me réjouis de ta chance. Plus encore : je voudrais la partager avec toi. Prie que de ta bourse, qui doit être garnie puisque tu n’es pas en train de peiner dans ton atelier, tu puisses sortir seulement deux modestes shekels et me les prêter, jusqu’après le festin des hommes nobles, ce soir. Tu ne les perdras pas, ils te seront rendus.
— Sif avais deux shekels, répondit Bansir tristement, je ne pourrais les prêter à personne ; même pas à toi, mon meilleur ami, parce qu’ils seraient ma fortune, mon entière fortune. Personne ne prête toute sa fortune, même à son meilleur ami.
— Quoi ! s’exclama Kobbi vraiment surpris. Tu n’as pas un shekel dans ta bourse et tu restes assis comme une statue sur la muraille ! Pourquoi ne finis-tu pas ce char ? De quelle façon peux-tu assouvir ta faim ? Cela ne te ressemble pas, mon ami. Où est ton énergie débordante ? Y a-t-il quelque chose qui t’afflige ? Les dieux t’ont-ils causé des problèmes ?
— Ce doit être un supplice des dieux. Cela a commencé par un rêve ; un rêve insensé, dans lequel je me croyais fortuné. A ma ceinture pendait une belle bourse remplie de lourdes pièces. Je lançais des shekels aux mendiants avec une insouciante liberté, je me servais de pièces d’argent pour acheter des parures à ma femme et tout ce que je désirais pour moi-même ; j’avais aussi des pièces d’or, qui me rendaient confiant en l’avenir et libre de dépenser. Un merveilleux sentiment de satisfaction m’habitait. Tu ne m’aurais pas connu en tant que travailleur acharné. Pas plus que tu n’aurais vu ma femme ridée ; à la place, tu aurais vu son visage éclatant de bonheur. Elle souriait encore comme au début de notre mariage.
— Un beau rêve, en effet, commenta Kobbi, mais pourquoi des sentiments si plaisants devraient-ils te changer en statue sur la muraille ?
— Pourquoi, en effet ? Parce qu’à mon réveil, lorsque je me suis rappelé que ma bourse était vide, un sentiment de révolte m’a emporté. Parlons-en ensemble, comme disent les marins, nous voguons tous deux à bord du
même bateau. Etant jeunes, nous sommes allés chez les prêtres pour apprendre la sagesse. Devenus jeunes hommes, nous avons partagé les mêmes plaisirs. À l’âge adulte, nous avons toujours été de bons amis. Nous étions satisfaits de notre sort. Nous étions heureux de travailler de longues heures et de dépenser notre salaire librement. Nous avons gagné beaucoup d’argent durant les années passées, mais nous pouvons seulement rêver des joies de la richesse.
« Bah ! Sommes-nous de stupides moutons ? Nous vivons dans la ville la plus riche au monde. Les voyageurs disent qu’aucune autre n’égale sa richesse. Devant nous s’étale la richesse, mais de cette richesse, nous n’avons rien. Après avoir passé la moitié de ta vie à travailler ardemment, toi, mon meilleur ami, tu as une bourse vide et tu me dis : “Puis-je t’emprunter une somme aussi minime que deux shekels jusqu’après le festin des nobles, ce soir ?” Alors, qu’est-ce que je réponds ? Dois-je dire : “Voici ma bourse; j’en partage avec plaisir son contenu”? Non. J’admets plutôt que ma bourse est aussi vide que la tienne. Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ne pouvons-nous pas acquérir plus d’argent et d’or – plus que le nécessaire pour la nourriture et les vêtements ?
«Pensons aussi nos fils, ajouta Bansir, Ne suivent-ils pas les traces de leur père ? Devront-ils, avec leur famille et leurs fils et les familles de leurs fils, vivre au milieu de tous ces ramasseurs d’or et se contenter, comme nous, de boire du lait de chèvre sur et de manger de la bouillie ?
— Jamais, au cours de toutes nos années de franche camaraderie, tu n’as parlé ainsi, fit remarquer Kobbi, tout intrigué-
— Jamais, pendant toutes ces années, je n’ai raisonné ainsi. De l’aurore jusqu’à ce que la noirceur ne m’arrête, j’ai œuvré à fabriquer les plus beaux chars qu’un homme puisse concevoir, osant à peine espérer qu’un jour, les dieux reconnaîtraient mes bonnes actions et m’accorderaient une grande prospérité, ce qu’ils n’ont jamais fait. Finalement, je reconnais qu’ils ne le feront jamais. Donc, je suis triste. Je désire être riche, je veux posséder des terres et du bétail, jouir de beaux vêtements et remplir ma bourse d’argent. Je suis prêt à travailler pour tout cela de toutes mes forces, avec toute l’habileté de mes mains et l’adresse de mon esprit, mais je veux que mes peines obtiennent récompense. Qu’est-ce qui nous arrive ? Je te le demande encore ! Pourquoi n’avons-nous pas une juste part des bonnes choses si abondantes que les détenteurs d’or peuvent se procurer ?
— Si seulement je connaissais la réponse à cette question! répondit Kobbi. Je ne suis pas plus satisfait que toi. Tout l’argent que je gagne avec ma lyre est vite dépensé. Souvent, je dois planifier et calculer pour que ma famille ne souffre pas de la faim. Aussi, dans mon for intérieur, j’ai un désir profond de posséder une lyre assez grosse pour faire retentir la grandiose musique qui me vient à l’esprit. Avec un tel instrument, je pourrais créer une musique si suave que même le roi n’en aurait jamais entendu de pareille.
— Tu devrais avoir une telle lyre. Personne à Babylone ne pourrait la faire résonner mieux que toi, la faire chanter si mélodieusement. Non seulement le roi, mais les dieux eux-mêmes en seraient ravis. Mais comment pourrais-tu te la procurer quand tous les deux, nous sommes aussi pauvres que les esclaves du roi ? Ecoute la cloche ! Ils s’en viennent. »
Il pointa une longue colonne d’hommes à demi vêtus, les porteurs d’eau qui revenaient de la rivière, peinant et suant, par une rue étroite. Ils marchaient, cinq de front, courbés sous la lourde peau de chèvre remplie d’eau.
« L’homme qui les conduit a une belle apparence. » Kobbi indiqua l’homme qui agitait la cloche et marchait devant, sans charge.
«Un homme bien en vue dans son pays, c’est facile à voir.
— Il y a plusieurs bonnes têtes dans la filée, dit Bansir, aussi bien que nous. Des hommes grands et blonds du Nord, des hommes noirs et rieurs du Sud et des petits basanés des pays voisins. Tous marchent ensemble de la rivière aux jardins et vice versa, chaque jour de chaque année. Pour eux, il n’y a aucun bonheur à espérer. Ils dorment sur des lits de paille et mangent de la bouillie. J’ai pitié de ces pauvres bougres, Kobbi!
— J’ai pitié d’eux aussi. Mais cela me fait penser que nous ne sommes pas beaucoup mieux qu’eux, bien que nous nous disions libres.
— C’est vrai, Kobbi, mais je n’aime pas y penser. Nous ne voulons pas continuer d’année en année à vivre en esclaves. Travailler ! Travailler ! Travailler ! Et n’arriver 5 rien.
— Ne devrions-nous pas chercher à savoir comment les autres acquièrent l’or et faire comme eux ? demanda Kobbi.
— Il y a peut-être un secret que nous pourrions apprendre, si seulement nous nous efforcions de trouver ceux qui le connaissent, répondit Bansir pensivement.
— Aujourd’hui même, souligna Kobbi, j’ai croisé notre vieil ami Arkad à bord de son char doré. Il ne m’a même pas regardé; ce que plusieurs dans sa position peuvent considérer comme son droit. À la place, il a fait un signe de la main pour que les spectateurs puissent le voir saluer et accorder la faveur d’un sourire amical à Kobbi, le musicien.
— On le considère comme l’homme le plus riche de tout Babylone, dit Bansir.
— Si riche, dit-on, que le roi a recours à son or pour les affaires du Trésor, renchérit Kobbi.
— Si riche, l’interrompit Bansir, que si je le rencontrais la nuit, je serais tenté de vider sa bourse !
— C’est absurde ! rétorqua Kobbi. La fortune d’un homme n’emplit pas la bourse qu’il transporte. Une bourse garnie se vide vite sans rivière d’or pour l’alimenter. Arkad a un revenu qui garde continuellement sa bourse pleine, peu importe sa façon de dépenser.
— Le revenu, voilà ce qui importe, lança Bansir. Je désire un revenu qui continuerait d’alimenter ma bourse, que je m’assoie sur la muraille ou que je voyage dans les pays lointains. Arkad doit savoir comment un homme peut s’assurer un revenu de la sorte. Crois^tu qu’il pourrait expliquer cela à un esprit aussi lent que le mien ?
— Je pense qu’il a transmis son savoir à son fils Nomasir, répondit Kobbi. N’est-il pas allé à Ninive et, selon ce qu’on répète à l’auberge, n’est-il pas devenu, sans l’aide de son père, l’un des hommes les plus riches de cette ville ?
— Kobbi, ce que tu viens de me dire a fait surgu une idée brillante en moi. (Une nouvelle lueur parut dans les yeux de Bansir.) Il n’en coûte rien de demander un sage conseil à un bon ami et Arkad fut toujours un ami. Peu importe si nos bourses sont aussi vides que le nid du faucon de l’an passé. Ne nous laissons pas arrêter par cela. Nous nous inquiétons de ne pas avoir d’or, au milieu de l’abondance. Nous désirons devenir riches. Viens ! Allons voir Arkad et demandons-lui comment nous pouvons, nous aussi, acquérir des revenus pour nos propres besoins.
— Tu parles tel l’homme habité d’une inspiration véritable, Bansir. Tu apportes à mon esprit une nouvelle compréhension des choses. Tu me fais prendre conscience de la raison pour laquelle nous n’avons jamais eu notre part de richesse. Nous ne l’avons jamais cherchée activement. Tu as travaillé patiemment à construire les chars les plus solides de Babylone. Tu as concentré tous tes efforts à cette fin. Alors, tu as réussi. Je me suis efforcé de devenir un habile joueur de lyre. Et j’y suis parvenu.
« Là où nous avons tout mis en œuvre pour réussir, nous avons réussi. Les dieux étaient contents de nous laisser continuer ainsi. Maintenant, enfin, nous voyons une lumière aussi brillante que le lever du soleil. Elle nous ordonne d’apprendre plus pour devenir plus prospères. Avec un nouvel entendement, nous trouverons des façons honorables de combler nos désirs.
— Allons voir Arkad aujourd’hui, reprit Bansir. Allons aussi inviter nos amis d’enfance qui n’ont pas mieux réussi que nous, à se joindre à nous, pour partager les fruits de cette sagesse.
— Tu es un ami vraiment attentif, Bansir. C’est pour ça que tu as beaucoup d’amis. Nous ferons comme tu dis. Nous y allons aujourd’hui et nous les amenons avec nous. »