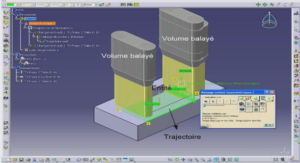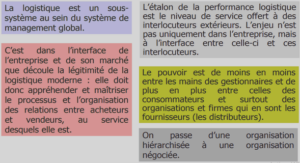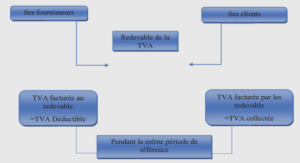Les rares humains survivants immédiats à l’irradiation massive des bombardements atomiques de 1945 à Hiroshima et Nagasaki ont évolué des signes d’anémie, des infections graves par défaut immunitaire et des hémorragies incoercibles, liées à la disparition des plaquettes sanguines indispensables à la coagulation. L’étude de leur moelle osseuse, siège de la production habituelle des globules sanguins et des plaquettes, la révéla désertée de toute cellule hématopoïétique: c’était l’aplasie de la moelle dont sont morts secondairement tous les humains massivement irradiés.
C’est à partir de ce sinistre constat et de la comparaison avec la biologie d’individus normaux que des travaux scientifiques plus poussés ont pu mener chez des adultes humains :
− au concept de cellules « souches », capables de se diviser en cas de diminution du taux des cellules circulantes et de donner des lignées de cellules filles. Par un message intercellulaire, chaque division de cellule souche permet de maintenir constant le capital global des cellules et celui des cellules souches. [4]
− au concept de capacité de régénération cellulaire de la peau et du foie enparticulier. [4]
− au concept de transfert par transfusion des cellules souches médullaires .
Depuis quelques années, les chercheurs ont établi encore la présence de cellules souches dites adultes ou somatiques dans plusieurs autres tissus et organes du corps tels que l’intestin, le système nerveux central, le muscle… Cela suppose qu’il en existe dans tous les organes même dans ceux où on ne les a pas encore localisées tels que, le rein ou le poumon…
Tandis que la recherche sur les cellules souches embryonnaires est au coeur de l’actualité scientifique biomédicale du fait de leurs propriétés tout à fait exceptionnelles et en raison des débats éthiques que les méthodes de leur récolte soulèvent. Elle implique une intervention sur l’embryon qui est nécessairement destructrice et dont la portée symbolique ne manque pas de soulever des interrogations éthiques.
Quelques dates importantes ont marqué l’avancée spectaculaire de la recherche sur les cellules souches humaines.
1950-1960 :le concept de cellules souches adultes (CSA) est avancé pour rendre compte du renouvellement du sang et de la peau. [5]
1961 : découverte des premières cellules souches sanguines. [5]
1964 : découverte de cellules souches dans les carcinomes embryonnaires. [5]
1968 : première greffe de moelle osseuse. [5]
1981 : isolement et culture des cellules souches embryonnaires (ES) de souris. [7]
1994: isolement de cellules de la masse cellulaire interne (ICM) de blastocystes humains et leur maintien en culture. [8]
1995 : isolement des lignées de cellules souches embryonnaires de primateCescellules souches embryonnaires sont diploïdes et ont un caryotype normal.
Elles sont pluripotentes et se différencient en types cellulaires dérivés de tous les trois feuillets primordiaux. On constate que les cellules souches embryonnaires de primates ressemblent aux cellules souches de carcinomes embryonnaires humaines et permettent de penser qu’il pourrait être possible de produire et de maintenir en vie des cellules souches embryonnaires humaines in vitro. [9]
1998-2000 : Production de cellules souches embryonnaires humaines à partir de la masse cellulaire interne de blastocystes cédés par des couples inscrits en FlV. On a constaté que les cellules souches embryonnaires prolifèrent in vitro sur des périodes prolongées tout en conservant un caryotype normal. Ces cellules se différencient spontanément en lignées cellulaires somatiques issues des trois feuillets primordiaux et forment des tératomes quand on les injecte dans des souris immunodéficientes. [6 ,10]
2000 : production de cellules souches embryonnaires humaines et leur différenciation en neurones. [11]
2003 : production de cellules souches embryonnaires humaines à partir de dents de lait humaines tombées naturellement. [12]
2004 : cellules souches embryonnaires humaines ont été obtenues par transfert du noyau d’une cellule somatique d’une femme dans son ovule anucléé. [13]
2005 : Obtention de cellules souches embryonnaires humaines par transfert du noyau d’une cellule somatique de malade dans son ovule anucléé [13].
2006 : Obtention de cellules souches embryonnaires humaines à partir d’embryons humains considérés comme morts naturellement [13].
Les recherches menées actuellement portent sur les mécanismes de communication intercellulaire, sur les mécanismes de différenciation et de spécialisation cellulaire. On étudie également les conditions de récolte de ces cellules souches, leur mise en culture, leur prolifération, et leur administration locale ou systémique. Ces travaux visent la maitrise du potentiel régénérateur de ces cellules pour que de nombreuses applications thérapeutiques majeures pourraient voir le jour et permettraient des réparations tissulaires et organiques potentiellement vitales. C’est le fondement de la médecine régénératrice.
INTRODUCTION |