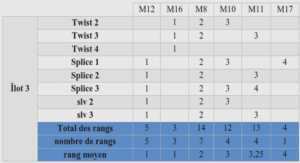L’évolution de l’art dans l’espace public
Avant toute chose, il est nécessaire de définir avec précision la notion d’espace public. En effet, ce terme polysémique sera fréquemment évoqué tout au long de ce document, or cette notion ne possède pas de définition rigoureuse. Tout d’abord, si l’on se référé au Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, l’espace public peut être défini de manière simple « comme l’espace ressortissant strictement à la sphère publique, c’est-à-dire tout espace n’appartenant pas à une ‘personne morale de droit prive’ »1. L’espace public est donc caractérisé par « les rues, les trottoirs, places jardins, parcs, mais aussi délaissés de voirie, terrains vagues, parkings etc »2. Se pose alors la question des espaces clos appartenant à la puissance publique qui sont alors exclus. Et à l’inverse, de nombreux espaces souvent considérés comme publics car ils accueillent de nombreuses personnes pouvant avoir des interactions sociales, sont en fait des lieux privés. C’est le cas par exemple des centres commerciaux. L’espace public y est également définit comme étant un « espace accessible à tous »3. Dans le Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, l’espace public est considéré comme étant « la partie du domaine public non bâti, affectée à des usages publics ». Ici, l’espace public est donc formé « par une propriété et par une affectation d’usage »4. Cette définition générale ne pose plus les limites de la définition fournie par le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Thierry Paquot, philosophe, professeur des universités à l’Institut d’urbanisme de Paris, a également tenté d’en donner une définition. Selon lui, il faut distinguer « l’espace public » des « espaces publics ». Alors qu’au singulier l’espace public désigne « la sphère du débat politique, la publicité des opinions correspondent depuis une trentaine d’année en France « au réseau viaire, rues et boulevards, places et parvis, parcs et jardins, bref à toutes les voies de circulation qui sont ouvertes au public»..
Le sens du mot « art », a beaucoup varié au cours du temps. Ainsi, l’art est un mot ancien qui dispose de plusieurs sens, les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les lieux, et aucune d’entre elles n’est universellement acceptée. De plus, les innovations artistiques du XXe siècle rendent l’art plus difficile à définir. Il est possible de citer les « Ready Made » de Marcel Duchamp pour lesquels il n’y a plus de différence perceptible entre l’art et l’objet commun. L’art n’est ici même plus lié à une technique de fabrication. Les œuvres à partir du XXe siècle ont conduit à rendre le concept d’art « flou ». Selon Marcel Mauss, l’art est « une activité humaine, le produit de cette activité ou l’idée que l’on s’en fait s’adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect. On peut dire que l’art est le propre de l’homme, et que cette activité n’a pas de fonction clairement définie »7. Dans ce travail, l’étude de l’art se limitera à l’art dans les espaces publics à partir du XXème siècle. Auparavant, les œuvres d’arts (statues, arcs de triomphe, reliquaires, temples, etc.) servaient à favoriser « la mise en scène personnalisée du pouvoir »8, qu’il soit politique ou religieux. Cela s’effrite dès le début du XXème siècle lorsqu’il est considéré que « l’art n’a d’autres fin que lui-même »9. Dans les années 30, Jean Zay arrive au Ministère de l’éducation nationale.
Le ministre relance alors la Après un premier projet de loi en 1936 sur le « 1% décoration », la politique du « 1% artistique » apparaît en 1951. Ce premier texte de loi entrant dans le cadre de l’Education nationale a pour objectif d’imposer aux maîtres d’ouvrages publics de consacrer 1% du coût de leurs constructions à la commande ou l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’un artiste vivant, spécialement conçue pour le bâtiment considéré, dans le cadre d’établissement scolaire ou universitaire. Dans cette période d’après-guerre, l’art n’apparait pas comme une priorité pour la population préoccupée par la reconstruction et le besoin en logements. Cependant ce dispositif va permettre d’effectuer une sensibilisation de la population à l’art dans la ville, et cela de manière systématique, officielle et pérenne dès qu’il y a une construction dans la ville.