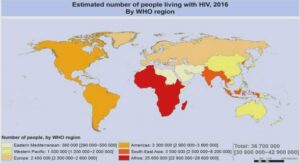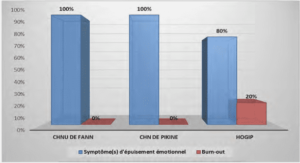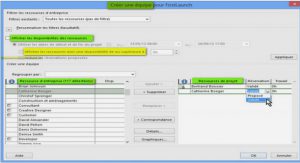L’usage du smartphone et des services mobiles en marketing
Les recherches qui s’appuient sur le modèle TAM ou l’une de ses adaptations constituent l’es-sentiel de la littérature sur l’adoption et l’utilisation de services mobiles. Cependant, à partir de la littérature nous montrons que bien que ces recherches aient permis d’enrichir la connais-sance des comportements d’utilisation des services mobiles, ce cadre théorique se heurte à de nombreuses limites. En réponse à ces limites, les travaux basés sur la valeur d’usage offrent une alternative qui considère l’utilisateur comme co-créateur du service mobile. Ainsi, l’utilisation des services mobiles peut évoluer selon le contexte et selon le niveau d’appropriation de la tech-nologie. Enfin, nous présentons une théorie alternative, la « théorie de la diffusion des usages », qui bien qu’elle ait fait l’objet de rares publications dans le domaine des services mobiles, offrent une approche pertinente pour étudier l’usage du smartphone par le consommateur.
Une majorité de recherches basée sur le TAM
Les travaux en système d’information ont largement abordé la question des intentions et des comportements d’utilisation des TIC. En s’appuyant sur la « Théorie de l’Action Raisonnée » (Fishbein et Ajzen, 1975),Davis (1989) va développer le modèle qui est encore à l’heure actuelle le plus utilisé dans les recherches sur l’usage des technologies Legris, Ingham et Collerette, 2003, le Technology Acceptance Model ou TAM. Ce modèle repose sur cinq construits qui sont la facilité d’usage perçue, l’utilité perçue, l’attitude et intention comportementale en-vers la technologie et le comportement avec la technologie. Nous présentons ici les travaux majeurs sur l’acceptation de services mobiles sur smartphone basée sur le TAM. Puis nous nous interrogeons sur le choix quasi systématique de ce modèle et de sa pertinence dès qu’il s’agit de traiter des questions d’intention d’utilisation, d’utilisation ou d’usage de services mo-biles.
Les premiers travaux se sont intéressés à l’intention d’utiliser divers services mobiles en général (Barnes et Scornavacca, 2004 ; Nysveen, Pedersen et Thorbjornsen, 2005 ; Pagani, 2004 ; Wu et Wang, 2005). D’autres recherches se sont concentrées sur l’acceptation d’un service mobile particulier telles que la billetterie (Mallat et al., 2009), les jeux (Liu et Li, 2011)ou encore la banque mobile (Luarn et Lin, 2005). Certains auteurs ont enrichi le modèle initial par l’ajout de différents construits tel que les différences culturelles (Lee et al., 2007), les services dirigés vers un but ou expérientiel Nysveen, Pedersen et Thorbjornsen (2005), les motivations intrinsèques et extrinsèques (Tojib et Tsarenko, 2012), ou des même des construits issus d’autres théories telles que la théorie de la diffusion des innovations (Zhang, Zhu et Liu, 2012). D’autres travaux se sont appuyés sur les modèles concurrents du TAM ou ont comparé le pouvoir explicatif de ces modèles. Plusieurs recherches se sont appuyées sur la « théorie unifiée de l’acceptation et de l’usage de technologies-UTAUT » pour étudier l’usage de services mobiles tels que les SMS, le shopping ou les porte-monnaie mobiles(Baron, Patterson et Harris, 2006 ; Shin, 2009 ; Yang, Zhou et Liu, 2010).
Nous constatons cependant que la majorité de ces recherches s’appuie sur le TAM sans jus-tifier ce choix autrement que par le fait qu’il est le modèle le plus couramment testé ce qui lui confère une excellente robustesse. Si cet argument apparaît comme solide, il néglige plu-sieurs recherches majeures soulignant les limites du TAM. Ainsi, Legris, Ingham et Collerette (2003) démontrent que malgré sa popularité, le TAM offre un pouvoir explicatif relativement modéré. En outre, la majorité des modèles expliquent l’intention d’utilisation des services mo-biles et non pas l’utilisation réelle et cela malgré les travaux majeurs de Karahanna, Straub et Chervany (1999) qui montrent que l’intention d’utiliser une technologie n’explique que faible-ment le comportement réel. D’après Bagozzi (2007), la simplicité du modèle ne permet pas de considérer les spécificités des différentes technologies, des contextes d’utilisation et le rôle des facteurs sociaux. Mallat et al. (2009) a essayé de répondre en partie à ces limites en inté-grant au TAM un construit de « mobilité » qui prend en compte la dimension ubiquitaire de la technologie mobile et un construit « contexte d’utilisation ». Cependant, ce modèle explique uniquement l’intention d’utilisation.
Le deuxième reproche qui peut être fait aux recherches basées sur le TAM et que peu d’auteurs font l’effort de synthèse nécessaire à la mobilisation d’un cadre théorique aussi riche. La solu-tion généralement choisie est l’ajout d’un construit au modèle initial en fonction du contexte de la recherche. Initialement développé pour évaluer l’acceptation dans le milieu organisation-nel et pour des technologies d’anciennes générations, nous nous interrogeons sur la pertinence de son adaptation à l’étude du comportement du consommateur, en pleine mutation notam-ment dans le cas du smartphone. En effet, ce terminal propose une multitude de services dont l’ubiquité permet une utilisation dans une variété de contextes.
Enfin, si chacune de ces publications vient enrichir la compréhension du processus d’adop-tion des services mobiles. Les travaux de Baron, Patterson et Harris (2006) et ceux deTojib et Tsarenko (2012) proposent une piste de recherche complémentaire aux travaux basés sur le TAM. En effet, ces auteurs soulignent le rôle de co-création joué par le consommateur lors de l’utilisation de son smartphone et des services auxquels il accède. À partir de deux études qualitatives,Baron, Patterson et Harris (2006) mettent ainsi en évidence que dans les travaux basés sur le TAM, l’utilisateur est considéré comme un simple bénéficiaire de la technologie. Alors que selon eux, c’est le processus de co-création entre l’utilisateur et la technologie qui aboutit à créer le service mobile et par conséquent la valeur. La créativité du consommateur doit donc être prise en compte. Les consommateurs ne sont plus dans la position où ils subissent la technologie, mais où ils se l’approprient 2.
L’approche basée sur la valeur
La littérature qui aborde l’adoption ou l’usage des technologies mobile à partir de la valeur reste relativement minoritaires. Les travaux se basant sur la valeur pour étudier l’intention d’usage ou l’usage peuvent être catégorisés selon deux dimensions, la dimensionnalité de la valeur et le moment où le produit est évalué (Gonzalez, Hure et Picot-Coupey, 2012). Dans la littéra-ture, la valeur est abordée soit comme un concept unidimensionnel évalué de manière globale, soit comme un concept multidimensionnel qui distingue différentes composantes de la valeur (Riviere, 2009). De même, la valeur peut être mesurée avant l’achat ou après l’achat au moment de la phase d’évaluation du processus de consommation (Rivière et Mencarelli, 2012).
Les travaux basés sur une approche unidimensionnelle de la valeur s’intéressent aux détermi-nants de la valeur en termes de bénéfices et coûts afin de déterminer l’intention d’adoption ou d’utilisation (Kim, Chan et Gupta, 2007 ; Kleijnen, Ruyter et Wetzels, 2007 ; Wang et Wang, 2010). Les principales contributions de ces travaux sont l’identification d’antécédents spéci-fiques aux services mobiles. À l’instar des recherches avec une vision unidimensionnelle, les travaux qui abordent la valeur comme un concept multidimensionnel s’intéressent aux déter-minants de l’adoption et à l’utilisation répétée des services mobiles. La littérature distingue ainsi les antécédents de l’adoption et de ceux de l’usage d’un service mobile. Les motiva-tions d’adoption sont utilitaires alors que les motivations d’usage sont à la fois utilitaires et hédoniques (Kim et Han, 2011 ; Kim et Oh, 2011 ; Pihlstrom, 2007). Yang et Jolly (2009) com-plètent cette approche en intégrant une dimension sociale et une dimension monétaire. Cepen-dant, Jung (2014) considère ces dimensions de la valeur comme trop abstraites pour retranscrire les nombreuses utilisations du smartphone. Selon lui, le recours à des services mobiles n’est qu’un objectif intermédiaire destiné à rassurer le consommateur (dans le choix d’un produit, dans la recherche d’un itinéraire, ou en demandant conseil à son entourage via un réseau social virtuel).
Le principal apport de l’approche basée sur la valeur est de ne pas aborder l’utilisateur comme un récepteur passif, mais comme un acteur qui utilise la technologie selon ses besoins et co-crée la valeur lors de l’usage Gonzalez, Hure et Picot-Coupey, 2012 ; Jung, 2014. Cependant pour Gonzalez, Hure et Picot-Coupey (2012) la majorité de ces recherches présentent plusieurs limites. D’abord parce qu’elles ont souvent eu lieu avant ou peu de temps après l’arrivée sur le marché de l’iPhone d’Apple qui marque un tournant important dans l’ergonomie, l’accès simplifié à l’Internet mobile et l’utilisation d’applications dédiées à une multitude de tâches. De plus, les auteurs ne précisent généralement pas si la valeur étudiée est attendue ou perçue, ni s’il s’agit d’une simple utilisation ou d’un usage, c’est-à-dire une utilisation prolongée dans le temps et qui peut évoluer (Gonzalez, Hure et Picot-Coupey, 2012). Enfin, la dernière limite, commune aux différentes littératures abordant les usages de services mobiles et du smartphone, repose sur le fait que la spécificité et le contexte d’usage ne sont pas pris en compte notamment dans le cas des recherches quantitatives qui s’appuient sur des échelles de mesure développées pour des technologies « fixes ». En ce sens, une approche abductive basée sur des méthodo-logies qualitatives semblerait donner de meilleurs résultats (Gummerus et Pihlström, 2011 ; Pihlstrom, 2007 ; Pihlström et Brush, 2008) ne serait-ce qu’en phase préliminaire d’un travail quantitatif. Les études des usages du smartphone basées sur la valeur évoluent vers une ap-proche qui considère que l’utilisateur est co-créateur du service mobile puisqu’il utilise, voir même combine les différentes solutions technologiques à sa disposition en fonction de ses be-soins et de la multitude de contextes rencontrés et liés à l’ubiquité de ces technologies. Le consommateur n’est donc plus un récepteur passif comme dans le cas de technologies telles que la télévision ou la radio.
L’adaptation de la théorie de la diffusion des usages aux services mobiles sur smartphone
Les recherches sur la diffusion de nouveaux produits en marketing sont généralement abor-dées dans une perspective d’adoption (Dickerson et Gentry, 1983 ; Mahajan et Muller, 1979 ; Midgley et Dowling, 1978 ; Rogers, 2003). Ce courant de recherches repose sur le paradigme de diffusion de l’adoption (AD) (Shih et Venkatesh, 2004). Ce paradigme repose sur le prin-cipe que pour qu’une innovation soit un succès, il faut qu’elle atteigne une certaine masse critique afin que la diffusion de cette innovation s’accélère (Mahajan, Muller et Bass, 1990). Cette approche a fait l’objet de nombreuses critiques dont l’argument central est que le proces-sus de diffusion d’une innovation ne peut être compris sans étudier la nature de son adoption (Anderson et Ortinau, 1988 ; Golder et Tellis, 1998 ; Lewis et Seibold, 1993 ; Robertson et Gatignon, 1986).
En 2004, la publication de Shih et Venkatesh va remettre l’usage au centre des débat en propo-sant de s’intéresser au processus de diffusion des usages (UD). Ce nouveau paradigme s’inté-resse à la nature évolutive des technologies complexes utilisées par le consommateur. En s’ap-puyant sur les travaux de Gatignon et Robertson (1985), Shih et Venkatesh (2004) soutiennent que la majorité des recherches se concentrent sur le moment de l’adoption d’une technologie sans étudier la nature de l’adoption et son évolution dans le temps, la phase de post-adoption, notamment dans le cas de technologies complexes. Les usages d’une technologie complexe sont multiples et évoluent dans le temps. Les auteurs développent un modèle de diffusion des usages dont les deux variables centrales sont la variété et l’intensité d’usage d’une technologie. Cependant, les recherches qui s’appuient sur la théorie de la diffusion des usages sont relative-ment rares et peu d’entre elles s’intéressent au cas des services mobiles.