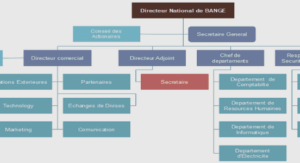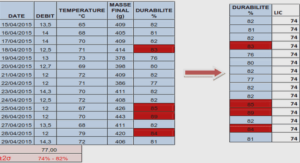LES VALEURS DE LA MARCHE
LE RETOUR DE LA MARCHE : NOSTALGIE PASSEISTE OU PREFIGURATION D’UN VERITABLE CHANGEMENT DE PARADIGME ?
Le retour de la marche est un phénomène qui peut sembler étonnant dans l’urbanité contemporaine, si on ne l’aborde que comme une réapparition d’un mode de déplacement du passé ; en revanche, une clarification de cette remise au goût du jour est obtenue beaucoup plus facilement si l’on se replace dans un paradigme urbain renouvelé. Pour être vivable, la ville doit désormais comporter de nouveaux critères, parmi lesquels la marchabilité occupe une place de choix. Cette évolution de la place de la marche dans l’écosystème des mobilités urbaines n’est plus circonscrite aux centres des villes et aux quartiers « bobos », mais gagne désormais tout l’espace urbain et notamment la périphérie. Cette caractéristique mérite manifestement d’être mise en exergue. Bien que la marche ait été longtemps un sujet négligé par les politiques du transport et de la santé, autant que par les professionnels de l’aménagement urbain, un retournement de situation considérable a eu lieu cette dernière décennie, et l’essor de la marche prend aujourd’hui une ampleur encore innatendue dans les années 1990 (Demers, 2006 ; Winkin et Lavadinho (éds.), 2011). Parée de toutes les vertus et amie de toutes les politiques, de la durabilité à la santé en passant par la cohésion sociale, la marche connaît aujourd’hui un regain de faveur. Nombreuses sont les initiatives qui tentent actuellement d’une manière ou d’une autre de la favoriser au sein de nos villes. Les raisons en sont multiples, ainsi que le note Jacques Lévy : « Les métriques pédestres10 apparaissent comme les plus respectueuses de nos deux natures – l’environnement et notre corps : en marchant, on combat en même temps l’obésité et l’effet de serre. Au titre de leur contribution à la diversité dense, ce sont aussi les plus propices à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance. Et, tout simplement, ce sont celles qui vont vite » (Lévy 2008). Véronique Michaud et Blanche Segrestin relèvent quant à elles le développement des NTIC, le désir d’autonomie de notre société, l’injonction au bien-être et l’attention qui se porte de plus en plus au traitement sensible des espaces comme les facteurs qui incitent à présenter le marcheur comme l’une des figures modernes de la mobilité (Michaud et Segrestin, 2008, p. 12). La marche est désormais considérée comme un champ d’innovation, et non pas seulement un transport résiduel, qui viendrait du fond des âges (Amar et Michaud, 2009, p. 14). Le défi, pour Véronique Michaud et Blanche Segrestin, est de trouver une méthode pour penser la marche et pour dépasser les handicaps en lien avec la représentation commune de ce mode : lenteur, inefficacité, vulnérabilité… (Michaud et Segrestin, 2008, p. 10). Si l’argumentaire semble aujourd’hui acquis, cela n’a pas toujours été ainsi. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une constante de notre condition urbaine (Mongin, 2007 (1ère éd. 2005)) alors même que la bipédie reste une constante de notre condition humaine (Coppens, 2010 (1ère éd. 2008) ; Eaton S. B., 2003) doit nous mener à nous interroger sur les raisons qui ont motivé ce changement. Pourquoi et comment le piéton, relégué au dernier rang des préoccupations des politiques publiques dans les années 1970-1980, bénéficie-t-il désormais de toutes les attentions de la part des décideurs qui font la ville et d’une image aussi positive qu’elle était négative hier ? Le présent chapitre analyse les conditions de ce retour de la marche sur les devants de la scène (Renesson, 2004) ainsi que les implications de cette prise en compte de la marchabilité sur nos conceptions renouvelées de la ville et de ses espaces publics. Nous commencerons par un bref historique des évolutions qu’a connues la marche au cours du siècle dernier, depuis son évincement par l’hégémonie de l’automobile jusqu’à son retour en grâce, que nous pensons concommitant d’une remise en question de la gestion de la distance dans nos sociétés, qui passe par un rééquilibrage entre coprésence, mobilité et télécommunications. Paradoxalement, nos sociétés mobiles et informationnelles revalorisent la coprésence comme gage d’échanges et d’urbanité. Pour mieux comprendre ce changement de paradigme « vitesse vs. urbanité », nous passerons en revue un certain nombre de signes annonciateurs de la nouvelle place conquise par la marche comme reflet de ce changement de valeurs sociétales. Puis nous consacrerons la section suivante à l’analyse de l’émergence d’un style de vie qui favorise la multimodalité tout en demandant aux individus des compétences élargies pour réussier à maîtriser un capital spatial et mobilitaire démultiplié par l’accès facilité aux ressources que la ville a à offrir.
L’AUTOMOBILE, FAIT SOCIAL MAJEUR DU XXE SIECLE
L’automobile est d’abord un fait social majeur du XXe siècle, nous dit François Ascher. Il invoque des chiffres français saisissants : plus de 80% des ménages en possèdent au moins une et lui consacrent en moyenne un peu plus de 10% de leur budget. Plus des trois quarts des déplacements urbains et 80% des kilomètres parcourus quotidiennement se font en automobile (Ascher, 2008, p. 32). Notons cependant le récent changement de comportements, avec une baisse de la mobilité totale et, pour la première fois depuis 30 ans, une baisse de la mobilité automobile (Michaud et Segrestin, 2008, p. 12). Cela représente à nos yeux une fenêtre d’opportunité pour la marche, qui reste le socle premier de la mobilité et surtout le ciment de l’intermodalité. L’automobile joue aussi un rôle fort en tant que « territoire du moi » tel qu’il a été défini par Erving Goffman (1973b, (éd. orig. angl. 1971)). Cette dimension de lieu de vie, où peuvent éclore des relations sociales, en particulier familiales, échappe à une vision purement fonctionnaliste de la voiture en tant que mode de transport. Longtemps, la voiture était le seul endroit où l’individu pouvait écouter de la musique, sans le besoin de négocier avec d’autres personnes (Amar et Michaud, 2009, p. 18). Le lancement de l’iPod11 en 2001, puis de l’iPhone en 2007, sont venus changer la donne et rebasculer le « territoire du moi » musical du côté des marcheurs, qui en s’autonomisant et en s’accessoirisant (Lavadinho et Winkin, 2004, 2005, 2008 ; Winkin et Lavadinho, 2008 ; Lavadinho, 2010k, 2006b) renforcent leur fonction d’ « unités véhiculaires » (Goffman, 1973a). La notion d’unité véhiculaire permet de rendre compte de la manière dont les piétons s’approprient un territoire en mouvement. Notre corps, cette coque à géométrie variable d’à peine 1 m2, nous offre sécurité et assurance lors de nos immersions en ville. Elle nous permet d’emprunter, le temps de les traverser, des espaces publics qui ne nous appartiennent pas mais que nous délimitons un bref instant comme étant les nôtres. Signalons au passage que la voiture et plus largement « les lieux-mouvements » du transport ne sont que des cas particuliers de lieux appropriés en tant que « territoires du moi ». Pour Stéphane Beaud et Florence Weber, ce territoire personnel est à la fois subjectif (c’est la personne qui, par ses gestes, par son corps, par ses accessoires qu’elle laisse en lieu et place de son corps, s’approprie cette place), matériel (c’est d’espace physique et d’objets qu’il s’agit) et intersubjectif (les autres m’assignent à cette place, reconnaissent une correspondance entre moi, ces choses, cet espace). L’estime de soi passe aussi par ces « extensions du moi » : c’est ce que montre l’observation des jardins, des maisons, des voitures, des bureaux, de tous ces espaces appropriés qui valent pour leur occupant (Beaud et Weber, 2010 (1ère éd. 1997), p. 309). Nous pensons que pour un report modal effectif, il faudrait tenir compte de cette territorialisation des modes de transport. Faire le choix de délaisser la voiture implique pour l’individu d’y trouver son compte, en termes de nouveaux « territoires du moi », au sein des nouveaux modes de transport adoptés, y compris la marche. Cela ne peut se faire qu’en renforçant simultanément les aménagements matériels et symboliques qui favorisent son essor tant dans les esprits que dans les pratiques des citoyens marcheurs (Lavadinho et Winkin, 2005b).
L’essor de l’automobile relègue la marche dans l’oubli
Si lors de son apparition, l’automobile ne ralliat pas toutes les voix en sa faveur, et si les deux guerres mondiales ont retardé sa diffusion, celle-ci s’est faite à large échelle dès les années 1950, entraînant de profondes mutations territoriales dans son sillage (Dupuy, 1995, 1999). Le déclin de la marche, inversément proportionnel à l’essor de l’automobile, a été constaté dès cette époque. Bien que toujours présente sur le terrain (certes à un moindre degré), la marche a dès lors progressivement disparu des statistiques, des discours, des réflexions et des préoccupations des politiques publiques. Elle est devenue invisible… ou en tout cas n’a plus été perçue que sous un seul angle, celui de la sécurité. L’image du piéton des villes s’est ainsi peu à peu imposée à tous : une personne vulnérable, victime potentielle de la circulation, plutôt pauvre, usager captif des transports publics et marcheur contraint. Bref, une image dévalorisante. L’affaissement statistique de sa pratique quotidienne trouvait alors son pendant dans le désintérêt croissant des politiques publiques d’aménagement urbain pour cette question. Cependant, très tôt, des voix se sont élevées contre les effets négatifs de l’adaptation des villes à l’automobile. Dès la fin des années 1950-1960, en réaction à la forte motorisation de la société américaine de l’après-guerre, un contrecourant, incarné par Jane Jacobs (1993 (éd. orig. angl. 1961)) comme figure de proue, avait émergé aux Etats-Unis en faveur d’un retour à la rue et à des échelles de proximité. Ce mouvement de contestation avait trouvé des échos en Europe dans les années 70, notamment avec les travaux précurseurs de Jan Gehl (1971), architecte danois qui reste aujourd’hui encore l’une des références majeures au niveau mondial en termes d’aménagement des espaces publics (Gehl, 1996 ; Gehl et Gemzøe, 2000 ; Gehl, Gemzøe et al. 2006 ; Gehl, 2010). Ce contre-courant est resté actif à travers les décennies, mais uniquement en filigrane : il ne faisait pas le poids face aux rêves de liberté de mouvement et de suburbanité qui ont caractérisé les Trente glorieuses. La voiture s’est imposée comme premier mode de déplacement non seulement au sein des tissus diffus des périphéries alors en pleine extension, mais aussi au sein de la ville compacte, y compris pour de courtes distances12, du fait de la co-dépendance territoriale des dynamiques de mobilité provoquée par l’imbrication des activités à diverses échelles. Ainsi jusqu’aux années 1980, grosso modo, le futur de l’automobile semblait acquis. Pendant cette période, les villes n’ont pas ménagé leurs efforts pour lui assurer toujours plus de place, à grands renforts d’investissements infrastructurels. Les successifs chocs pétroliers et autres crises économiques des dernières décennies ont parfois remis en cause, retardé ou provoqué l’abandon de certains de ces grands projets d’infrastructure, mais les villes dans leur grande majorité ont néanmoins été profondément remaniées dans leur morphologie pour accomoder les modes motorisés. Nous avons du attendre les années 1990 pour connaître une inversion de ce mouvement du « tout à l’automobile »