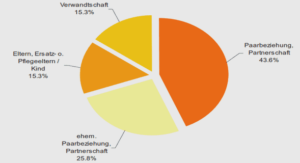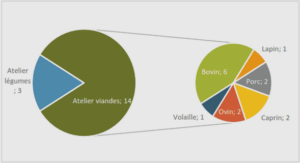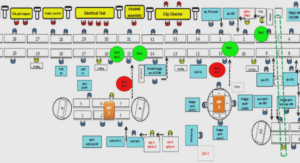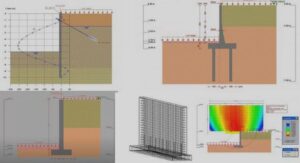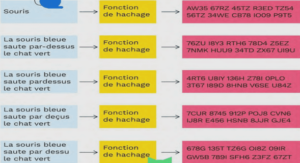Terminologie et objectifs de recherche
La définition du terme « représentation » sera ici rappelée : « du point de vue de la psychologie, une représentation est définie comme une perception, image mentale, etc., dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc., du monde dans lequel vit le sujet » (Larousse).
De la même manière, le terme « influence » sera également défini : « pouvoir social et politique de quelqu’un, d’un groupe, qui leur permet d’agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. » (Larousse).
Afin de répondre au mieux à la question de recherche, deux objectifs principaux ont été définis :
– Faire un état des lieux des connaissances et identifier les représentations des sages-femmes concernant le vaginisme
– Établir les freins et les facteurs favorisant le parcours de soins des patientes atteintes de vaginisme
Matériels et méthodes
Pour commencer, cette section va rappeler les objectifs de la recherche. Ensuite, elle va décrire le protocole de recherche utilisé ainsi que la population à l’étude. Enfin, seront présentées les modalités du recueil de données.
Dans un premier temps sera décrite la méthode quantitative, puis la méthode qualitative.
Afin de répondre à la question de recherche « en quoi les connaissances et les représentations des sages-femmes concernant le vaginisme peuvent-elles influencer le parcours de soins des femmes atteintes ? », plusieurs objectifs ont été formulés :
– Faire un état des lieux des connaissances des sages-femmes concernant le vaginisme en les interrogeant via un questionnaire en ligne
– Établir les freins et les facteurs favorisant le parcours de soins des patientes atteintes de vaginismes en interrogeant les sages-femmes via un questionnaire en ligne et par des entretiens individuels semi-directifs.
Concernant la partie quantitative de l’étude
Le questionnaire (annexe I) permettant de répondre aux objectifs de l’étude a été diffusé en ligne, grâce à la plateforme « framaform » et distribué par courriels aux sages-femmes. L’envoi du questionnaire a débuté en mai 2020. Le recueil des réponses au questionnaire a été clôturé en septembre 2020. Ce recueil de données a duré 4 mois. Les sages-femmes ont pu répondre à ce questionnaire de façon totalement anonyme et confidentielle grâce à l’impossibilité de remonter l’adresse IP.
Premièrement, le questionnaire a cherché à connaître plus amplement les participants étudiés : âge, sexe, année d’obtention du diplôme de sage-femme, lieu de formation, exercices professionnels. Deuxièmement, le questionnaire a sondé les connaissances globales des sages-femmes participantes sur le vaginisme, puis leurs conduites à tenir en pratique face à une patiente vaginique. Une partie du questionnaire s’est également consacrée au vaginisme et à la sexologie dans la formation initiale.
Le seul critère d’inclusion de l’étude a été le suivant : exercice de la profession de sage-femme dans le département des Bouches-du-Rhône.
Le critère d’exclusion de l’étude a été le suivant : ne pas répondre à l’ensemble des questions posées selon l’algorithme d’affichage du questionnaire.
Les adresses électroniques des sages-femmes libérales ont été récoltées en grande partie par l’intermédiaire du site internet de l’Ordre des Sages-Femmes (section « annuaire des sages-femmes libérales »). D’autres ont été recueillies grâce aux sites internet des cabinets de sages-femmes libérales. Néanmoins certaines sages-femmes libérales n’ont pas pu être contactées : soit car leurs adresses électroniques sont restées introuvables, soit car leur messagerie était indisponible. Les sages-femmes de PMI ont été contactées par leur adresse électronique professionnelle.
Enfin, les sages-femmes exerçant en clinique ou à l’hôpital ont été contactées grâce à l’aide des sages-femmes coordinatrices qui ont accepté de transférer mon questionnaire à leurs équipes de sages-femmes.
Au total, les 920 sages-femmes du département des Bouches-du-Rhône ont été contactés, que ce soient les sages-femmes hospitalières, libérales ou territoriales. C’est 167 sages-femmes qui ont finalement répondu au questionnaire, soit un taux de participation sur le département supérieur à 15%.
Plusieurs types de réponses ont été proposés aux participants. Une échelle comportant les items suivants : « pas du tout d’accord » ; « plutôt pas d’accord » ; « plutôt d’accord » ; « tout à fait d’accord » a majoritairement été utilisée pour sonder les connaissances et représentations des sages-femmes. Une échelle de fréquence a couramment été employée : « jamais » ; « rarement » ; « régulièrement » ; « souvent ». Une échelle numérique de 0 à 10 a aussi été proposée. Parfois, des questions à choix multiples ou des questions avec des réponses à champ libre ont été adoptées.
En premier lieu, afin d’organiser les résultats récoltés via framaform, chaque valeur a été transformée en pourcentage. Cela a permis de dégager une vue d’ensemble utile pour créer une grille de recueil (annexe II). Cette dernière a été élaborée pour diriger les entretiens semi-directifs.
Secondairement, le test du khi2 est le test statistique qui a été retenu afin d’analyser les résultats. Cela a permis d’affirmer des associations entre différentes variables, ou au contraire de les infirmer.
Concernant la partie qualitative de l’étude
Afin de compléter l’étude quantitative, une étude qualitative a été menée grâce à la réalisation d’entretiens semi-directifs avec des sages-femmes. Pour se faire, une grille d’entretien (annexe II) a été construite avec l’aide des premiers résultats de l’étude quantitative. Pour contacter les sages-femmes, un message a été posté sur les réseaux sociaux (Facebook) grâce au groupe « Sages-femmes Marseille » au mois d’octobre 2020. Les critères d’inclusion ont donc été les suivants :
– Sage-femme volontaire pour participer à l’étude
– Sage-femme exerçant dans les Bouches-du-Rhône
Une fois les sages-femmes volontaires contactées, il a été convenu d’un rendez-vous. Les praticiens ont pu décider entre un entretien par téléphone ou par la plateforme Zoom ou encore en face-à-face. A noter que les entretiens en face-à-face n’ont jamais été choisis au vu du contexte sanitaire actuel (pandémie Covid-19). Au total, 4 entretiens ont été réalisés.
Chaque entretien fait par le biais de la plateforme Zoom (2/4) a été enregistré via Zoom directement afin de conserver l’image et le son. Ils ont également été enregistrés grâce à l’enregistreur vocal de l’ordinateur afin de réduire les risques de perte de données. De la même façon, les entretiens téléphoniques (2/4) ont été enregistrés à la fois par l’enregistreur vocal de l’ordinateur mais également par celui du téléphone portable. Chaque sage-femme interrogée a donné son autorisation pour l’enregistrement de l’entretien avec l’assurance par l’interviewer qu’il sera ensuite détruit pour assurer la protection des données. Tous les entretiens ont été anonymisés afin de conserver la confidentialité. Les entretiens n’ont pas été limités dans le temps. Cependant, tous ont duré entre 30 et 45 minutes.
Par la suite, ils ont été intégralement dactylographiés sur le logiciel Word. Chaque tapuscrit a ensuite été analysé à l’aide de la méthode d’analyse de contenu de Laurence Bardin.
Ci-dessous seront détaillés les caractéristiques des sages-femmes ayant participé aux entretiens. Les prénoms choisis sont des pseudonymes choisis arbitrairement par l’auteure.
– Zoé, diplômée en 1991, a travaillé à l’hôpital, en clinique et en libéral actuellement
– Pietra, diplômée en 2009, a travaillé à l’hôpital et en libéral actuellement
– Jade, diplômée en 2017, travaille actuellement à l’hôpital
– Leïla, diplômée en 2020, travaille actuellement à l’hôpital