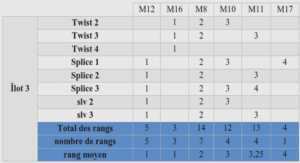Les théories de la croissance et du commerce international
De tout temps, la croissance et le commerce extérieur ont intéressé de nombreux auteurs. La croissance est un phénomène plus général car elle englobe tous les secteurs productifs. Qui dit croissance pense à un développement. Développement et croissance sont deux concepts pairs qui ne devraient pas être dissociés. Le commerce international, quant à lui, englobe des échanges économiques relativement compliqués. La plupart des auteurs s’intéresse sur les facteurs explicatifs de ce marché en adoptant une démarche normative.
Il n’est pas rare de voir ces sujets traités conjointement. Mais dans ce chapitre, l’intérêt est de montrer les différentes théories de la croissance, du développement et du commerce international.
Les théories de la croissance et celle du développement
La croissance est généralement perçue de deux façons diamétralement opposées. Une conception « pessimiste » suppose que la croissance soit limitée par quelques contraintes, qu’elle est vouée à stagner à long terme. A l’inverse, une conception « optimiste » affirme que la croissance peut être illimitée et stable à long terme. Par ailleurs, le concept du développement est plutôt univoque. Il est la suite espérée de la croissance. C’est pourquoi, les modèles de développement traités par les auteurs reflètent parfois ceux de la croissance.
Les théories de la croissance : une vue d’ensemble
La croissance économique signifie l’augmentation générale de la richesse. Par convention, il s’agit de la richesse des nations bien que le concept peut s’appliquer à une communauté, ou au ménage. Cependant, cette définition est trop étroite. Au cours de l’Histoire, la pensée économique s’est développée en la matière, puisque la croissance est l’une de ses plus grandes préoccupations.
Nous verrons successivement différentes visions d’auteurs, avant-gardes dans leur doctrine. Nous traiterons également les différentes théories de la croissance depuis A. SMITH jusqu’à maintenant .
Conception de la croissance
En général, la conception de la croissance varie selon trois grandes doctrines. Il convient de les voir par ordre chronologique. Il faut remarquer cependant que, dans le fond, ces conceptions rejoignent toutes la définition selon laquelle la croissance est l’augmentation générale des richesses, en terme réel. La différence réside plutôt dans l’évaluation. C’est pourquoi nous préférons parler de « vision » au lieu de « conception ».
La vision des mercantilistes
Les mercantilistes voyaient la croissance comme un enrichissement grâce au développement du commerce. A l’époque où cette vision fut très répandue, les obstacles aux commerces étaient un grand problème économique. Cela dit, les activités productives ne rencontrent aucun autre problème majeur que l’absence ou l’insuffisance des débouchés.
Dans un tel contexte, les mercantilistes s’intéressent de près au mouvement de la balance commerciale quand il s’agit d’étudier croissance économique. Le développement des échanges intérieurs mais aussi extérieurs seraient donc le signe que l’économie nationale est en phase de croissance. Plus précisément, cette croissance se traduirait par une balance commerciale excédentaire. Finalement, la mesure adoptée est la solde commerciale. Une solde nettement positive signifie en effet que les agents résidents ont vendu plus de biens (exportations) plus qu’ils n’en ont acheté. La richesse est donc matérialisée par l’or, l’argent et les métaux précieux.
La vision des physiocrates
La vision des physiocrates se fondent sur le secteur primaire, sur l’agriculture. Selon eux, la seule véritable source de richesse est la nature, en l’occurrence la terre. Les problèmes économiques qui les occupaient sont de cet ordre : la rente, la propriété foncière et la production agricole. Toutefois, certains auteurs comme D. RICARDO ont prolongé leur analyse vers le commerce. Dans ce contexte, les physiocrates parlent de croissance des produits agricoles qui sont d’emblée considérés comme le seul vrai « bien économique ». Ainsi, les calculs de la croissance se rapportent au rendement des terres cultivables, notamment à l’accroissement de la production agricole .
La vision des néoclassiques
La vision néoclassique de la croissance est celle qui est en vogue actuellement parce qu’elle correspondrait au contexte actuel. Sans écarter l’idée de l’enrichissement, les néoclassiques retiennent une mesure plus synthétique : le Produit Intérieur Brut. Il s’agit de la somme des valeurs ajoutées créées par les agents économiques résidents. Par ailleurs, le Système Elargi de la Comptabilité Nationale (SECN) définit un équilibre général selon lequel la demande finale intérieure – somme de la Consommation Finale, de la FBCF et de la Variation des Stocks – est égale au PIB majorée de la solde des échanges extérieurs. Ainsi, la valeur du PIB peut être aussi déduite de cet équilibre.
En général, le PIB est calculé au prix du marché. Ainsi, le PIB est donné par la somme des valeurs ajoutées brutes, la TVA grevant les produits ainsi que les Droits de Douane et Assimilés. En outre, on peut choisir de retenir entre le PIB courant – en valeur – et le PIB constant – en volume – selon l’intérêt de l’analyse à faire. L’évaluation de la croissance peut également se faire de diverses manières : comparaison d’année en année, comparaison entre pays pendant une période donnée, modélisation en vue d’expliquer ou de constater l’évolution du PIB, détermination du secteur porteur de la croissance. Ainsi, le taux de croissance économique est assimilé à celui du PIB.
Enfin, le SECN retient cinq secteurs institutionnels et définit plusieurs branches regroupant quelques unités de production homogène . On peut donc distinguer le PIB marchand du PIB non marchand qui correspond aux valeurs ajoutées créées dans les branches non marchandes, notamment dans le secteur public.
INTRODUCTION GENERALE |