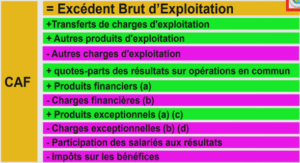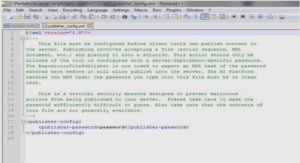Les styles de la Karnali à l’époque médiévale
Historiographie des styles artistiques du Népal
En 1974 paraissent les deux volumes du célèbre ouvrage The Arts of Nepal de Pratapaditya Pal. Focalisé sur la collection d’art népalais du Los Angeles County Museum of Art, ce travail admirable (souvent réimprimé et en continuité avec la thèse de son auteur) figure, aux côtés du Nepal Mandala (1982) de Mary Shepherd Slusser, au rang des classiques de l’historiographie du Népal. M. S. Shepherd définit clairement l’acception du terme « Nepal », considéré dans le cadre de son étude comme afférent à celui de Nepālamaṇḍala, le Cercle (ou Pays) du Népal, c’est-à-dire la vallée de Kathmandou757.
De son côté, P. Pal indique la signification du terme mais, étant donné que la collection en question concerne des objets produits dans les trois royaumes néwars de Patan, Kathmandou et Bhaktapur, il utilise le mot « Nepal » dans sa signification contemporaine de pays758. Cette métonymie du concept « d’art népalais » est jusqu’à présent encore largement constitutive de nombreuses études sur le sujet759. De fait, l’art néwar se trouve être le plus médiatisé, aux côtés de l’art tibétain des marches septentrionales. Force est de constater que la sélection des œuvres abordées concerne généralement les pièces présentant la plus grande maîtrise technique possible.
Ce tri éditorial et muséologique laisse donc de côté les formes d’art plus populaires et des objets qui ne sont pas jugés suffisamment bons ou beaux760. Un second corpus d’ouvrages concerne d’autres formes d’arts. Les termes les plus récurrents pour les qualifier sont sans doute ceux de « primitif » et de « tribal »761. Gisèle Krauskopff et Bertrand Goy le reconnaissent, le terme de « tribal » est « arbitraire, ou pour le moins ambigu »762. Par ailleurs, un processus quasi automatique associe ces formes d’arts himalayens avec les religions chamaniques, ainsi que le formule Patrick Pevenage : Ce qui noussemble se profiler au travers de ces différences et les « anomalies », de l’archaïsme de ces formes, c’est peut-être l’ombre des religions chamaniques primitives.
. Des arts et des cultures « tribales » face à des arts et des cultures « savantes »
Comme on l’a mentionné plus haut, l’étude des arts himalayens s’est souvent focalisée sur les productions des Néwars de la vallée de Kathmandou. Quand elles ne traitent pas de ce sujet vaste et passionnant, les publications et les expositions s’intéressent aux formes dites « tribales », « archaïques » ou « primitives ». Ainsi, l’impression donnée est que nous avons d’un côté une population inscrite dans la maîtrise et le perfectionnement des arts et des techniques, les Néwars, et que de l’autre côté se trouve un conglomérat de populations productrices d’un art à leur image : non savant.
En 1886 déjà, le voyageur français Gustave Le Bon différencie les peuples (« races ») du Népal en fonction de leurs aptitudes face à la guerre ou aux arts (il n’emploie cependant pas le concept de tribalité) : Ce peuple [« les Gorkhas »] se distingue par ses qualités militaires et est d’une grande bravoure. […] Il dédaigne l’industrie, l’agriculture, le commerce, et est privé à un degré remarquable de sentiment artistique. Ce sont […] des aptitudes exactement opposées à celles que nous trouverons chez les Newars. […] L’art de sculpter le bois est poussé chez eux à un degré que je n’ai trouvé dépassé chez aucun peuple européen moderne. Fort peu encouragés malheureusement par leurs maîtres actuels, ces Gorkhas absolument dépourvus de sens esthétique, les artistes newars disparaissent graduellement […]