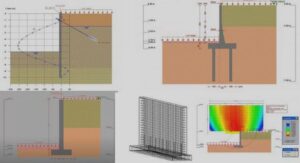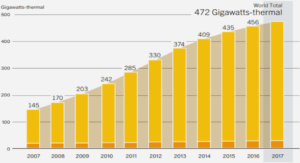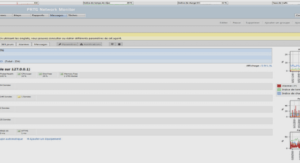Les sources constitutionnelles hypothétiques de la représentativité internationale du Premier ministre
Un rôle politique affaibli par la constitutionnalisation d’un domaine gouvernemental extérieur autonome
Sous la Vème République, rares sont les auteurs à convenir du fait que « le cœur de l’État bat à Matignon » 1927, a fortiori dans le domaine de la politique étrangère où la prééminence du chef de l’État est indiscutablement établie par les faits. La primauté présidentielle reçoit, ainsi, la caution de la
doctrine juridique majoritaire. Elle « est, du point de vue du droit des relations extérieures, le point capital » du système constitutionnel établi en 19581928. « L’interprétation favorable aux pouvoirs présidentiels a été plus forte que les changements politiques qui sont intervenus », insiste-t-on1929. Malgré tout, c’est sans ambiguïté aucune que la lettre constitutionnelle confie au Gouvernement (art. 20 C) et, plus exactement à son chef (art. 21 C), le pouvoir de déterminer et de conduire la politique de la Nation. De ce point de vue, convient le Professeur Dmitri Georges LAVROFF, « [p]ersonne ne peut nier que la politique étrangère soit un élément de la politique de la Nation, probablement une de ses composantes principales (…)
Eclairé par l’alinéa 2 de l’article 52 de la Constitution qui étend l’exercice du treaty making power au Gouvernement, l’article 20 C s’analyserait comme le pendant de l’article 5 C. Il fonderait et justifierait à la fois l’existence d’un domaine gouvernemental extérieur autonome du domaine international de la présidence. Mais, précisément, l’appréciation extensive des prérogatives externes du chef de l’Ét at a conféré, en pratique, une portée relative à la « dérogation au monopole de représentation du chef de l’État » exprimée par les accords non soumis à ratification envisagés à l’alinéa 2 de l’article 52 C . Le recul historique conduit à penser qu’en matière de relations extérieures, la tradition monarchique semble l’emporter sur l’innovation républicaine. A priori, cette hiérarchie apparente commanderait de prendre le domaine international de la présidence comme point départ de l’analyse contemporaine de la fonction du ministre des Affaires étrangères et non le domaine gouvernemental extérieur autonome. Or, tel n’est pas l’angle d’attaque privilégié dans la présente Section.
806. En l’espèce, ce n’est pas la problématique de l’indétermination normative de la répartition des pouvoirs internationaux de l’État a u sein de l’Exécutif suprême qu’elle envisage1932 mais celle des conditions de leur coordination. Or, cette exigence échoit spécifiquement au ministre des Affaires étrangères en sa qualité d’organe gouvernemental en charge de la gestion et de la correspondance diplomatique de la France. A cet égard, si l’article 52 de la Constitution a été interprété majoritairement en défaveur du Premier ministre dans ses rapports avec le président de la République, la donne s’annonce plus nuancée dans la relation verticale qui unit le responsable de Matignon au ministre des Affaires étrangères. Elle est même susceptible de dynamiser la thèse du déclin du rôle politique du chef du Quai d’Orsay. La question se pose, en effet, de savoir si elle peut trouver dans la constitutionnalisation de la prépondérance du chef du Gouvernement dans le domaine gouvernemental extérieur matière à s’épanouir. Plus exactement, comment s’articule, en pratique, le rôle de coordination générale que le responsable de Matignon tient de l’article 20 de la Constitution avec le rôle de coordination spécifique que le ministre des Affaires étrangères assume depuis l’Ancien Régime en son domaine ? Le caractère séculaire de son monopole juridique suffit-il à contrebalancer les pouvoirs de contrôle et d’arbitrage que le Premier ministre est amené à exercer dans le domaine international au titre des 20 et 21 de la Constitution ?
A priori, la dimension politique intrinsèque à l’action diplomatique rend délicate l’invocation de l’adage « Lex specialis derogat lex generali » au bénéfice du ministre des Affaires étrangères. En effet, le rapport de verticalité dans lequel les articles 20 et 21 C l’inscrivent, exclut au plan normatif la coïncidenc e des limites constitutionnelles du domaine gouvernemental extérieur avec celles du Département . L’exégèse du texte de 1958 conduit, donc, objectivement à intégrer la gestion gouvernementale des Affaires étrangères dans le domaine d’action général qui relève de laesponsabilitér politique du Premier ministre. Cette prévalence fondede jure la subordination statutaire du ministre des Affaires étrangères à Matignon ( Paragraphe 1). Se faisant, l’exercice des pouvoirs politiques de chef de la diplomatie se trouve fortement indexé par les principes vectoriels de l’action gouvernementale dans un régime parlementaire. En pratique, c’est moins le principe de solidarité que celui de collégialité de l’action gouvernementale qui affecterait l’autorité du ministre des Affaires étrangères Paragraphe( 2).
Une autonomie politique affiblie au plan statutaire : l’affirmation juridique de la prépondérance diplomatique du Premier ministre
A l’époque des régimes d’assemblée, il s’est trouvé un président du Conseil pour affirmer que les questions diplomatiques étaient «l’affaire de Monsieur le président de la République et de Monsieur le ministre des Affaires étrangères » . Loin d’être avérée en pratique1935, cette affirmation trouvait une explication légitime dans le silence gardé par les Constitutions des IIIème et IVème Républiques sur la capacité représentative du chef du Gouvernement. Bien que symbolique, la prééminence ud chef de l’État en matière de représentation demeurait exclusive en droit. Au plan normatif, la donne s’est diversement infléchie sous la V République à la suite de la consécration d’un domaine gouvernemental extérieur autonome instrumentalisé par l’alinéa 2 ed l’article 52 de la Constitution. Il est instrumentalisé, en pratique, par la conclusion d’accords en forme simplifiée spécifiquement envisagés aux articles 52 et 55 de la Constitution. Toutefois, en pratique, la mise en œuvre de ces innovations déborde le cadre d’exercice du treaty making power. Elle conforte, en effet, la visibilité internationale du Premier ministre en sa qualité de représentant politique de la France à part entière. Sur ce point, on observe que si la représentativité primo-ministérielle est affirmée sans ambiguïtés dès les années « 1960 » endroit international conventionnel1936, elle est l’objet d’une consécration diffuse en droit constitutionnel français.
Ainsi, les auteurs la professent comme une évidence sans que, toutefois, ils ne lui attribuent une source normative clairement établie dans la Constitution de 19581937. Malgré leur État : (…) les chefs du gouvernement (…) pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité (…) ». Dans le même sens, l’article 21 §2 organise au profit du chef du Gouvernement et du ministre des Affaires étrangères un régime dérogatoire. Au titre de leurs fonctions,« (…) quand ils prennent part à une mission spéciale de l’État d’envoi, [ils] jouissent, dans l’État de réception ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accord é par la présente Convention des facilités, privilèges et imunités reconnus par le droit international ». De même, le droit conventionnel de l’Union européenne, prévoit que « le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les rientations politiques générales. Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que le président de la Commission » (art.4 UE, ex-art. D du Traité UE). S’agissant de la représentation exécutive au sein du Conseil européen, la France fait figure d’exception aux côtés de la Chypre : sur les 27 États membres de l’Union européenne, elles sont les seules à y être représentées par leur Président respectif.
Le Professeure Elizabeth ZOLLER, notamment, ne manque pas de lui consacrer une analyse spécifique dans son ouvrage de référence Droit( des relations extérieures, Op. cit,. pp. 100-109). Elle nuance le rôle « secondaire » qui est souvent réservé au Premier ministre en matière de relations extérieures (p. 100) en rappelant qu’ « en tant que chef du gouvernement, [il] a la qualité de représentant de l’État » (p. 106). On relève, toutefois, l’absence de référence à des bases juridiques (écrites et/ ou coutumières) propres à fonder, au plan positif, cette qualité. La présentation dichotomique de l’argumentation du Professeure ZOLLER confère, a priori, une portée restrictive à la capacité représentative du Premier ministre en tant qu’elle s’affimerait spécifiquement dans des domaines sectoriels de la politique étrangère situés hors des zones d’influenc de l’Elysée: « [d]ans le domaine de la coopération bilatérale économique, technique ou militaire, préciset-elle, c’est souvent le Premier ministre qui représente l’État à l’étranger » (p. 106). En marge de la lettre constitutionnelle, une répartition des tâches aurait été, ainsi, esquissée sur le fondement d’un consensus diplomatique entre les deux têtes de l’Exécutif : « [i]l existe à cet égard une évidente division du travail entre le président de la République et [le Premier ministre] : au premier, el domaine de la haute diplomatie et la participation aux réunions internationales qui engagent les grandes options politiques ; au second, la coopération internationale économique entre États, la promotion des intérêts conomiquesé français à l’étranger, la négociation des arrangements financiers et des accords d’investissements, le règlement de contentieux délicats aveccertains États étrangers (affaire Greenpeace) » (Ibid.). En l’espèce, l’exhaustivité des domaines d’action du Premier ministre délimiterait une aire d’exercice moindre pour sa représentativité que celle réservée au Président deaRépublique car tous les domaines de la vie étatiques peuvent faire l’objet de rencontres au sommet. Cette approche restrictive inscrirait alors le rôle international du Premier ministre dans une logique hiérarchique, là où le droit international organiserait une égalité statutaire elativer entre chefs d’État et de Gouvernement en ma tière de représentation [art. 7 Convention de Vienne de 1969; voir infra (Partie II-Titre II-Chap. II-Sect. I)]. Malgré tout, tout, il y a possibilité de suppléer l’absence de ondementf explicite en procédant à une lecture systémique de ces dispositions de la Constitution combinant les bases du pouvoir directionnel général du Premier ministre (art. 20 et 21 C) avec celles encadrant le pouvoir conventionnel réservé au Gouvernement (art. 52, al. 2 C et art 55C). L’agencement des dispositions souscrit à une logique rationnelle sur laquelle les continge nces du système politique n’ont en principe pas de prise significative, sauf volonté contraire des Premiers ministres et à moins , pour la présidence, de vouloir priver d’effectivité la constitutionnalisation d’un domaine gouvernemental extérieur 1939 point de vue, on prêterait à la première autonome . De ce cohabitation de 1986 un effet rationalisant pour avoir mis ostensiblement fin à la « tradition silencieuse des Premiers ministres » sus-évoquée. Au regard des considérations qui précèdent, on prendra soin dans le présent paragraphe d’envisager les prérogatives externes du chef du Gouvernement sous l’angle de la répartition entérinée par le droit politique – c’est-à-dire la conception convergente de la lettre constitutionnelle et de la pratique politique même minoritaire – et non sous celui de la pratique poli tique exclusive du pouvoir d’État 1940. De manière objective, l’étendue des pouvoirs d’action du Premier ministre en matière internationale conforterait la portée restrictive que la doctrine majoritaire attache au pouvoir décisionnel du ministre des Affaires étrangères en matière diplomatique1941.
pour le Professeure ZOLLER, il ne fait aucun doute que même si la diplomatie gouvernementale est peu ostensible, elle demeure « tout aussi importante » que « la diplomatie au sommet » impulsée par le chef de l’État (ibid.). La pratique diplomatique primo-ministérielle la plus récente confirme cette assertion [voir infra (Partie II-Titre II-Chap. I-Sect. I)] à cette nuance près par rapport à la vision restrictive du Professeure Z OLLER que la diversité croissante des activités diplomatiques de l’actuel chef du Gouvernement, M. François FILLON, suggère un rôle politique plus déterminant que celui d’« auxiliaire » (p. 101) ou d’agent contentieux du Président de la République (p. 106) décrit par l’auteur. L’activisme dont il fait preuve dans le contexte d’une « hyper-présidentialisation » laisse à penser que l’émancipation diplomatique des Premiers ministres n’a pas été enrayée par la fin de la troisième cohabitation. Sa permanence tendrait même, sur le long terme, à réconcilier la pratique politique avec l’esprit originel de la Constitution qui conférait, en 1958, à Matignon une position centrale dans la conduite de la politique étrangère. Sans qu’elle n’affecte le rapport d’autorité entre le président de la République et le Premier ministre, la pleine représentativité de ce dernier aurait durablement recouvert le caractère de principe attaché à son statut de responsable de la « politique de la Nation ». Elle ne se limiterait, donc, pas aux seuls intermèdes cohabitationnistes, contrairement à ce que semble suggérer le Professeure ZOLLER (p. 109).
Son « effectivité politique » aurait, ainsi, précédé son« effectivité comme « système normatif supérieur »» [article reproduit in AVRIL (P.), Ecrits de théorie constitutionnelle et de droit politique, Éd. Panthéon Assas, L.G.D.J., 2010, pp. 229-238].
1941 Dans une perspective inverse, l’étude de l’articulation des compétences internationales du Présidentde la République avec celles du ministre des Affaires étrangères révèle que le cadre normatif de l’action présidentielle est un lieu propice à l’influence du ministre et à son enracinement dans la conduite de la politique étrangère. Le constitutionnelle de la représentativité du Premier ministre s’inscrirait dans la continuité de la ème Républiques, à cette nuance près pratique hégémonique des gouvernements des III et IV que, désormais, elle déroge expressément au monopole constitutionnel du chef de l’État en matière de représentation A(). Mais, parce que l’autonomisation du rôle international du Premier ministre est à la fois, justifiée et transcendée par son statut de chef du Gouvernement, elle n’est pas sans affecter la centralité historique reconnue au Quai d’Orsay au sein de l’appareil diplomatique d’État. Plus précisément, le monopole instrumental du ministre des Affaires étrangères se trouverait relativisé de jure par la prévalence des pouvoirs d’arbitrage et de coordination que le Premier ministre exerce au nom du Gouvernement et désormais, dans l’intérêt supérieur l’État B().
 Télécharger le document complet
Télécharger le document complet