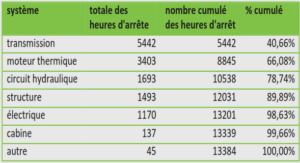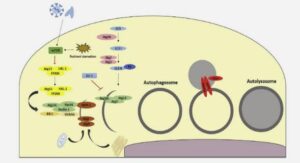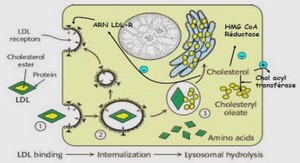Nous sommes tous des saumons
À la transformation des habitats par artificialisation ou destruction s’ajoute une pollution générale dont tous les indicateurs nous disent qu’elle augmente. Le plus grand écosystème du monde, à savoir l’en-semble des océans, se dégrade maintenant de manière sensible. « Il est victime d’une détérioration sans précédent », résume Jean-Pierre Féral, du CNRS. La masse océanique, qui couvre 71 % de la surface de la Terre, et que l’on considérait jusqu’à présent comme un puits sans fond, commence à montrer ses limites de digestion des rebuts de l’activité humaine. Le plafonnement puis la réduction des prises de pêche sont le symptôme le plus visible de cet appauvrissement des océans : les stocks de poissons surexploités sont passés de 10 % dans les années 1970 à 24 % en 2002, tandis que 52 % sont à la limite maxi-male d’exploitation. Alors que la dégradation affectait jusqu’à présent surtout les eaux côtières, elle atteint maintenant l’ensemble des océans : on estime par exemple que 18 000 bouts de plastique flottent sur chaque kilomètre carré d’océan ;dans le centre du Pacifique, on compte 3 kilogrammes de déchets pour 500 grammes de plancton ! Les hautes mers et les fonds océaniques, qui abritent une biodiversité très importante, commencent à être exploités et perturbés par la pêche, la prospection de nouvelles espèces, la recherche pétrolière, etc.
Une des histoires les plus désolantes et les plus symboliques de ce que nous avons fait de la planète se déroule entre le vaste océan et les lacs d’Alaska. Au terme de leur existence, les saumons sauvages reviennent pondre leurs oeufs dans les centaines de lacs que compte cet État. Ils déposent les oeufs, puis meurent, leurs corps allant se déposer au fond du lac où leur instinct les a ramenés. Des chercheurs canadiens ont eu l’idée de collecter et d’analyser les sédiments de quelques-uns de ces lacs, sédiments composés en bonne partie des cadavres des grands poissons migrateurs. Ils ont eu la surprise de découvrir que ces sédi-ments contiennent plus de PCB (polychlorobiphényles) qu’il n’aurait pu s’en trouver dans le lac du seul fait des dépôts atmosphériques. Les PCB sont un polluant chimique très persistant, qui a été utilisé en énormes quantités pendant des dizaines d’années au XXe siècle. Ces PCB en excès dans les lacs proviennent des cadavres des poissons. Ainsi, les saumons sauvages polluent les lacs immaculés des zones les plus reculées de l’Alaska !
À quoi est-ce dû ? Le PCB est répandu en quantité infime dans tout l’océan. Durant leurs pérégrinations dans le nord du Pacifique, les poissons accumulent ces polychlorobiphényles dans leurs graisses : al-ors qu’on en trouve moins de 1 nanogramme par litre, le poison atteint la concentration de 2 500 nanogrammes par gramme de graisse de l’animal. Les saumons « agissent ainsi comme des pompes biologiques », accumulant la matière toxique avant de revenir polluer le lac … et leur descendance.
Nous sommes tous des saumons : en tant qu’êtres placés au sommet de la chaîne alimentaire, nos organismes accumulent les contaminants largement répandus dans la biosphère par nos si indispensables « activités humaines ». Et de même que les saumons d’Alaska empois-onnent leur progéniture, de même nous contaminons dès la naissance nos enfants. En Allemagne, où plusieurs organismes publics analysent régulièrement, depuis des années, le lait maternel, on a constaté que celui-ci contient jusqu’à 350 types de polluants. Ces poisons ne se ret-rouvent pas seulement dans le lait maternel. Toutes les analyses de sérum sanguin effectuées dans les pays développés montrent de la même manière que les adultes sont contaminés, à des doses certes petites, par une large gamme de produits chimiques.
Si l’on n’a pas établi de manière nette à quel degré la contamination chimique généralisée affecte l’état de santé des populations, une ques-tion voisine préoccupe depuis une dizaine d’années les spécialistes de la reproduction. On observe une montée des troubles de la reproduc-tion (quantité de spermatozoïdes en diminution chez les hommes, cancers des testicules, augmentation de la stérilité, etc.). Est-elle at-tribuable à la contamination par des produits chimiques, classés comme « perturbateurs endocriniens » parce qu’ils dérèglent le sys-tème hormonal ? Des indices de plus en plus nombreux plaident dans ce sens. Par exemple, une recherche publiée début 2006 a établi le lien entre l’exposition à de faibles doses d’insecticides et la baisse de fertil-ité des hommes examinés. Un autre facteur explicatif – supplé-mentaire ? – pourrait être la pollution atmosphérique, dont plusieurs études indiquent qu’elle affecte la reproduction humaine.
Plus globalement, les scientifiques discutent du lien entre la contamin-ation des individus (du fait des produits chimiques qu’ils absorbent par l’eau, la nourriture ou l’atmosphère) et l’augmentation régulière des cancers.
En fait, les démographes et les spécialistes de santé publique commen-cent à envisager que l’allongement de l’espérance de vie -un des indic-ateurs les plus généralement reconnus du progrès humain -pourrait prochainement s’arrêter. La durée moyenne de la vie humaine pour-rait même se contracter. Les responsables en seraient la pollution chimique – « Cela ne fait que trente ans que nous sommes exposés quotidiennement à des centaines de produits chimiques, dont la pro-duction massive date des années 1970 ou 1980 », relève Claude Aubert –, une alimentation déséquilibrée et surabondante, l’exposition à la pollution atmosphérique, radioactive et électromagnétique, et des habitudes de vie trop sédentaires (télévision et automobile). Aux États-Unis, l’espérance de vie des femmes tend à plafonner depuis 1997. Et un chercheur, Jay Olshansky, a estimé qu’en raison de la montée rapide de l’obésité (deux tiers des adultes aux États-Unis sont en surcharge pondérale), l’espérance de vie dans ce pays pourrait décroître prochainement.
La planète ne récupère plus
Un facteur aggravant de la crise écologique planétaire est la fant-astique expansion de la Chine, dont la production a crû depuis une quinzaine d’années au rythme de près de 10 % par an, et de l’Inde, à un taux guère inférieur. Cette croissance est comparable à celle du Ja-pon dans les années 1960. L’empire du Soleil levant était ainsi devenu la deuxième économie du monde. Mais avec la Chine, c’est une masse humaine dix fois plus importante que le Japon qui est entrée dans la spirale de la croissance économique : elle pèse donc bien plus lourde-ment sur les écosystèmes mondiaux, notamment par ses importations de matières premières et de bois dont l’extraction impacte leurs mi-lieux d’origine. Par exemple, la Chine est devenue le premier im-portateur mondial de soja, stimulant l’expansion de la culture de la légumineuse en Amérique latine, ce qui aggrave la déforestation de la forêt amazonienne. L’Asie grimpe aussi rapidement vers la première place du podium des émissions de gaz à effet de serre : en 2004, la Chine émettait 4 707 millions de tonnes de gaz carbonique, l’Inde, 1 113, contre 5 912 pour les États-Unis et 3 506 pour l’Union européenne à 15.
La pression écologique de la Chine – et à un moindre degré de l’Inde –, dommageable en soi, ne saurait excuser celle des pays occidentaux : c’est parce que ceux-ci pèsent déjà lourdement sur la biosphère que le poids supplémentaire des nouvelles puissances rend la crise écologique insupportable. Ce n’est pas la Chine qui pose problème : c’est le fait qu’elle s’ajoute aux problèmes que constituent déjà les États-Unis et l’Europe. Tous ensemble, nous commençons à dépasser les capacités de récupération de la planète : on coupe la forêt plus vite qu’elle ne peut se régénérer, on pompe les réserves d’eau souterraine plus vite qu’elles ne peuvent se recharger, on émet plus de gaz à effet de serre que la biosphère ne peut les recycler. L’« empreinte écolo-gique » de nos sociétés, c’est-àdire leur impact écologique, selon le concept forgé par un expert suisse, Mathis Wackernagel, dépasse la « biocapacité de la planète ». En 1960, selon lui, l’humanité n’utilisait que la moitié de cette capacité biologique ; en 2003, elle tirerait 1,2 fois sur cette capacité, c’est-à-dire qu’elle consommerait davantage de ressources écologiques que la planète n’en produit.
Les deux géants asiatiques subissent d’ailleurs à domicile les effets pervers de leur croissance effrénée : en Chine, le recul des terres ar-ables au profit de l’urbanisation est très rapide (un million d’hectares par an ; sur vingt-cinq ans, cette perte atteint 7 % de la superficie agri-cole). Le désert progresse de plus de cent mille hectares par an, et Pékin subit chaque année des vents de sable venus de l’ouest. Tous les printemps, le fleuve Jaune est asséché plusieurs semaines. Trois cent millions de Chinois – près d’un quart de la population – boivent une eau polluée, et la pollution du Yang-Tseu-Kiang, le plus long fleuve du pays, devient si préoccupante qu’elle menace l’approvisionnement en eau potable de Shanghai, la capitale économique. Les nappes souter-raines sont polluées dans 90 % des villes chinoises et plus de 70 % des rivières et des lacs le sont également, selon les données officielles citées par l’agence Chine nouvelle. Près de cent grandes villes subis-sent chaque année des coupures d’eau. Vingt des trente villes du monde à l’air le plus pollué se trouvent en Chine. « L’air chinois est aussi tellement saturé de dioxyde de soufre que le pays a connu des pluies acides d’une gravité rarement égalée. On estime à quelque 30 % les terres cultivables souffrant d’acidification », rapporte le World-watch Institute.
Le changement climatique, un volet de la crise globale
Pour saisir vraiment la gravité de la crise écologique planétaire, il est essentiel de comprendre que le changement climatique – le plus souvent présenté de manière isolée – ne la résume pas. Les différents dérèglements écologiques n’en forment en réalité qu’un seul : et le changement climatique n’est que la facette la plus visible d’une même crise que manifestent également disparition rapide de la biodiversité et pollution générale des écosystèmes.
Pourquoi ?
Parce que les trois dimensions ici décrites ne constituent pas des pans autonomes de la réalité. La science les isole abstraitement afin de mieux les étudier. Mais dans la réalité de la biosphère, elles participent d’un même phénomène.
Par exemple, la construction d’une autoroute puis sa mise en service vont tout à la fois affaiblir la biodiversité (en fracturant l’écosystème traversé), polluer l’environnement (émissions de polluants atmo-sphériques tels qu’oxydes d’azote ou particules, écoule-ments d’essence), accroître les émissions de gaz carbonique en stimu-lant la circulation des automobiles et des camions. De même, le rejet excessif de gaz carbonique conduit à augmenter son absorption dans les océans, ce qui acidifie ceux-ci et affaiblit la capacité du corail et du plancton à fabriquer leur enveloppe calcaire : si rien ne change, les or-ganismes pourvus d’une coquille dite « aragonite » auront disparu de l’océan austral en 2030, avec des conséquences néfastes pour les es-pèces dont ils constituent la nourriture, comme les baleines ou les saumons.
Autre exemple d’interaction, le changement climatique devrait favor-iser l’extension hors de leur écosystème d’origine de vecteurs de mal-adies : par exemple, les moustiques porteurs du paludisme vers les pays de l’hémisphère Nord. Il devrait également stimuler l’érosion de la biodiversité : une étude scientifique publiée en 2004 a estimé qu’il entraînerait la disparition de 35 % des espèces vivantes. Sans doute exagérée, cette étude a néanmoins permis de pointer la vigueur du lien entre les deux phénomènes.
Inversement, les facteurs de destruction de la biodiversité participent souvent du changement climatique : près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre sont dus à la déforestation. Plus généralement, la crise de la biodiversité affaiblit la capacité de la biosphère à amortir, ou à tamponner, les émissions de gaz à effet de serre ; et donc, elle ag-grave leur impact.
Ainsi, nous devons abandonner l’idée de crises séparées, solubles in-dépendamment les unes des autres. Cette idée ne sert que des intérêts particuliers, par exemple celui du lobby nucléariste qui utilise le changement climatique pour promouvoir son industrie. Au contraire, il nous faut penser la synergie des crises, leur imbrication, leurs inter-actions. Et accepter d’entendre un fait désagréable : cette synergie joue en ce moment dans le sens de la dégradation, avec une puissance de-structrice que rien ne vient pour l’instant tempérer.