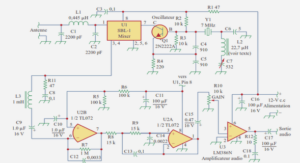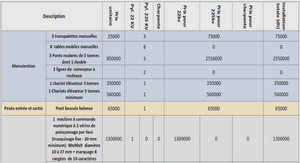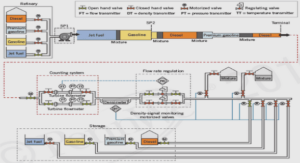Les 7 piliers de la culture de l’information
Ainsi, Olivier Le Deuff dans sa thèse consacrée à la culture de l’information qu’il résuma dans un article pour la revue professionnelle InterCDI avance 7 piliers pour définir la culture de l’information:
– La culture de l’information s’inscrit dans la durée
Olivier Le Deuff fait référence à l’histoire et à l’importance de prendre en considération l’héritage documentaire. Il cite le travail de Brigitte Juanals sur l’Encyclopédie des Lumières, la recherche de Sylvie Fayet-Scribe sur le développement de la culture de l’information du XIXème à nos jours. Nous nous permettrons d’ajouter, l’importance de prévoir cette culture de l’information non seulement dans mais sur la durée. Mise en œuvre sous forme de parcours, au collège et au lycée, il est primordial de s’appuyer sur la maturité de l’élève pour qu’il acquière les savoirs nécessaires à un épanouissement durablement et tout au long de son cursus scolaire. Olivier Le Deuff écrit : « Elle nécessite du temps et se construit dans la durée ».
– Elle repose sur des spécificités
Selon lui, la culture de l’information ne doit pas être confondue avec la culture générale, c’est néanmoins une de ses « clés ». Elle ne doit pas être réduite dans sa définition à l’information literacy anglo-saxonne parce qu’elle n’en est pas la traduction fidèle et ne pas être l’apanage unique des professeurs documentalistes comme elle a trouvé son origine dans le monde des bibliothèques. Il existe de nombreux concepts de culture de l’information qui devraient enrichir nos visions.
– La culture de l’information constitue une voie plus citoyenne que celle de l’information literacy ! E&!
Il est important d’inscrire l’acquisition de cette culture dans une démarche constructive qui envisage une transmission « qui ne cherche pas une rentabilité immédiate ».
– Une formation mieux conçue est à penser
Les ingrédients imaginés sont : des situations problèmes rappelant des situations quotidiennes, des projets d’ampleur, des recherches d’informations et des réalisations sous forme de créations.
– Repenser la formation dans le concept d’information
Olivier Le Deuff convoque Gilbert Simondon pour développer sa réflexion autour d’une formation conçue sur une « culture technique ouverte », nous retrouvons celle-ci dans son cinquième pilier.
– La culture de l’information est une culture technique
Il ne faudrait pas éduquer seulement à l’usage d’un outil mais former à l’information car toute innovation technologique n’efface pas les autres techniques.
– La culture de l’information repose sur le contrôle de soi et la prise de soin (de l’autre)
Olivier Le Deuff évoque dans cette leçon, la nécessité de développer un esprit critique, il faut être capable de veiller, de prendre le temps de l’analyse et de la réflexion. Ceci va selon nous à l’encontre du rythme imposé aujourd’hui par la société qui fait l’apologie du « aller vite » au détriment du « faire bien ».
Avant de proposer, à notre tour, des recommandations aux professeurs documentalistes pour développer une culture de l’information en collège et en lycée, nous étudierons les « 3 leviers didactiques » proposés par Pascal Duplessis pour conduire cette éducation après avoir étudié le socle sur lequel elle doit reposer : la durée, la mise en valeur des spécificités, la citoyenneté, la redéfinition du concept d’information et de sa formation, la connaissance de la technique, le contrôle de soi.
Trois leviers pour Pascal Duplessis
Pascal Duplessis, professeur documentaliste et formateur à l’ESPE des Pays de la Loire, site d’Angers, responsable pédagogique du Master MEEF Documentation et responsable de la préparation au CAPES interne, il est membre fondateur du Groupe de recherche sur la culture et la didactique de l’information (GRCDI). Lors de son intervention aux journées professionnelles de l’ADBEN Aquitaine, en 2009, il a proposé une communication sur l’éducation à la culture de l’information. Nous retiendrons les trois leviers didactiques qu’il présente pour conduire cette éducation :
– prendre les pratiques informelles comme références pour ancrer les apprentissages formels
– se saisir des phénomènes informationnels comme objets d’étude
– entrer dans la culture de l’information par les usages.
Du côté des compétences à développer chez l’élève, Pascal Duplessis emploie cette expression : « entrer dans la culture de l’information, c’est s’y connaître et en être pour l’élève. ». Cette phrase laisse suggérer que l’élève doit posséder des compétences informationnelles qui lui permettent de mieux être intégré et de prendre davantage part à la société de l’information. Ce qui sous-entend que l’élève doit devenir un expert, être efficace et comprendre, et être également acteur c’est à dire « agir en responsabilité et créer » (Duplessis, 2009). Un article posté sur le blog Les Trois couronnes, site de Pascal Duplessis, vient préciser ces propos. Le schéma proposé nous permet de mieux comprendre et d’envisager tous les savoirs, savoir-être et savoir-faire à développer pour une culture de l’information. Nous rappellerons qu’il propose une entrée par les usages. Pascal Duplessis précise qu’aujourd’hui : « Si l’action formatrice consistait, jusque là, à développer des compétences info-documentaires de recherche d’information afin que les élèves agrègent de manière autonome les savoirs dont ils avaient besoin, la nouvelle donne numérique conduit aujourd’hui les professeurs-documentalistes à faire entrer les générations qui lui sont confiées dans la culture de l’information. » (Duplessis, 2009). Ce schéma demande d’être repensé pour une culture de l’image photographique. Selon nous, l’élève devra maîtriser sa recherche et son traitement c’est à dire connaître les banques d’images photographiques libres de droit, savoir lire une image et savoir si cette image est digne de confiance, apporte une information nouvelle, connaître les caractéristiques de la photographie pour en comprendre son usage, mais aussi son circuit économique pour en savoir les enjeux et être formé aux droits, respecter le droit à l’image et le droit de l’image. En effet le cadre juridique de l’image est complexe « car il fait intervenir plusieurs corpus juridiques : droit pénal, droit civil, droit de la propriété intellectuelle, droit administratif. » (Gauvin, 2010).
Pour être intégré dans la culture de l’image photographique, l’élève devra être responsable de son utilisation de la photographie, savoir en réaliser, savoir participer aux réseaux sociaux et devra apprendre à maîtriser son image.
Pour le former à acquérir ces compétences nous devons relever les outils dont le professeur documentaliste dispose. Auparavant, et pour conclure sur ce point, nous aimerions relever que 7 piliers, 3 leviers, et d’autres principes encore ont été imaginés, pensés, proposés pour développer une formation à la culture de l’information. Nous voudrions insister sur le fait que cette nécessité est partagée par tous les chercheurs en sciences de l’information et de la communication même si elle reste plus ou moins théorisée, à différents niveaux, par les différents acteurs de l’école. Nous voulons à notre tour contribuer à construire cette culture de l’information.
Pour la définition d’une culture de l’information
Parler d’une même voix, créer un même parcours, une même voie est une quête largement menée par les chercheurs en sciences de l’information et en sciences de l’éducation. Philippe Meirieu, Professeur à l’université Lumière Lyon 2, s’élevait dans une intervention intitulée, « Eduquer aux médias, éduquer les médias pour un sursaut citoyen », dans le cadre du 8ème colloque de la Fadben pour une éducation à l’information. En effet, Philippe Meirieu s’est intéressé depuis longtemps à l’éducation aux médias mais plus largement à la question de la formation à la culture de l’information à l’école en observant les pratiques documentaires mises en place à l’école. Il a collaboré à la mise en place de réformes institutionnelles comme les TPE et les IDD, au début des années 2000. Notre intérêt se porte sur sa collaboration avec Cap Canal, seule chaîne de télévision consacrée à l’éducation. Dans ce texte, Philippe Meirieu soulève pour nous un problème fondamental auquel nous nous sommes proposée de réfléchir dans cette thèse : « le statut institutionnel de l’éducation à l’image n’est pas clair : légitimement, on n’en a pas fait une discipline spécifique, mais, comme chaque fois dans ce cas, nul ne s’en vit comme le garant et on s’en remet à l’initiative de ceux que la question intéresse » (Meirieu, 2008). Plus largement, il rappelle la « résistance traditionnelle de l’école » à l’égard de tout ce qui relève de « l’actualité ». Il explique que cette frilosité de l’école tient au fait qu’elle veut être garante d’un savoir pérenne, d’une culture scolaire solide. L’actualité porte en elle « le fugace, la mode ». Se confronte alors la culture scolaire à la « culture jeune » dans nos écoles. Au contraire, il est possible pour Philippe Meirieu de « s’appuyer sur certaines expressions de la culture jeune pour l’interroger de manière critique ». Il souligne que l’élève doit pouvoir interroger l’adulte comme « être de culture » étant confronté aux mêmes objets culturels que lui. Il est évident que l’enseignant va mobiliser des savoirs stabilisés (« construction et diffusion des images, données juridiques et économiques, repères techniques et même idéologiques ») afin, ce sont ses mots, « d’aider les élèves à interroger les phénomènes culturels ». Que doit donc apprendre l’école ? Selon lui, il est nécessaire d’accompagner les élèves à s’interroger sur l’information et l’image afin qu’ils comprennent qu’elles relèvent d’une construction par leur auteur. Il est important d’analyser, d’observer pour décoder et comprendre l’information et l’image. Notons qu’il insiste sur ce binôme : l’information et l’image pour mettre en exergue la nécessité d’une éducation à l’image. Il souligne l’acclimatation par habitude. Il nous appelle aussi à nous mobiliser en tant qu’éducateur et citoyen pour « mettre les médias face à leurs responsabilités » et à penser raisonnablement que la formation à l’école ne suffira pas si la société elle-même n’évolue pas. Les médias n’effectuent pas leurs devoirs en matière éducative aujourd’hui. Il déplore qu’il n’y ait pas de journaux télévisés réalisés pour les enfants, ni d’émissions de littérature jeunesse. Nous partageons sa conviction que nous ne devons pas laisser les élèves « vivre dans un monde dont ils ignorent les clés » mais nous raccrocher du projet des Lumières, et les amener à « oser penser par eux-mêmes. ».Le philosophe Gilbert Simondon, technophile, demandait en 1958, dans Du mode d’existence des objets techniques, un « travail d’information, d’éducation et d’acculturation » nécessaire au développement d’une culture en phase avec le monde « n’étant pas sans analogie avec celui qui fut réalisé par les Lumières et l’Encyclopédie au XVIIIème siècle »… Pour lui « les techniques ont pour rôle de modifier, reconstruire le milieu physique, c’est-à-dire l’environnement extrahumain, mais pas l’homme-même ». « La culture doit rester au-dessus de toute technique » avait-il écrit dans l’individuation psychique et collective.