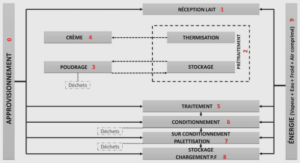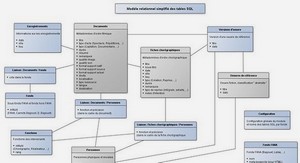Représentations, fantasmes et figurabilité
La définition classique du fantasme (de l’allemand Phantasie) par la psychanalyse met l’accent sur les produits de l’imagination, le monde imaginaire et ses contenus. Le rapprochement avec les fantômes ou, pour mieux dire, les fantasmagories est habituel, ce qui permet d’opposer globalement le monde fantasmatique au monde de la réalité. J. Laplanche et J.-B. Pontalis (1985) proposent de l’envisager comme « terme pour désigner l’imagination, non pas tant la faculté d’imaginer […] que le monde imaginaire et ses contenus, les “imaginations” ou les “fantasmes” dans lesquels se retranche volontiers le névrosé ou le poète ». En bref, il s’agirait donc d’une élaboration imaginaire proche du rêve mais qui aurait bien, comme Freud lui-même y a insisté, une « réalité psychique ». Dans L’Interprétation des rêves, Freud définit la réalité psychique en question non pas « comme le champ psychique dans son entier mais comme un noyau hétérogène dans ce champ, résistant, seul vraiment “réel” par opposition à la plupart des phénomènes psychiques » (ibid., p. 18). On aurait ainsi affaire à deux « composants » de la vie psychique : 1/ la trame constituée des pensées de transition et de liaison, et 2/ les noyaux résistants, réels, c’est-à-dire les fantasmes, émanations des désirs inconscients dont on peut se demander s’ils ne constituent pas les racines obscures de bon nombre de représentations. Ainsi, par exemple, dans le cas de la célèbre scène primitive, on assiste à l’élaboration interprétative par l’enfant, à partir de la vraie scène des relations sexuelles parentales, d’une représentation sensiblement divergente où apparaît une dimension sadique substitutive. Certains fantasmes seraient très archaïques et Freud introduit la notion de fantasmes originaires (Urphantasien). Ce qui permettrait d’affirmer, au-delà de la diversité des productions individuelles, l’existence de quelques fantasmes « de base » possédant un caractère d’universalité et de primordialité qui les font supposer présents, avec le même contenu, en tous les hommes chez qui ils jouent le rôle d’organisateurs de la vie psychique. M. Klein (1967), pour sa part, indiquait que « bons » et « mauvais » objets sont des « imagos, déformées de façon fantasmatique, des objets réels sur lesquels elles reposent ».
La notion de figurabilité utilisée par les psychanalystes apporte un utile complément à ce que nous venons de dire des fantasmes et de leurs rapports avec les représentations. D’après C. et S. Botella (1983), on entend par figurabilité « le produit d’un travail psychique diurne comparable à celui du rêve avec son parcours régrédiant aboutissant à une perception interne proche de l’hallucination du rêveur » (p. 765). L’effort principal de l’analyste, notamment auprès d’enfants menacés de sombrer dans l’autisme, sera de permettre la reconstruction d’un passé biographique avec des« fragments de vérité » suivant l’expression de Freud. En effet, selon l’hypothèse des auteurs précités, « ce n’est pas la perte de l’objet mais le danger de la perte de sa représentation et, par extension, le risque de non-représentation qui signe la détresse » (p. 766). Il est, par conséquent, très important de favoriser la construction, à partir de purs éléments sensoriels conservés en l’état par le psychisme, de « formes figurées » jouant le rôle de quasi-souvenirs. En somme, le travail analytique consiste à tirer des éléments psychiques épars de leur dérive (dérive induite de leur conservation sous forme de morceaux de réalité matérielle sans unité, sans lien ni structure) pour leur conférer un début d’organisation. Il s’agit donc de rassembler tout le matériel sensoriel et perceptif dérivant et menacé de dissolution (menaçant du même coup le psychisme de dislocation, voire d’anéantissement par défaut de représentations objectales) pour lui redonner cohérence en le réinscrivant dans l’histoire du sujet sous forme de souvenirs, peut-être vaudrait-il mieux dire de pseudosouvenirs. Ceux-ci viendraient apporter au psychisme un ancrage nécessaire dans la réélaboration du réel par le biais de la représentation psychique ainsi restaurée. Le sujet deviendrait alors capable de s’appuyer sur ces formes figurées comme sur son passé réel, de s’appréhender lui-même comme sujet d’une histoire, de se situer au centre d’un récit existentiel qui serait le sien propre, afin de lui éviter le glissement dans la déréalisation et l’autisme. Les images suscitées par l’analyste au cours de séances avec les enfants n’ont pas pour but, dans ce cas particulier, l’interprétation d’un fantasme (par exemple, celui de la perte) mais, au contraire, de « remplir la béance ouverte par le traumatisme pour rétablir sa continuité psychique » et fournir à l’enfant « une véritable représentation contre la détresse de la non-représentation ». La figurabilité apparaît donc comme la possibilité pour le psychisme traumatisé de ne pas sombrer dans le morcellement. La voie figurative apparaît ainsi comme moyen d’inhiber la production des affects désagréables grâce au pouvoir « liant » des représentations. Renonçant au travail analytique classique qui consiste à repérer un contenu latent derrière un contenu manifeste, le psychanalyste est amené, devant l’enfant au Moi menacé de clivage, à effectuer un travail en sens contraire et à avancer « des formations préconscientes susceptibles d’aimanter, un jour, d’autres représentations, de servir de contenus manifestes. Une sorte de processus analytique à rebours où l’analyste promeut le préconscient de l’enfant. Sous les effets du pouvoir de captation de la figuration de l’analyste, nous voyons naître chez l’enfant une ébauche du monde des représentations » (ibid., p. 769).
On saisit, de la sorte, l’importance de l’élaboration des représentations telle que la mettent en évidence la notion de figurabilité et son emploi en clinique analytique. L’enjeu consiste, pour le sujet, à se saisir lui-même comme sujet de sa propre histoire, inscrit dans un déroulement événementiel dont les séquences lui apparaissent balisées par la série des représentations qui autorisent, par le biais de la figurabilité, l’intégration même des expériences douloureuses dans cette histoire, sans clivage du Moi ni phénomène de bascule dans l’hallucination.
Assez proche est le constat qu’effectue N. Zajde à propos des victimes des camps de concentration et de leurs descendants. Cet auteur identifie le mécanisme psychologique responsable des troubles dans la fonction représentationnelle et met en évidence son rôle dans leur genèse et leur liquidation : « Si l’on veut déstabiliser un être, le fragiliser au plus haut point, il suffit de lui ôter son mode de représentations, son mode de pensées ; en le dessaisissant de son univers culturel, en lui ravissant l’espace psychique qui lui permet de donner un sens à ce qui lui arrive, on rafle son âme, on le tue » (1995, p. 83).
Mais ce mécanisme peut jouer spontanément. La psychologie clinique et la psychopathologie des personnes soumises à un traumatisme important montrent qu’il est souvent impossible au sujet traumatisé d’élaborer des représentations relatives aux scènes qu’il a vécues. Leur réévocation sous forme de scénario mental est soit impossible, soit vécue sur le mode de la déréalisation [3]. On constate alors que les mécanismes de défense mis en place par le psychisme sont de l’ordre de la dénégation ou du déni. Les représentations qui s’y rapportent sont alors, comme l’indique N. Zajde, « à la fois inassimilables et omniprésentes ». Et l’auteur ajoute que « quand elles sont ainsi évoquées, elles prennent presque l’allure d’un délire, car elles n’ont aucune place dans le monde de la réalité » (ibid.). Un autre mécanisme de défense intervient : l’isolation. La représentation impossible ou insupportable du fait de l’horreur qu’elle véhicule ne permet pas qu’on l’élabore sur un mode symbolique. Pour assumer le traumatisme, il faudrait que ces individus puissent se représenter ce qui les blesse et l’élaborer sur le mode du récit où ces représentations prendraient place. Les représentations trop douloureuses constituent ce que l’auteur précité nomme le « cimetière secret » (ibid., p. 64) des victimes et ne parviennent pas, même à travers les paroles des déportés eux-mêmes, à s’intégrer dans une logique narrative. Les recherches qui ont porté sur les accidentés, les malades graves et les victimes d’attentats terroristes confirment ces observations. Tous ces traumatisés ont en commun d’éprouver des difficultés à élaborer une représentation de la scène traumatisante. Leur état psychique est tel que seul paraît subsister l’ébranlement émotionnel lié au choc. Ce qui justifie la création assez récente de services d’accueil des victimes d’attentats et de soutien aux grands malades (cancéreux, sidéens en particulier).
Idées reçues, clichés, préjugés, stéréotypes et représentations sociales
La psychologie sociale et la psychosociologie ont largement contribué à explorer les manifestations de la mentalité collective au premier rang desquelles se trouvent les préjugés et les stéréotypes. Ces produits de la pensée se présentent comme des élaborations groupales qui reflètent, à un moment donné, le point de vue prévalent dans un groupe relativement à certains sujets. Ils peuvent concerner aussi bien des faits et situations que des personnes et ont pour vocation essentielle de produire une espèce d’« idée reçue » qui vaut dans tous les cas et s’impose avec une valeur attributive ou prédicative. Celle-ci rend compte pour l’individu qui parle comme pour ceux qui l’écoutent d’un contenu attendu ou sous-entendu. La pensée préjudicative est bien, comme son nom l’indique, constituée par un jugement préélaboré, représentant une sorte de prérequis pour un groupe donné. Le préjugé ressortit de ce point de vue à une espèce de convention globalement consensuelle qui intéresse tout particulièrement certaines questions et se présente ainsi comme un produit mental simple et unifié revendiqué par tous les membres du groupe. Chacun, dans la société de référence, sait à quoi s’en tenir lorsqu’il est confronté à cet énoncé, et il n’a pas besoin de chercher de justification ni d’explication pour l’admettre. L’adhésion se fait d’une manière automatique dans l’inconscient où se déploie cette « idée reçue ». Son niveau infracritique est une des caractéristiques du préjugé et constitue l’essentiel de sa dangerosité. En effet, comme cette « idée reçue » a ses sources cachées dans la conscience collective, qu’elle reçoit sa caution du groupe par l’accord spontané de chacun de ses membres, elle acquiert une espèce d’évidence qui s’impose à la connaissance et tient lieu de toute délibération. Elle l’emporte sur les jugements discriminatoires et analytiques pour deux raisons : d’une part, elle bénéficie d’une multitude d’adhésions, d’autre part, elle profite de l’ancienneté de son inscription dans le temps, ce qui lui vaut un respect quasi traditionnel. Tous les ensembles humains sont assujettis aux « préjugés », car ils sont économiques, commodes et efficaces, facilitateurs de la communication sociale en même temps qu’activateurs épistémologiques de la pensée vulgaire. Le préjugé tient du schéma dont il est à peine besoin de souligner les traits réducteurs et caricaturaux. Mais on ne peut lui dénier sa valeur opératoire d’autant plus efficiente qu’encore une fois elle joue à un niveau de profondeur psychosocial qui lui permet de s’imposer facilement.
Selon J.-P. Leyens (1979), « il y a fort à parier que les préjugés raciaux fonctionnent suivant le schéma du conditionnement classique. Ces préjugés (les Italiens sont paresseux, les Français sont sales, les Juifs sont avares, les Polonais sont des ivrognes) n’ont pas besoin d’être enseignés de façon délibérée. Ils peuvent tout simplement être le fruit d’un conditionnement. La brave mère de famille qui déclare constamment devant ses enfants à propos d’un commerçant plus ou moins malhonnête : “C’est un vrai Juif”, n’a probablement aucune intention d’enseigner la haine ou le mépris des Juifs à ses enfants. Néanmoins, le résultat est identique : l’association suffit à créer une attitude explicite ».
Quant aux stéréotypes, ils se présentent comme des clichés mentaux stables, constants et peu susceptibles de modification. Ils sont l’opinion majoritaire d’un groupe. De ce fait, ils sont plus puissants que les préjugés ou les « idées reçues ». Les stéréotypes produisent des biais dans la catégorisation sociale par simplification extrême, généralisation abusive et utilisation systématique et rigide. Les caractéristiques qui constituent l’objet sont ainsi régulièrement faussées et, surtout, c’est faussées qu’elles s’imposent globalement dans la perception qu’on a de l’objet en question. Il n’est pas possible de séparer ou d’isoler l’une ou l’autre de ses qualités telles que le stéréotype les présente. Il les suppose et les contient syncrétiquement toutes à la fois. Aucun aménagement conceptuel ne peut s’envisager qui en modifie les aspects. Il s’agit, là encore, comme dans le cas du préjugé, d’une « idée » toute faite, « préformée », dont la nature sociale est évidente et qui tire sa valeur de la mentalité collective qui lui a donné naissance. Les stéréotypes sont des facilitateurs de la communication par leur côté conventionnel et schématique. Ils économisent (contrairement à ce qui serait souhaitable pour une meilleure description ou adaptation à la réalité) un exposé long, discursif ou démonstratif : ils se présentent comme des raccourcis de la pensée qui vont directement à la conclusion admise « une fois pour toutes », chaque interlocuteur sachant à quoi s’en tenir sur ces clichés. Les stéréotypes s’appliquent à des domaines divers et variés. Ils ne se rencontrent pas tous dans la pensée commune et ne relèvent pas seulement d’appréciations élémentaires ou triviales, puisqu’ils sont également présents dans le discours officiel et/ou institutionnel. Ils peuvent même servir dans des contextes idéologiques comme la propagande (stéréotypes du « bon » et du « mauvais » citoyen, stéréotype des « ennemis de la patrie ou de l’humanité »), pédagogiques pour servir à l’édification des jeunes (stéréotypes des « bons » et des « mauvais » élèves, stéréotypes du « travailleur ») ou commerciaux pour la promotion de produits (stéréotypes de la « bonne ménagère », de la « bonne mère de famille », stéréotype d’un way of life). Ils participent également à la catégorisation sociale dans les problèmes de relations interethniques (Katz et Braly, 1993 ; Billig, 1984), et aboutissent parfois à des attitudes discriminantes, voire xénophobes ou racistes.