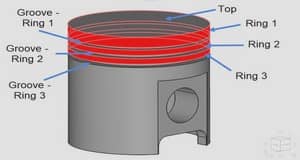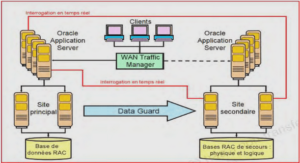La Phase d’avant la libéralisation foncière et immobilière.
Les premiers sites d’habitation de la zone de Mbao sont les villages traditionnels de Petit Mbao, Grand Mbao. Puis pendant la période coloniale, à la faveur de la construction de la route nationale RN1 (en 1921), des populations venues de Yeumbeul ont crée les villages de Keur Mbaye Fall et Kamb. Tous ces villages sont restés très traditionnels.
Après les indépendances, la loi sur le domaine national de 19641 et par la suite, le projet industriel de l’Etat ont freiné l’extension des différents villages de la zone. En Effet, pour obtenir l’espace nécessaire à l’installation de la Zone Franche Industrielle (650 hectares), l’Etat a procédé à l’expropriation de plusieurs terrains en plus des terrains du domaine national disponibles dans la zone. Il a aussi adopté un décret limitant l’extension des différents villages malgré l’arrivée certes peu important jusque là, de nouvelles populations du fait de la zone industrielle. Cela a provoqué le début des litiges fonciers car les populations acceptent difficilement cette nouvelle loi sur le domaine national. Elles revendiquent leur droit de propriétaires foncier selon le système traditionnel et continuent malgré tout à occuper les terrains du domaine national. Le cas le plus marquant est celui de l’occupation du quartier Gokh en 1989.
La phase après la libéralisation foncière et immobilière.
Dans cette phase il faut signaler deux étapes en fonction des opérateurs urbains intervenant dans la zone.
L’Etat, principal opérateur urbain.
En 1988, afin de satisfaire au maximum la demande de logements et réduire le sérieux phénomène de l’occupation incontrôlée des terres et la prolifération d’habitats irréguliers dans la région de Dakar, l’Etat a entre autres mesures, opté pour la libéralisation du secteur de l’immobilier. La loi n°88-05 du 20juin 1988 portant code de l’urbanisme dans son article 64 stipule que : « peuvent constituer une société coopérative de construction et d’habitat, les personnes qui poursuivent les buts suivants :
-l’acquisition de terrains ou de parcelles ;
-la construction d’immeubles à usage collectif ;
-la construction, la restauration et l’amélioration de maisons individuelles groupées à usage d’habitation ou à usage professionnel, destinées à être attribuées, louées ou vendues aux associés».
Dans la zone de Mbao cette loi n’était pas encore appliquée car la majorité des terrains nus relevaient du domaine de l’Etat. Mais en 1989, un habitant du village de grand Mbao, sur la base du système foncier traditionnel, s’est approprié la vaste zone de Gokh pour y réaliser un lotissement de parcelles qui seront ensuite vendues à de nouveaux habitants. Cette zone constitue aujourd’hui le quartier de Gokh. Il est considéré comme une zone d’habitation irrégulière car située illégalement sur un terrain du domaine national et l’opération de lotissement effectué à ce niveau n’a respecté aucune norme d’aménagement.
Dès lors pour limiter ce genre d’opération et surtout le phénomène de l’habitat spontané qui s’observe de plus en plus dans l’ensemble des pôles urbains de la région, l’Etat avec l’appui de la coopération française a initié le projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Mbao dès 19912.
Ce projet de ZAC avait pour principales cibles, les promoteurs immobiliers, les coopératives d’habitats et une partie de la population du village de Kamb.
Les habitants des villages de Mbao ont alors ressenti de la frustration car se sentant défavorisés par le système. En effet, la croissance démographique liée à l’accroissement naturelle de la population et l’arrivée de plus en plus importante de nouvelles populations augmentent de plus en plus la promiscuité dans les villages surtout à grand Mbao et petit Mbao. Des opérations de restructuration ont été initiées à Kamb et même au niveau du village traditionnel Lébou de Yoff (grâce au contexte politique lié au lobby Lébou). De plus, le contexte environnemental lié à la proximité de la mer va s’ajouter à la détresse des villageois de Mbao par le phénomène de l’avancée de la Mer avec la violence des houles qui entraîne des inondations et la destruction de plusieurs maisons.
Ainsi, ces populations se sont organisés et regroupés en collectif, afin de défendre leurs intérêts devant les autorités. Cela a conduit à la création de la zone d’extension de petit Mbao et grand Mbao, suite à la sensibilisation du ministre de l’urbanisme lors d’une visite de sites touchés par l’avancée de la mer.
Les autorités administratives ont cédé une partie du terrain de la réserve foncière de la zone franche industrielle au cours des années 19933.
Ces terrains d’une superficie d’environ 60 hectares ont été confiés à la municipalité après l’adoption de la loi sur la décentralisation et le transfert des compétences au collectivités locales de 19964 pour les opérations de lotissement conformément au plan d’urbanisme de détail du site réalisé par les services techniques de l’Etat.
Peu de temps après la zone d’extension de Keur Mbaye Fall a été aussi crée, avec les mêmes objectifs que celle de Mbao. Une superficie de 9 hectares du domaine de l’Etat ayant appartenu à la Zone franche industrielle, a été déclassée à cet effet. Les opérations d’aménagement ont été entièrement confiées à la collectivité locale mais la gestion de ce projet a été marquée par plusieurs litiges.
Le projet de la ZAC ; les opérations liés à l’aménagement des deux zones d’extension ; la décentralisation et le transfert des compétences en matière d’urbanisme et d’habitat aux collectivités locales ; la restitution des titres fonciers de la ZFI à leurs anciens propriétaires ; constituent un ensemble de facteurs ayant favorisé l’arrivée massive des sociétés immobilières privées dans la commune de Mbao.
Les sociétés immobilières comme principaux opérateurs urbains:
Dans les différents projets cités plus haut, l’Etat et la collectivité locale étaient les principaux acteurs. Les opérateurs immobiliers intervenaient surtout dans la construction des habitations, les principales opérations d’aménagement étant réalisées par les services techniques de l’Etat.
Mais attirés par le potentiel foncier de la zone, les sociétés immobilières s’engagent de plus en plus dans des opérations d’aménagement et de lotissement en plus de la construction d’habitations.
La cité Ndèye Marie est la première réalisation exclusive d’une société immobilière privée (en 1992). Puis ce fut au tour de la société SIPRES d’implanter la cité SIPRES V au Cap de biches et à petit Mbao les citée Promocap et Diagnenar ont été bâties. D’autres grands projets immobiliers initiés par des opérateurs privés sont encours : Mbao Villeneuve de la SICAP, le lotissement les Baobabs et plusieurs autres petits lotissements.
Aujourd’hui la commune d’arrondissement de Mbao est devenue une zone urbaine, une nouvelle petite ville dans la région de Dakar. Elle compte plusieurs quartiers. Les anciens villages (Grand Mbao, Petit et Keur Mbaye Fall) ont les caractéristiques des quartiers dits
« populaires » avec une forte densification de l’habitat et à côté de ces derniers les nouvelles cités comme par exemple la cité SIPRES V sont des quartiers « chics » (Figure 9).
EXTESION ET EVOLUTION DU BATI
Le processus d’urbanisation montre que cette dernière s’est déroulée en plusieurs phases. Pendant ces différentes étapes le bâti a connu une extension spatiale très rapide et une nette évolution typologique.
Extension du bâti :
Dans le cadre de son mémoire de Maîtrise Dièynaba Seck (2005) a étudié l’extension urbaine dans la commune de Mbao sur deux périodes différentes
– entre 1982 et 1997
– entre 1997 et 2002
L’année charnière 1997 marque le début de la période d’après décentralisation. Ainsi elle a trouvé que c’est après la décentralisation que l’extension du bâti a connue une accélération.
– entre 1982 et 1997 : l’extension du bâti est modérée ;
– entre 1997 et 2002 : l’extension du bâti est très forte.
Toutefois il est nécessaire de préciser que la majorité des constructions immobilières qui ont vu le jour après la décentralisation appartient aux projets définis entre 1991 et 1993. Il s’agit des zones d’extension des villages de Mbao et Keur Mbaye Fall et de La ZAC. Ils n’ont pu être réalisés que beaucoup plus tard, du fait de multiples contentieux fonciers et de problèmes administratifs liés à la loi sur la décentralisation.
L’aménagement et l’attribution des terrains dans ces projets ont été faits par les collectivités locales et par l’Etat dans le cas de la ZAC.
Les superficies de ces différents aménagements sont définies comme suit :
– Extension des villages de Mbao 60ha ;
– Extension Keur Mbaye Fall 64 ha;
– Zone d’aménagement prioritaire de Mbao Gare 650ha dont ZAC 380 ha ;
A ces aménagements, sont venus s’ajouter d’autres projets qui ont été définis par des sociétés immobilières privées. Il s’agit des cités :
– Ndèye Marie, 8ha ;
– Promocap, 15ha ;
– Diagnenar, 3ha ;
– SIPRES V, un peu plus de 22ha ;
Dans ces derniers cas ce sont les sociétés immobilières qui ont réalisés les travaux d’aménagement, de lotissement et de construction.
Cependant, l’impact spatial de ces différentes extensions du bâti sur les autres espaces et sur la superficie de la commune est assez remarquable. Les terres de culture ont disparues au profit des habitations. Ce sont les terrains du domaines national et ceux de la ZFI qui servaient de zones agricoles aux villageois de Mbao et Keur Maye Fall. Les zones inondables que sont les niayes et les berges du marigot sont envahies par le bâti. En effet, pour emménager la ZAC, des zones de niayes ont dû être remblayées, de même qu’une partie des berges du marigot dans de la zone d’extension de Keur Mbaye Fall.
La forêt classée a été amputée d’une grande partie de sa superficie au profit notamment de la Zone d’aménagement prioritaire de Mbao Gare et des projets immobiliers de la zone de Petit Mbao dont celui de la SICAP à savoir Mbao Villeneuve (44ha). Entre 1982 et 2002 environ 556ha de végétation constituées par la forêt classée et les terres de cultures ont disparu au profit du bâti dont les 484.95ha entre 1997 et 2002 (Dieynaba Seck, 2005).
En 2002 un cimetière y a été emménagé pour les victimes de la tragédie du bateau le Diola. Les populations dépourvues de terres de cultures y ont aussi emménagé des parcelles pour le maraîchage. Aujourd’hui encore cette forêt qui n’occupe plus que 770 ha est l’objet d’une forte pression foncière car elle représente un important potentiel. De plus le tracé de l’autoroute à péage passe par cette forêt et il existe déjà un projet envisageant son aménagement en un simple espace vert abritant un parcours sportif, des espaces de jeux et des activités lucratifs et de commerce. Mais ce serait une grosse perte du point de vue environnemental car la forêt de Mbao constitue actuellement le principal poumon vert de la région de Dakar.
Donc, l’extension urbaine dans la commune d’arrondissement de Mbao a eu un impact spatial réel mais aussi le paysage de la zone a été irrémédiablement bouleversé.